« Arrêté le 8 novembre 1926 et assigné d’abord à cinq ans de relégation dans une île, Antonio Gramsci sera condamné par le Tribunal spécial à 20 ans, 4 mois et 5 jours de prison ; « Pour vingt ans nous devons empêcher ce cerveau de fonctionner », déclarera le 4 juin 1928 le procureur fasciste. » (Source : Bellaciao, Antonio GRAMSCI : Lettres de la prison (1926-1937))
[Mémoire des luttes] Je reproduis ci-dessous un article passionnant publié sur l’indispensable et quotidien Saker francophone, à la mémoire d’Antonio Gramsci, dont nous devrions entretenir le souvenir pour nous donner des forces :
Antonio Gramsci et la bataille contre le fascisme
Par Chris Hedges – Le 4 juin 2017 – Source Truthdig
Antonio Gramsci écrivit ses Cahiers de prison à une époque assez peu différente de la nôtre. Les partis politiques dirigés par la classe libérale, parce qu’ils s’étaient détachés de la classe ouvrière, étaient faibles ou insignifiants. La gauche radicale avait été neutralisée et avait échoué à formuler une vision alternative au capitalisme. Il y avait une « crise d’autorité ». Le fascisme montait et la répression d’État devenait de plus en plus dure et totalitaire.
Le régime de Benito Mussolini réclamait, comme notre État corporatiste, que soit installé un gouvernement basé sur l’efficacité, la méritocratie, la gestion de la société par des experts et des spécialistes et l’élimination de la lutte de classe par la médiation. Il célébrait également les valeurs militaires « héroïques », le traditionalisme et un passé mythique qui remontait, dans le cas de l’Italie fasciste, à l’ancienne Rome. Il récompensait aussi le conformisme et la loyauté, dénigrait les humanités et la culture au profit de la formation professionnelle et technique, le spectacle et le kitsch patriotique. Il prêchait un positivisme implacable, ridiculisait la notion de bien public en proclamant un hyper-individualisme et a affaibli la presse. La dissidence et la critique étaient condamnées comme une trahison. Lorsque Gramsci fut arrêté et emprisonné en 1926, il jouissait de l’immunité parlementaire, mais les règles juridiques n’avaient plus aucun sens à ce moment-là. C’est dans ce sombre paysage politique que nous avons eu la maxime de [Gramsci] que vous avez tous entendue : « Le pessimisme de l’intelligence, l’optimisme de la volonté ».
Gramsci, comme Léon Trotsky, était un intellectuel mais aussi un journaliste. Et c’est Trotsky qui regrette que, au moment où Gramsci voulait construire le Parti communiste italien, les élites économiques, alliées aux fascistes, aient mis en place des formes de répression si draconiennes qu’une organisation efficace était presque impossible.
Gramsci s’écartait de la croyance marxiste selon laquelle les contradictions intrinsèques du capitalisme conduiraient d’elles-mêmes au socialisme. Il était opposé au contrôle de fer d’une avant-garde révolutionnaire léniniste. La révolution, écrivit-il, ne serait atteinte que lorsque les masses auraient acquis un niveau de conscience suffisant pour exercer leur autonomie personnelle et échapper aux mœurs, stéréotypes et récits disséminés par la culture dominante. Le changement révolutionnaire exigeait cette capacité intellectuelle pour comprendre la réalité.
L’hégémonie, pour Gramsci, se réfère à la façon dont les élites dirigeantes, à travers les organes de la culture de masse, manipulent notre compréhension de la réalité pour promouvoir leurs intérêts. Les consommateurs passifs de la culture de masse voient le monde non tel qu’il est mais tel qu’il est interprété pour eux. La culture de masse, y compris la presse, les écoles et les systèmes de divertissement, diabolisent tous ceux que les élites dirigeantes désignent comme boucs émissaires et craignent – dans notre cas les gens de couleur, les pauvres, les musulmans, les travailleurs sans papiers, les anti-capitalistes, les syndicats, les intellectuels, les progressistes et les dissidents. Les dirigeants d’entreprise utilisent la culture de masse pour transformer les revendications économiques et sociales légitimes en problèmes psychologiques et émotionnels – d’où les battements de tambour dans l’ensemble de la société appelant à croire en nous-mêmes, à travailler dur, à être obéissants, à tenir compte des psychologues positifs et des gourous du développement personnel, à étudier, à viser l’excellence et à croire en nos rêves. Ce mantra, qui nous assure en substance que la réalité n’est jamais un obstacle à nos désirs, s’accompagne de la promotion d’une fausse camaraderie avec la soi-disant famille d’entreprise, si nous travaillons pour une grande société, ou d’un nationalisme exacerbé.
Gramsci a eu la prescience de voir qu’on ne demandait pas seulement au gestionnaire capitaliste de maximiser les profits et de réduire le coût du travail. Le gestionnaire devait construire des mécanismes d’endoctrinement pour assurer l’intégration sociale et la solidarité collective au service du capitalisme, d’où les évaluations, les promotions et les rétrogradations permanentes en même temps que le rassemblement des employées dans des réunions pour instiller une pensée de groupe. Avec cet endoctrinement, de mini états de sécurité et de surveillance s’installent dans nos lieux de travail, où chaque mouvement et chaque mot prononcé sont enregistrés ou filmés au nom du service à la clientèle. Les entreprises fonctionnent comme de petits États totalitaires, des modèles pour l’État corporatiste plus vaste.
Gramsci voyait la culture de masse comme le premier outil pour obtenir la soumission. Plus la culture de masse infecte la pensée et les comportements de la population, moins l’État doit durcir les formes de coercition pour exercer sa domination. Gramsci décrivit la culture de masse, ou la société civile, comme les tranchées et les fortifications permanentes qui défendent les intérêts fondamentaux des élites. Le changement révolutionnaire n’interviendra qu’après une longue série d’attaques, que Gramsci appelait une « guerre de position », sur ces défenses idéologiques extérieures. C’était, à ses yeux, une étape de la guerre de siège qui exige « patience et inventivité ». Une fois que l’idéologie dirigeante perd sa crédibilité, une fois que la culture de masse n’est plus efficace, ses structures institutionnelles s’effondrent. Bref, une contre-hégémonie arrive avant le pouvoir.
« Chaque révolution, écrivit-il, a été précédée par un intense travail critique, par la diffusion de culture et la diffusion d’idées. […] Le même phénomène se répète aujourd’hui dans le cas du socialisme. C’est à travers une critique de la civilisation capitaliste que la conscience unifiée du prolétariat s’est formée ou se forme encore, et une critique implique de la culture, pas simplement une évolution spontanée et naturaliste. […] Se connaître soi-même signifie être soi-même, être le maître de soi. […] et nous ne pouvons réussir à moins de connaître aussi les autres, leur histoire, les efforts couronnés de succès qu’ils ont accomplis pour être ce qu’ils sont, pour créer la civilisation qu’ils ont créée et que nous cherchons à remplacer par la nôtre. »
Les révolutions ont été avant tout une bataille d’idées.
« Un obstacle principal au changement est la reproduction par les forces dominantes d’éléments de leur idéologie hégémonique, écrivit Gramsci. C’est une tâche importante et urgente de développer des interprétations alternatives de la réalité. »
Noam Chomsky résume ceci par « dire la vérité ».
Et Gramsci appuyait : « Dire la vérité est révolutionnaire. »
Le cœur du néolibéralisme est l’idée absurde que le niveau de vie de la classe ouvrière mondiale augmentera en défigurant les sociétés pour obéir servilement aux diktats du marché.
Nous avons atteint un moment dans l’histoire de l’humanité où l’idéologie régnante a perdu sa crédibilité. Toutes les promesses du néolibéralisme se sont révélées fausses. L’abolition des conditions de résidence nationale pour les sociétés a été utilisée pour légaliser les boycotts fiscaux des entreprises. La classe moyenne – le fondement de toute démocratie capitaliste – dépérit et a été remplacée par des travailleurs pauvres, en colère et privés de leurs droits. Les ouvriers sont forcés d’avoir deux ou trois boulots et des semaines de travail de 70 heures pour rester solvables. Les factures médicales, les emprunts étudiants, les prêts hypothécaires à risque et les dettes sur la carte de crédit provoquent des faillites dévastatrices. La classe des dirigeants d’entreprise, pendant ce temps, ramasse des milliards en bonus et en compensations et utilise son argent et des lobbyistes pour détruire les institutions démocratiques. Elle a installé solidement un système que le philosophe politique Sheldon Wolin appelle un « totalitarisme inversé ».
Au fur et à mesure que ces mensonges s’éventent, nous sommes jetés dans ce que Gramsci appelle un interrègne – un temps pendant lequel l’idéologie dominante a perdu son efficacité mais n’a pas encore été remplacée par une nouvelle. « La crises consiste, écrivit Gramsci, précisément dans le fait que l’ancien meurt et que le nouveau ne parvient pas à voir le jour [et] dans ce clair-obscur surgissent des monstres. » D’où les mutations politiques comme Donald Trump ou, à l’époque de Gramsci, Mussolini.
L’accélération de la désindustrialisation dans les années 1970 a créé une crise qui a forcé les élites dirigeantes à inventer un nouveau paradigme politique, comme Stuart Hall [avec des co-auteurs] l’explique dans son livre Policing the Crisis. Ce paradigme, claironné par les médias aux ordres, a fait passer ses priorités du bien commun à la race, au crime et à l’ordre public. Il a dit à ceux qui subissaient de profonds changements économiques et politiques que leurs souffrances ne résultaient pas de la cupidité des entreprises mais d’une menace à l’intégrité nationale. L’ancien consensus qui s’appuyait sur les programmes duNew Deal et de l’État social a été attaqué comme étant favorable aux jeunes criminels noirs, à eux qui vivent aux crochets de l’État social et aux parasites sociaux. Il fallait blâmer les parasites. Cela a ouvert la porte à un populisme autoritaire, entamé par Ronald Reagan et Margaret Thatcher, qui ont prétendu défendre les valeurs familiales, la morale traditionnelle, l’autonomie individuelle, l’ordre public, la foi chrétienne et le retour à un passé mythique, au moins pour les Américains blancs.
La culture de masse est une force contre-révolutionnaire puissante et dangereuse. Elle crée une mentalité grégaire. Elle bannit la pensée indépendante et autonome. Elle détruit notre confiance en nous. Elle marginalise et discrédite les non-conformistes. Elle dépolitise la citoyenneté. Elle instille un sentiment de futilité et d’impuissance collectives en présentant l’idéologie dominante comme une vérité révélée, irréfutable, une force inévitable et inexorable qui seule rend le progrès humain possible.
La culture de masse est une agression qui, comme Gramsci l’écrivait, provoque une conscience « confuse et fragmentaire » ou ce que Marx appelait « fausse conscience ». Elle vise à transmettre au prolétariat la croyance que ses« véritables » intérêts sont alignés sur ceux de la classe dirigeante, dans notre cas les multinationales.
Nous ne sommes pas produits par la nature, écrivit Gramsci, mais par notre histoire et notre culture. Si nous ne connaissons pas notre histoire et notre culture, et si nous acceptons la fausse histoire et la culture fabriquées pour nous, nous ne vaincrons jamais les forces de l’oppression. La récupération de la mémoire par les radicaux dans les années 1960 a terrifié les élites. Cela a permis aux gens de comprendre leur propre pouvoir et leur action. Elle a exprimé et célébré les luttes des travailleurs et des travailleuses et des opprimés plutôt que la bienfaisance mythique des oppresseurs. Elle a révélé l’exploitation et l’hypocrisie de la classe dominante. Et c’est pourquoi les grands patrons ont dépensé des millions pour écraser et marginaliser ces mouvements et leurs histoires dans les écoles, la culture, la presse et dans nos systèmes de divertissement.
« Non seulement les gens n’ont pas de conscience précise de leur propre identité historique, déplorait Gramsci sous le fascisme, ils ne sont même pas conscients de l’identité historique ou des limites exactes de leur adversaire. »
Si nous ne connaissons pas notre histoire, nous n’avons aucun point de comparaison. Nous ne pouvons pas nommer les forces qui nous contrôlent ou voir la longue continuité de l’oppression capitaliste et de la résistance. Une fois qu’une démocratie échoue, comme en a averti Platon, elle crée les conditions pour une tyrannie basée sur le soutien populaire. C’est ce qui s’est passé dans l’Italie fasciste. C’est ce qui s’est passé avec l’élection de Trump. Lorsqu’un populisme de droite ou le fascisme prend le pouvoir, le but n’est pas, comme le disait Gramsci, d’éveiller « la conscience civique de la nation », mais de nourrir et de recréer une conscience civique perdue. C’est là où nous en sommes historiquement. Et c’était là où en était Gramsci lorsqu’il écrivit ses volumineux Cahiers de prison.
La démocratie fut une anomalie dans la plus grande partie de l’Histoire de l’Occident. Après l’effondrement de la démocratie athénienne en 322 avant l’ère chrétienne – et cette démocratie n’était réservée qu’aux hommes et excluait les esclaves –, il s’est passé 2000 ans avant l’apparition d’un autre gouvernement démocratique. Ce n’est qu’à la fin du XXe siècle que des gouvernements démocratiques, maintenant menacés par des mouvements proto-fascistes, ont pu fleurir, même de manière imparfaite. Notre propre système de gouvernement, si on considère l’exclusion des Afro-Américains, des Amérindiens, des hommes non propriétaires et des femmes, ne pouvait pas être défini comme une démocratie complète jusqu’à la moitié du siècle dernier. Et, comme l’Italie fasciste, nous retournons à un despotisme plus familier.
Il y a une raison pour laquelle l’État capitaliste cherche à maintenir les travailleurs sans conscience. Aucun travailleur ne bénéficiera pleinement de son travail dans un système capitaliste puisque cela détruirait le capitalisme lui-même. Et tout travailleur qui comprend vraiment ses intérêts se consacrerait à renverser le capitalisme.
Gramsci publia l’article à Turin, dans Ordine Nuovo (Ordre nouveau), pendant les soulèvements de 1919 qui virent les ouvriers s’emparer des ateliers et former des conseils ouvriers. Lui et les autres auteurs de l’article – qui cessèrent inexplicablement de publier au plus fort des troubles pour se consacrer à l’organisation – ne défendaient pas des positions avant d’avoir analysé et discuté longuement avec les conseils ouvriers. Ces conseils, écrivit Gramsci, avaient non seulement conféré du pouvoir aux travailleurs sur leurs vies professionnelles, mais avaient brisé le mur qui empêchaient les citoyens privés de participer à la vie politique.
Pour Gramsci, la politique révolutionnaire ne venait pas d’en haut mais d’en bas. Elle était organique. Et l’échec, à ses yeux, des élites révolutionnaires est qu’elles étaient souvent aussi dictatoriales et déconnectées des ouvriers que les élites capitalistes. Les masses devaient être intégrées aux structures du pouvoir pour créer une nouvelle forme de politique de masse – d’où son insistance sur le fait que tous les gens sont des intellectuels capables de pensée autonome et indépendante. Une démocratie n’est possible que si tous ses citoyens comprennent la mécanique du pouvoir et ont un rôle dans l’exercice de ce dernier.
Gramsci [1891-1937] se serait désespéré de la fracture, aux États-Unis, entre notre Gauche anémique et la classe ouvrière. Ridiculiser les partisans de Trump, être incapable d’écouter et de se soucier de la souffrance des travailleurs pauvres, y compris blancs, garantit que toute révolte sera mort-née. Ceux d’entre nous qui cherchent à renverser l’État corporatiste devront commencer localement. Cela signifie défendre des propositions comme l’augmentation du salaire minimum, lutter pour de l’eau propre, les soins de santé universels et un bon enseignement public, y compris la formation universitaire gratuite, qui parlent directement de l’amélioration des conditions de vie de la classe laborieuse. Cela ne veut pas dire donner des leçons à la classe ouvrière, et en particulier à la classe ouvrière blanche, sur le multiculturalisme et la politique identitaire.
La révolte, cependant, sans une vision politique alternative, Gramsci le savait, était vouée à l’échec. Les ouvriers sont mobilisés aussi facilement autour d’idéologies anti-démocratiques comme le fascisme et le racisme. S’ils manquent de conscience, ils peuvent devenir une force sombre dans le corps politique, comme nous l’avons vu lors des rassemblements de Trump et avec l’augmentation des crimes mus par la haine.
« Mais est-ce suffisant qu’une révolution soit menée par des prolétaires pour qu’elle soit une révolution prolétarienne ?, questionnait-il. La guerre est aussi est faite par des prolétaires, mais elle n’en est pas pour autant un événement prolétarien. Pour que cela le soit, il faut la présence d’autres facteurs spirituels. Il doit y avoir plus pour la révolution que la question du pouvoir : il doit y avoir la question de la morale, de la manière de vivre. »
Cette insistance sur la vision d’un nouvel ordre opposa Gramsci aux anarchistes et aux syndicats. L’État pourrait affronter les troubles, même la révolte, savait-il, tant qu’elle était sporadique et localisée et ne formulait pas un programme visant à remplacer les structures qui maintiennent les élites dirigeantes au pouvoir. « L’État socialiste ne peut pas s’incarner dans les institutions de l’État capitaliste […], écrivit-il. L’État socialiste doit être une création fondamentalement nouvelle. Les institutions de l’État capitaliste sont organisées de manière à faciliter la libre concurrence : se contenter de changer le personnel dans ces institutions ne changera guère la direction de leur action. »
Gramsci fut un enfant maladif qui, après avoir été laissé tombé au bas des escaliers par une servante à l’âge de 4 ans, devint bossu et mesurait 4 pieds 6 pouces [un peu plus de 137 cm, NdT] à l’âge adulte. Il grandit en Sardaigne, une île pauvre du sud de l’Italie. Il vécut dans une extrême souffrance la plus grande partie de sa vie, dans la pauvreté lorsque son père fut emprisonné pour corruption. Il était, physiquement, par tempérament et géographiquement, un paria. Cela lui donna une sympathie naturelle pour les marginalisés et les oubliés. Il fut troublé par le schisme entre le Sud [de l’Italie] agraire et sous-développé et le Nord, en particulier Turin, où il alla à l’université.
Les élites italiennes promurent, comme beaucoup d’autres à cette époque, l’idée de l’infériorité biologique de certaines races. Les paysans du Sud n’étaient pas pauvres parce qu’ils étaient moins bien traités que des serfs par les grands propriétaires terriens, mais parce qu’ils étaient génétiquement handicapés. Ce racisme, qui pénétrait dans la pensée de la gauche, mettait Gramsci en rage. Ses écrits sur les divisions entre le Nord industriel et le Sud agraire furent fondamentales pour Edward Saïd lorsqu’il écrivit L’Orientalisme. Comme Gramsci, il a vu comment les stéréotypes racistes diffusés par le Nord mondial étaient utilisés pour justifier les politiques d’exploitation et d’oppression du Sud mondial.
« Tout le complexe d’activités pratiques et théoriques avec lequel la classe dominante non seulement justifie et maintient sa domination, mais fait en sorte d’obtenir le consentement actif des gouvernés » doit être rendu clair pour le public, écrivit Gramsci.
La compréhension par Gramsci de la façon dont les élites dirigeantes fabriquent le consentement le sépare de Marx. Marx voyait la théorie critique comme un préliminaire à la construction d’une société égalitaire et juste. Dans la société juste, la théorie critique, comme l’État, dépérirait. Gramsci savait que les élites reproduiraient continuellement des situations et des idéologies pour maintenir leur contrôle ou le prendre. Cela exigeait la vigilance constante du théoricien révolutionnaire critique. Il y aurait une bataille sans fin des idées, celles développées par les élites pour justifier leurs privilèges et celles des théoriciens radicaux qui dénonceraient ces idées comme étant des instruments de répression et soutiendraient une alternative socialiste.
Gramsci soutenait que le facteur humain – rompant de nouveau avec Marx – est essentiel. L’Histoire, disait-il, est faite par la volonté des hommes. Elle n’est pas prédéterminée. On ne peut pas comprendre comment nous acquérons de la conscience et comment nous réalisons la révolution en ne considérant que les moyens de production. Nous ne pouvons pas, avertissait-il, prédire le cours de l’Histoire. Nous pouvons reculer tout autant qu’avancer. Nous devons, par conséquent, créer une contre-culture dynamique qui finit par rendre la révolution possible. Alors que nous battons en retraite devant l’offensive du fascisme, cela fait de Gramsci notre contemporain.
Chris Hedges
Traduit par Diane, vérifié par Wayan, relu par Hervé pour le Saker francophone
Source : http://lesakerfrancophone.fr/antonio-gramsci-et-la-bataille-contre-le-fascisme
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10155369931492317


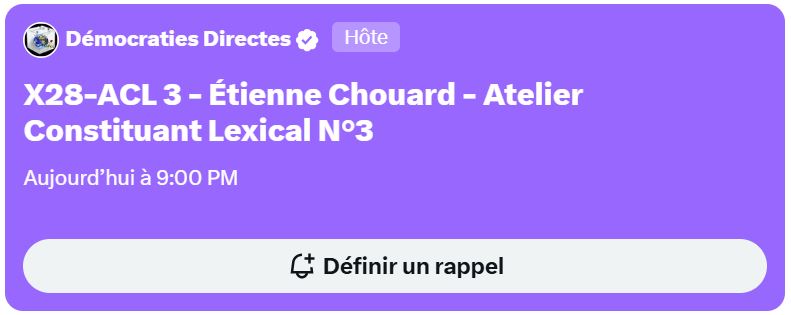
LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES (LOLF).
Je découvre un monde qui m’était totalement inconnu, très barbant, mais pas inintéressant.
Chacun a pu constater que les derniers services publiques sont entrés depuis plusieurs années maintenant dans une logique de rentabilité. On fixe des objectifs de réussite chez les profs pour valider des « projets », des objectifs d’arrestation dans un poste de gendarmerie etc.
J’ignorais l’existence de cette loi qui fixe dans le marbre cette pratique managériale étendue à tous les postes de dépenses, et voté sous un gouvernement de « gauche » sous Jospin en 2001. Et moi qui fut déçu pour lui et pour nous en 2002…
Je partage cette vidéo courte sur la LOLF, racontée sous le prisme de la pensée libérale enseignée en HEC, pépinière de nos énarques :
https://youtu.be/jbmeLu_dzyE
Sinon il y a toujours wikipedia :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_organique_relative_aux_lois_de_finances
François Ruffin arrive à l’AN :
httpv://www.youtube.com/watch?v=j5RBe6rFnrc
Merci Philippe Pascot :
Manifestement, Georges Fenech est un sacré voleur de pouvoir au service des ultra riches… Il ne faut pas manquer d’aplomb pour défendre le scandaleux « VERROU DE BERCY ».
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verrou_de_Bercy
Fraude fiscale: comment le verrou de Bercy ruine le travail des inspecteurs des impôts
« Un inspecteur des finances publiques a pris la plume pour décrire les embûches qu’il rencontre dans l’exercice de son travail au sénateur communiste Éric Bocquet. Son courrier explique que, face à leur hiérarchie, ces fonctionnaires, responsables d’enquêtes fiscales, sont seuls. Et que ce n’est pas la récente législation sur les lanceurs d’alerte ou encore le fameux article 40 du Code pénal qui peuvent les protéger des pressions. Un document qui mérite débat, quand on sait que l’évasion fiscale représente 60 à 80 milliards d’euros chaque année…
En fin d’année 2015, un inspecteur des finances publiques a pris la plume. Un an auparavant, cet homme avait rencontré un sénateur communiste, Éric Bocquet, rapporteur de la commission d’enquête parlementaire sur l’évasion fiscale. Dans cette missive de douze pages, cet inspecteur fiscal décrit, documente et argumente le « verrou de Bercy » de l’intérieur (voir encadré). L’inspecteur des finances publiques y interroge la législation existante : les statuts du fonctionnaire et donc son devoir d’obéissance, la législation récente sur les lanceurs d’alerte et enfin l’obligation pour tout fonctionnaire, selon l’article 40 du Code pénal, de dénoncer tout fait susceptible de contrevenir à la loi.
Sans motif ou ordre écrit
En France, l’ampleur de l’évasion fiscale est chiffrée dans le rapport d’Éric Bocquet : entre 60 et 80 milliards d’euros échappent ainsi aux caisses de l’État. Le travail d’enquête des inspecteurs des finances publiques est donc la base de ce qui pourrait permettre de recouvrer ces sommes. Peuvent-ils le faire et dans quelle mesure ? Répondre à cette question implique de prendre en compte plusieurs paramètres, dont les moyens humains mis à disposition de l’administration fiscale est le plus important. Mais il n’est pas seul. Que peut-il se passer lors des différentes étapes d’une enquête fiscale ? Le dossier arrivera-t-il au bout ? Si la hiérarchie décide de le refermer, l’inspecteur des finances a-t-il les moyens de s’y opposer ? Pour l’auteur du courrier à Éric Bocquet, la réponse est non. Il rappelle en effet ce que peut décider son chef de service tout au long de la procédure : « Interdire l’ouverture du dossier, ne pas permettre l’accès au dossier, ordonner l’arrêt du contrôle, interdire de notifier au contribuable la lettre lui signifiant ses manquements, ordonner l’abandon total ou partiel des redressements initialement notifiés », sans motif ou ordre écrit. Et le fonctionnaire doit obéir, « sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ». C’est au juge administratif de décider de cette légalité, et particulièrement au Conseil d’État. Or, depuis 1945, « un seul arrêt a reconnu un cas de désobéissance comme régulier », rappelle l’auteur du courrier. Cet arrêt date de mars 2012, et a donné raison à un policier municipal qui avait refusé de travailler en civil lors d’une fête à Biarritz, et s’était vu infliger un blâme par la municipalité. C’est encore peu pour encourager à ne pas se conformer à un ordre…
Protection insuffisante des lanceurs d’alerte
L’article 40 du Code pénal peut-il être invoqué ? Sauf que « toute dénonciation au procureur devra recevoir l’aval de sa hiérarchie », explique l’auteur du courrier ! Et la protection des lanceurs d’alerte, mise en œuvre par la loi de décembre 2013, est insuffisante à ses yeux : « La sanction n’est que civile (et non pas pénale) pour l’autorité qui aura en quelque sorte maltraité le lanceur d’alerte. » Enfin la loi vise l’existence de faits « constitutifs » – et non « susceptibles de constituer » – d’un crime ou d’un délit. Le potentiel lanceur d’alerte doit être lui-même en mesure de certifier la qualification pénale des faits ! Pour appuyer son argumentation, l’auteur du courrier cite le cas d’un de ses confrères, Rémy Garnier, un nom est apparu au moment de l’affaire Cahuzac. Vérificateur fiscal à Agen à la fin des années 1990, Rémy Garnier, à la retraite depuis 2010, avait croisé la route de l’ex-ministre du Budget. En 1999, il avait signifié un redressement fiscal à la coopérative France Prune, redressement en terré par le ministre du Budget de l’époque, Christian Sautter, sur intervention du député du Lot-et-Garonne Jérôme Cahuzac. Rémy Garnier avait pourtant maintenu les conclusions de son enquête fiscale. Dans « Libération », en décembre 2012, au moment où éclate l’affaire Cahuzac, il témoignait : « À partir de là, j’ai été placardisé. J’ai passé 3 ans au service du contentieux, puis 1 an aux domaines, avant un nouvel emploi fictif à la programmation du contrôle fiscal en 2006, à Agen. » Rémy Garnier a fini par obtenir gain de cause, soutenu par la CGT, après 10 ans de procédure. Mais lanceur d’alerte apparaît ainsi « très risqué et assez mal perçu »…
« Application mesurée de la loi fiscale »
Il reste l’appui de syndicats pour se défendre face à la hiérarchie. Emmanuelle Planque, syndicaliste de la CGT, reconnaît que, dans l’exercice de leur métier, les inspecteurs des finances publiques, les vérificateurs, sont amenés à prendre connaissance de situations « sensibles ». Elle indique qu’une note interne « demande l’application mesurée de la loi fiscale », qui « prenne en compte toute la situation » lorsqu’un dossier est ouvert. « Cette application mesurée est mise en œuvre par la hiérarchie. La perspective, c’est le respect de la réglementation et le recouvrement. Mais le recouvrement est mauvais », regrette-t-elle. Ce que la Cour des comptes, selon elle, a déjà relevé : Bercy ne dépose qu’un millier de plaintes par an.
Vincent Drezet, secrétaire général du syndicat Solidaires finances publiques, estime aussi que « le sentiment qui se dégage de l’article 40 du Code pénal est trop lourd. Il faudrait progresser dans ce domaine. La chaîne hiérarchique est trop longue ». Pour l’effectivité des contrôles fiscaux, le problème est selon lui plutôt dans « l’après ». C’est-à-dire au moment des recours gracieux. C’est là que les négociations interviennent et que les « redressés » jouent sur le montant des pénalités (de 40 % à 80 % du montant du redressement selon la gravité des faits). Enfin, il faut faire face à la masse de travail. Or, cette année, c’est dans le contrôle fiscal que le gouvernement a choisi de réduire les effectifs. 2 100 postes doivent être supprimés à la direction générale des finances publiques, qui en comptait, en 2015, 112 000.
L’auteur du courrier à Éric Bocquet fait quelques suggestions. Il met en avant l’exemple du Conseil national de l’inspection du travail (CNIT), instance saisie « en cas d’intervention hiérarchique ». En se basant sur ce modèle, qui consacre une forme d’indépendance des inspecteurs du travail, il suggère la création d’un « Conseil national du contrôle fiscal », « majoritairement composé de fonctionnaires non encadrants », afin de s’émanciper de toute pression hiérarchique. Ce peut être une piste de débat. À replacer dans le contexte souligné par les syndicats : celui de moyens humains à la hauteur de l’enjeu que représentent la fraude et l’évasion fiscales pour les caisses des États.
Le « verrou » de Bercy, c’est quoi ?
Dans les grands débats nationaux sur l’évasion fiscale, on parle du « verrou de Bercy ». Encore plus depuis l’affaire Cahuzac. Ce verrou, c’est le monopole accordé au ministère du Budget pour lancer des poursuites pénales en cas de fraude fiscale. En principe, dans le droit pénal, il n’y a pas besoin de plainte pour que la justice, constatant un crime ou un délit, se saisisse de l’affaire et lance enquêtes et poursuites judiciaires. Dans le cas de la fraude fiscale, les choses sont différentes. L’administration fiscale enquête elle-même, grâce à ses inspecteurs des finances publiques (ex-inspecteurs des impôts), et décide in fine si elle va engager des poursuites au regard des éléments qu’elle recueille. La justice ne peut se saisir elle-même d’une affaire de fraude fiscale. Dans bien des cas, cela peut fonctionner… Dans d’autres, ce verrou a des conséquences plus inattendues. Au moment de l’affaire Cahuzac, on a eu un exemple de l’action de ce verrou avec une démarche engagée par le ministère auprès de la Suisse, qui avait amené à la production d’un document certifiant que Jérôme Cahuzac n’avait pas de compte dans les banques de ce paradis fiscal… Ce qui s’est avéré faux quelques semaines plus tard, lorsque l’enquête judiciaire ouverte pour « blanchiment de fraude fiscale » a conduit à la mise en examen de celui qui était alors ministre du Budget. Le « blanchiment de fraude fiscale », en revanche, est un délit dont la justice peut se saisir elle-même. Mais l’établir suppose souvent d’avoir déjà établi la fraude fiscale elle-même. »
Source : L’Humanité
http://www.humanite.fr/fraude-fiscale-comment-le-verrou-de-bercy-ruine-le-travail-des-inspecteurs-602806
L’interview complète : Noam Chomsky à propos des 75 premiers jours de Trump – et bien plus encore ! 2/2
[…]
JUAN GONZÁLEZ : Vous avez parlé de Martin Luther King et de la Campagne des pauvres. Je voulais vous demander de parler d’un chapitre de votre livre Requiem for the American Dream, dans lequel vous parlez de ce célèbre Mémorandum Powell que le juge Powell a envoyé à la Chambre de commerce et ailleurs, à des grands groupes d’entreprises, en 1971 et dans lequel il déclarait que les entreprises étaient en train de perdre le contrôle de la société et qu’il fallait faire quelque chose pour contrer ces mouvements. C’est un juge de la Cour suprême qui a sorti ce type de chose. Pourriez-vous parler de l’effort des entreprises pour lutter contre le mouvement des années 60 ?
NOAM CHOMSKY : En fait, il a été nommé juge de la Cour suprême un peu plus tard. Il était alors avocat d’affaires, je pense, travaillant pour des entreprises de tabac ou de ce genre. Et il a écrit un mémorandum intéressant. Il a été transmis à la Chambre de commerce américaine. Il s’agissait d’un mémorandum interne destiné, à la base, au monde des affaires. Il a été divulgué – comme d’habitude, et c’est assez intéressant.
Il n’a pas vraiment dit que les entreprises perdaient le contrôle. Ce qu’il a dit, les entreprises sont – elles sont affaiblies par les forces massives de la gauche, qui ont pris le contrôle de tout. Il a même nommé les diables qui menaient la campagne : Ralph Nader, avec ses actions de défense des consommateurs, Herbert Marcuse, qui mobilisait les étudiants pour faire la révolution. Et il dit qu’ils ont pris le contrôle des médias, qu’ils ont pris le contrôle des universités, qu’ils contrôlent pratiquement tout le pays. Et pendant ce temps, le pauvre monde des affaires, agressé, pouvait à peine survivre sous ces attaques incroyables. C’est une image très intéressante. La rhétorique devrait être – vous devriez faire attention à la rhétorique. C’est comme un enfant gâté de 3 ans qui s’attend à tout avoir, quelqu’un lui enlève un bonbon, et il fait un caprice. La fin du monde. C’est à peu près l’image. Bien sûr, les affaires dirigeaient à peu près tout, mais pas tout. Il y avait – il y avait des tendances démocratiques dans les années 60. Le public s’était davantage engagé dans les affaires publiques et était considéré comme sérieusement menaçant. Il appelle donc le monde des affaires à se défendre contre cette attaque monstrueuse. Et il dit : « Regardez, après tout, nous sommes ceux qui avons les ressources. Nous avons les fonds. Vous savez, nous sommes les administrateurs des universités. Nous devrions être capables de nous protéger de cette agression qui balaye le mode de vie américain, les affaires, et ainsi de suite ». C’est le Mémorandum Powell. Et en effet, la leçon a été comprise, pas seulement écoutée. Il y a eu une réaction à l’activisme des années 60. Les années 60 sont souvent appelées « la période des troubles ». Le pays se civilisait. C’est extrêmement dangereux.
Non moins intéressante que le Mémorandum Powell, il y a une autre publication issue du côté opposé du spectre politique mainstream, le livre intitulé The Crisis of Democracy, publié à peu près à la même époque par la Commission trilatérale. Ce sont les internationalistes libéraux des trois principaux centres capitalistes : l’Europe, les États-Unis et le Japon. La couleur politique de ce groupe est illustrée par le fait qu’ils ont presque entièrement peuplé l’administration Carter. C’est là où on les trouve. Le rapporteur américain Samuel Huntington, professeur à Harvard, l’intellectuel libéral bien connu. Qu’est-ce que la crise de la démocratie ? À peu près la même chose que dans le Mémorandum Powell. Ils disaient qu’il y avait trop de démocratie. Les gens qui sont habituellement passifs et apathiques, comme ils sont supposés l’être, font pression avec leurs revendications dans l’arène publique, et c’est trop pour que l’État puisse y répondre. Ils n’ont pas mentionné un groupe : les intérêts des entreprises. Ça, c’est l’intérêt national. Les autres, c’étaient des intérêts particuliers, et ils appelaient à de la modération et à la démocratie. Ils étaient particulièrement préoccupés par ce qu’ils appelaient – c’est leur expression – « les institutions responsables de l’endoctrinement des jeunes » – les universités, les écoles, les églises. Ils sont supposés endoctriner les jeunes, et ils ne font pas leur travail, comme vous pouvez le constater avec tous ces jeunes qui courent en tous sens pour les droits des femmes, mettre fin à la guerre et ceci et cela. Nous devons donc avoir un meilleur endoctrinement de la jeunesse. Ils étaient également préoccupés par les médias. Ils disaient que les médias devenaient trop accusatoires. Si vous regardez ce qui s’est passé, c’est aussi peu sérieux que Powell. Ils disaient, si les médias ne se contrôlent pas eux-mêmes et ne se disciplinent pas, peut-être que l’État devra bouger et faire quelque chose à ce sujet. Ce sont les libéraux. C’est l’extrémité libérale du spectre.
Vous mettez ces deux publications côte à côte. Elles diffèrent par la rhétorique. Le Mémorandum Powell, c’est littéralement un caprice. La « Crise de la démocratie » ce sont des grands mots, modérés, vous savez, les intellectuels, et ainsi de suite. Mais le message n’est pas très différent. Il nous dit simplement que la démocratie est une menace. Il faut ramener la population à la passivité, et alors tout ira bien. En fait, Huntington, le rapporteur américain, dit, de façon nostalgique, que Truman avait pu diriger le pays avec la collaboration de quelques dirigeants d’entreprises et des avocats de Wall Street. C’était le bon vieux temps, quand la démocratie fonctionnait. Vous n’aviez pas toutes ces revendications et ainsi de suite. Et rappelez-vous, c’est l’extrémité libérale du spectre. Après, vous obtenez le Mémorandum Powell, qui est l’extrémité dure et, rhétoriquement, littéralement, une sorte de crise de caprice.
C’est dans ce cadre de pensée – qu’ils n’ont pas inventé, mais qu’ils ont énoncé – que vous obtenez la réaction néolibérale de la génération passée, qui, de tous les côtés, l’éducation, l’économie, la sape du fonctionnement de la démocratie politique, tous ces facteurs qui ont conduit à la désillusion et à la colère des gens, qui finissent par devenir des électeurs de Trump, votant pour leur ennemi de classe. Il faut se rappeler que ces personnes ont juste des préoccupations, des préoccupations très sérieuses. On l’a vu dans des révélations récentes, assez remarquables. Vous les avez vues, probablement, rapportées au fait tout à fait remarquable que la mortalité augmente chez les Américains blancs de classe moyenne, de classe moyenne inférieure, et d’âge moyen. C’est quelque chose d’inédit dans les sociétés développées. La mortalité continue de diminuer. Mais là, elle augmente. Et ses racines sont ce qu’on appelle les maladies du désespoir. Les gens n’ont pas d’espoir en l’avenir – et pour de très bonnes raisons, si vous regardez les faits en question. Les salaires réels masculins aujourd’hui sont à peu près au niveau des années 60. En 2007, au moment où il y avait beaucoup d’euphorie sur l’économie, ça marche merveilleusement bien, une grande modération, etc., les économistes qui faisaient l’éloge d’Alan Greenspan comme la plus grande figure depuis Moïse, quelque chose comme « Saint Alan », comme on l’appelait – Juste au sommet de l’euphorie, juste avant l’accident, les salaires réels des travailleurs américains étaient plus faibles qu’ils ne l’étaient en 1979, à l’époque où les expériences néolibérales ne faisaient que commencer. Cela affecte sérieusement la vie des gens. Ils ne sont pas affamés. Ils ne sont pas les plus pauvres. Vous savez, ils survivent, mais sans l’espoir, sans sentiment de dignité, de valeur, d’espoir en l’avenir, de sens dans la vie, etc. Et donc, ils réagissent de manière souvent très autodestructrice. »
[…]
http://www.les-crises.fr/linterview-complete-noam-chomsky-a-propos-des-75-premiers-jours-de-trump-et-bien-plus-encore-22/
Source : Olivier Berruyer, les-crises.fr
« JUAN GONZÁLEZ : Je voulais vous poser une autre question, venue de Melbourne, en Australie, posée par Aaron Bryla : « Le secrétaire à la Défense, James Mattis, a désigné cette semaine l’Iran comme la plus grande menace pour les États-Unis. Ma question est : Pourquoi les États-Unis s’acharnent-ils à pointer le risque de guerre avec l’Iran ? »
NOAM CHOMSKY : Cela dure depuis des années. Pendant toutes les années Obama, l’Iran était considéré comme la plus grande menace pour la paix dans le monde. Et cela se répète encore et encore. « Toutes les options sont ouvertes », l’expression d’Obama, c’est-à-dire, si nous voulons utiliser des armes nucléaires, nous le pouvons, en raison de ce terrible danger pour la paix.
En fait, nous avons – il y a quelques commentaires intéressants qu’il faut faire à ce sujet. L’un d’eux est qu’il y a aussi quelque chose qui s’appelle l’opinion mondiale. Pour le monde, quel pays représente la menace la plus grande pour la paix mondiale ? Eh bien, nous le savons à partir des sondages américains, des sondages Gallup : les États-Unis. Personne n’en est aussi près, autant en tête devant les autres menaces. Le Pakistan, en deuxième position, est beaucoup plus loin. L’Iran, à peine mentionné.
Pourquoi l’Iran est-il considéré comme la plus grande menace pour la paix mondiale ? Eh bien, nous avons une réponse faisant autorité à ce sujet, de la communauté du renseignement, qui fournit des évaluations régulières au Congrès sur la situation stratégique mondiale. Et il y a deux ans, leur rapport, bien sûr, ils discutent toujours de l’Iran. Et les rapports sont assez cohérents. Ils disent que l’Iran a des dépenses militaires très faibles, même selon les normes de la région, beaucoup plus faibles que l’Arabie saoudite, Israël et d’autres. Sa stratégie est défensive. Ils veulent dissuader les attaques suffisamment longtemps pour que la diplomatie soit accueillie favorablement. La conclusion, celle du renseignement – il y a deux ans – est : s’ils développent des armes nucléaires, ce que nous ne savons pas, mais s’ils le font, cela ferait partie de leur stratégie dissuasive. Alors, pourquoi les États-Unis et Israël sont-ils encore plus et si préoccupés par la dissuasion ? Qui est préoccupé par la dissuasion ? Ceux qui veulent utiliser la force. Ceux qui veulent être libres d’utiliser la force sont profondément préoccupés par une dissuasion potentielle. Donc, oui, l’Iran est la plus grande menace pour la paix mondiale, il pourrait dissuader notre utilisation de la force. »
AMY GOODMAN : Pensez-vous qu’il soit approprié d’employer le mot « fascisme » ou de parler de la montée du fascisme aux États-Unis ?
NOAM CHOMSKY : Eh bien, vous savez, le « fascisme » est devenu une sorte de mot effrayant. Mais beaucoup d’aspects du fascisme ne sont pas très loin sous la surface. Revenez à, disons, les années 40. Robert Brady, grand spécialiste en économie politique, spécialiste de Veblen, a écrit un livre intitulé Business as a System of Power, dans lequel il a soutenu que dans toutes les économies capitalistes d’État – les économies dites capitalistes, vraiment capitalistes d’État – des développements ont eu lieu vers certaines des structures institutionnelles du fascisme. Il ne pensait pas aux camps de concentration et aux crématoires, juste à la nature des structures institutionnelles. Et ce n’était pas tout à fait faux. Pourrions-nous aller vers ce que Bertram Gross, vers 1980, a appelé le « fascisme amical » ? Donc, des structures de type fasciste sans les crématoires, qui n’est pas le noyau, la partie nécessaire du fascisme. Ça pourrait arriver.
Nous devrions nous rappeler qu’au cours des années 30, les régimes fascistes étaient objets d’attitudes assez favorables en Occident. Mussolini était appelé, par Roosevelt, « cet admirable gentleman italien », et il a peut-être été trompé par Hitler. En 1932, l’un des principaux magazines d’affaires – je pense Forbes – avait un article à la Une, un article dont le titre était « Les Ritals se dé-ritalisent eux-mêmes (The wops are unwopping themselves) ». Enfin, les Italiens agissent ensemble sous Mussolini. Les trains arrivaient à l’heure, ce genre de choses. Le milieu des affaires était très favorable. Jusqu’à la fin des années 30, le Département d’État des États-Unis – on ne peut pas dire qu’il était « favorable » à Hitler, mais disait que nous devrions tolérer Hitler, parce que c’était un modéré qui se trouvait entre les extrêmes de droite et de gauche. Nous avons déjà entendu ça. Il a détruit le mouvement ouvrier, ce qui est une bonne chose ; il s’est débarrassé des communistes, des socialistes, bien. Il y a des éléments de droite, des éléments ultranationalistes à l’autre extrême. Il les contrôle. Nous devrions donc avoir une attitude tolérante envers lui. Le cas le plus intéressant est George Kennan, grand diplomate vénéré. Il était consul américain à Berlin. Et aussi tard qu’en 1941, il écrivait toujours des commentaires assez favorables à propos d’Hitler, disant qu’on ne devrait pas être trop sévère, il y a de bonnes choses là-dedans. Nous associons maintenant le fascisme aux histoires d’horreur réelles de l’Holocauste et ainsi de suite. Mais ce n’est pas la façon dont le fascisme a été considéré. Il était encore plus fortement soutenu par le monde des affaires britannique. Ils pourraient faire affaire avec lui. Il y avait eu des régimes – en grande partie gérés par les entreprises, qui étaient – il y avait beaucoup de soutien en Allemagne, en raison de … il a créé quelque chose comme le plein emploi par l’endettement et les dépenses militaires, et il a gagné des victoires.
Pourrions-nous aller dans cette direction ? Cela a été reconnu. Vous pouvez le lire tout de suite dans les revues mainstream, qui se demandent : « Est-ce que les éléments du « fascisme amical » de Gross seront mis en place dans un pays comme les États-Unis ? » Et ce n’est pas nouveau. Il y a peut-être 10 ans, Fritz Stern, un des principaux historiens allemands de l’Allemagne, a publié un article intéressant dans Foreign Affairs, une grande revue de l’establishment. Il s’appelait « Descente dans la Barbarie ». Et il discutait de la façon dont l’Allemagne s’est dégradée depuis ce qui était, en fait, peut-être, le pic de la civilisation occidentale dans les années 20, jusque dans les bas-fonds de l’histoire 10 ans plus tard. Et son article a été écrit avec un œil sur les États-Unis. C’était sous l’administration Bush, pas aujourd’hui. Il disait – il ne disait pas que nous sommes – que Bush est Hitler, il ne disait pas ça. Mais il disait qu’il y avait des signes auxquels nous devrions faire attention. Il a dit : « Je me préoccupe parfois du pays qui m’a sauvé du fascisme, quand je vois ce qui se passe ».
La presse française se transforme insensiblement, pour se rapprocher progressivement de (l’idée qu’on se fait de) la presse de Corée du Nord.
Illustration :
1) DANS LÉMÉDIA : «France info plus» réalise un clip de propagande pour Macron (avec nos impôts) :
https://lebonsens.media/2017/06/25/france-info-realise-clip-de-propagande-macron/
http://www.francetvinfo.fr/politique/emmanuel-macron/conseil-europeen-la-macronmania-a-bruxelles_2251365.html
2) DANS LA RÉALITÉ : Emmanuel Macron prend une déculottée au sommet européen :
https://www.contrepoints.org/2017/06/25/293023-emmanuel-macron-deculottee-sommet-europeen
Extrait de l’article sur Gramsci (ci-dessus) :
Oui mais comment prendre plaisir individuellement à s’organiser collectivement ?
Comment faire aimer la véritable liberté, celle consistant pour chacun à décider avec autrui des conditions de sa propre vie en société ?
Les Etats-Unis achètent des hommes politiques français !
Les Etats-Unis paient des hommes politiques français pour faire la promotion de la construction européenne !
D’octobre 2013 à janvier 2016, la ministre des Armées Sylvie Goulard était payée 10 000 dollars par mois par un organisme américain chargé de faire la promotion de la construction européenne !
Lisez cet article ahurissant :
Sylvie Goulard a été rémunérée pendant deux ans par un think tank américain.
Sibyllin, Le Canard enchaîné évoquait cette semaine des « ménages » quand elle était eurodéputée. Sur sa déclaration d’intérêts au Parlement de Strasbourg, Sylvie Goulard mentionne d’elle-même un poste de « conseiller spécial » auprès de l’ « Institut Berggruen » pour des revenus « supérieurs à 10.000 euros mensuels ».
Selon nos sources, via sa propre société de conseil, elle a été rémunérée par cet institut d’octobre 2013 à janvier 2016. « Tout était déclaré et ces sommes étaient brutes », insiste un proche de l’ancienne ministre.
Créé et financé par Nicolas Berggruen, fils du richissime marchand d’art Heinz Berggruen, l’institut Berggruen, dont le siège est en Californie, est une organisation à but non lucratif chargée de « réfléchir aux systèmes de gouvernance ». Sylvie Goulard, qui se destinait au Quai d’Orsay, a-t-elle été bien inspirée d’être appointée par cet organisme pendant plus de deux ans, pour près de 300.000 dollars ? « Le Berggruen fait la promotion de l’Union européenne et contribue au débat d’idées », jure-t-elle, parlant « d’un non-sujet »… à plus de 10.000 dollars par mois.
Mais pourquoi Sylvie Goulard a-t-elle quitté le gouvernement?
http://www.lejdd.fr/politique/mais-pourquoi-sylvie-goulard-a-t-elle-quitte-le-gouvernement-3371234
Rappels (pour ceux qui débarquent 🙂 ) :
httpv://www.youtube.com/watch?v=QHJP-jmhfJ8
Et quand les candidats MENTENT au dernier degré pour être élus, ce qui est TOUJOURS le cas, RIEN ne permet aux électeurs de les PUNIR !
Les honteux RENIEMENTS de Macron commencent, d’abord sur la prétendue moralisation de la vie publique :
Élection, piège à cons.
Nous ne sommes pas en démocratie.
Nous n’avons pas de constitution.
#PasDeDémocratieSansTirageAuSort
#PasDeDémocratieSansCitoyensConstituants
Un très bon papier de Coralie Delaume (avec Steve Ohana) :
Premier sommet européen de Macron : le dessous des cartes
À l’occasion de son premier sommet européen à Bruxelles, Emmanuel Macron a annoncé vouloir relancer une Europe de la défense mais n’a pu imposer les demandes françaises notamment en matière commerciale. L’analyse de Coralie Delaume et Steve Ohana.
-Coralie DELAUME est essayiste, co-auteur de La fin de l’Union européenne (Michalon, 2017) et animatrice du site L’arène nue.
-Steve OHANA est professeur de finances à l’ESCP Europe et auteur de Désobéir pour sauver l’Europe (Max Milo, 2013).
Jouez hautbois, résonnez musettes: il est né le divin enfant. «Le Sauveur» de l’Europe, celui qui plonge ses pairs dans un «bain de jouvence collectif», si l’on en croit le clip halluciné réalisé par France Info pour introduire le Conseil européen des 22 et 23 juin. Les premiers pas d’Emmanuel Macron sur la scène européenne font également jaser d’aise Bernard Guetta, commentateur zélé de l’actualité européenne («ça bouge en Europe!» nous explique-t-il sur France Inter). Une fois n’est pas coutume, le grand connivent de référence se montre cette fois plus prudent. Le Monde concède en effet à la fin du sommet: «La méthode Macron a quand même buté sur la complexe réalité bruxelloise. Le président français (…) n’est pas parvenu à imposer complètement son point de vue sur les questions commerciales».
Le contrôle des investissements chinois
Pas complètement? C’est le moins que l’on puisse dire. Sur la question du contrôle des acquisitions chinoises en Europe, Macron a fait un bide. Il s’est heurté à une levée de boucliers qui témoigne crûment de la rémanence d’intérêts nationaux contradictoires. Le Président français souhaitait que ces investissements soient «surveillés» par la Commission, de manière à éviter la prise de contrôle, par des firmes chinoises, de fleurons technologiques européens. Ils ne seront finalement «qu’analysés» comme l’indique la déclaration finale du Conseil datée en date du 23 juin. La même déclaration demande à la Commission de réfléchir à «des instruments de défense commerciale modernes» puis de veiller à leur mise en œuvre «par des mesures d’exécution non législatives». Sans disposition réglementaire en somme, sans encadrement ni contrainte. Par la magie donc? Par la télépathie? Par la prière?…
=====================
La France ne peut pas se rendre complice du martyr austéritaire imposé aux pays méditerranéens de l’UE et espérer ensuite que ces pays fassent front commun avec elle lors des sommets européens.
=====================
Il faut dire que la France n’avait sur ce dossier que peu d’alliés. Un certain nombre de pays de l’Union sont traditionnellement libres-échangistes. […]
Lire la suite :

http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2017/06/26/31002-20170626ARTFIG00198-premier-sommet-europeen-de-macron-le-dessous-des-cartes.php
Source : Le Figaro
« Le rêve européen » (des multinationales et des banques) commence à se réaliser, en Grèce juste avant la France :
Bons d’achat ou aides en nature ? La Commission et Athènes débattent de la gestion courante de la pauvreté
Alors que les créanciers d’Athènes sont parvenus à un compromis pour débloquer un nouveau « plan d’aide » tout en temporisant une fois encore sur la question de l’allègement de la dette, un autre débat de fond agite Bruxelles loin des caméras : faut-il distribuer des bons d’alimentation ou bien de la nourriture pour gérer la pauvreté grandissante en Grèce (et ailleurs) ?
Comme le rapporte EurActiv, plusieurs États membres ont demandé à la Commission européenne l’autorisation de donner des bons d’achat aux pauvres, solution jugée moins coûteuse et plus digne que la distribution de nourriture et de vêtements. Une requête exprimée depuis 2014, notamment par la Grèce et la Roumanie. [···]
Lire la suite :

https://ruptures-presse.fr/perles/bons-dachat-ou-aides-en-nature-la-commission-et-athenes-debattent-de-la-gestion-courante-de-la-pauvrete/
Abonnez-vous à Ruptures, c’est un bon média et il a besoin de nous :
https://ruptures-presse.fr/abonnement/
AVANT LES ELECTIONS:
-Valls refusé sur les listes de Macron et sous la menace d’une expulsion du PS
http://www.lecho.be/dossier/presidentiellesfrancaises2017/Valls-refuse-sur-les-listes-de-Macron-et-sous-la-menace-d-une-expulsion-du-PS/9892619?ckc=1&ts=1498580731
PENDANT LES ELECTIONS:
-Pour Valls, « Macron est méchant » et « n’a pas de limites »
http://www.lepoint.fr/legislatives/pour-valls-macron-est-mechant-et-n-a-pas-de-limites-14-05-2017-2127245_3408.php
APRES LES ELECTIONS:
-Manuel Valls rejoint la République en Marche à l’Assemblée
https://www.lesechos.fr/elections/socialiste/030412228874-manuel-valls-quitte-le-parti-socialiste-2097777.php#xtor=RSS37
Encore une remarquable synthèse de Bruno Guigue :
Merci pour cette conversation, M. Poutine
C’est un événement. Pendant quatre heures, les Français ont pu regarder sur France 3 les “Conversations avec M. Poutine” du cinéaste Oliver Stone. Comment ce documentaire de qualité, où la parole est longuement donnée au président de la Fédération de Russie, a-t-il pu passer entre les mailles du filet ? Comment a-t-il pu échapper à la vigilance de nos censeurs qui, au nom des droits de l’homme, nous infligent leur propagande en guise d’information ? Mystère, mais ne boudons pas notre plaisir.
Oliver Stone étant citoyen des USA, ces entretiens filmés entre juin 2015 et février 2017 portent pour l’essentiel sur les tensions géopolitiques entre Moscou et Washington. Lorsque le cinéaste lui demande, en février 2017, si l’élection d’un nouveau président américain est susceptible de changer quelque chose, Vladimir Poutine répond : “presque rien”. C’est “la bureaucratie”, explique-t-il, qui exerce le pouvoir à Washington, et cette bureaucratie est inamovible. En effet. A peine élu, Donald Trump est devenu l’otage de “l’Etat profond”.
L’intérêt de ces entretiens est qu’ils mettent en perspective la pesanteur du “deep State”, sa dimension structurelle. Les Russes ont le sens de l’histoire, et c’est pourquoi M. Poutine, pour comprendre le monde actuel, évoque l’usage de l’arme atomique contre Hiroshima et Nagasaki (août 1945). Privé de toute justification militaire, ce crime de masse a plongé l’humanité dans l’ère nucléaire. Pour Moscou, c’est le moment-clé de l’histoire contemporaine, celui où tout bascule. En faisant peser la menace d’une destruction totale, Washington a pris une responsabilité gravissime.
La course aux armements n’est pas une invention moscovite. Dans les années 1980, une URSS fossilisée s’était laissé piéger par cette compétition mortifère, précipitant sa chute. Dans les années 2000, c’est encore Washington qui suspend les discussions sur les armes anti-missiles et s’empresse d’élargir l’OTAN jusqu’aux frontières de la Russie. Que dirait-on à Washington si la Russie nouait une alliance militaire avec le Mexique et le Canada ? Quand Oliver Stone évoque l’affaire – aujourd’hui oubliée – du destroyer US qui s’était dangereusement approché de la Crimée, M. Poutine demande ce que ce navire pouvait bien faire dans les parages. Mais la propagande a l’art d’inverser les rôles, et elle parla de provocation russe.
Passionnante mise en perspective, aussi, à propos de la lutte contre le terrorisme. La seconde guerre de Tchétchénie (1999-2009) fut déclenchée par l’agression djihadiste contre le Daghestan russe. Or les USA y ont joué un rôle particulièrement trouble. “Les Américains nous soutiennent en paroles contre le terrorisme, mais en réalité ils l’utilisent pour fragiliser notre situation intérieure”, dit le président russe. En 1980, Brzezinski tenait déjà les combattants du djihad antisoviétique pour des “Freedom Fighters”. Dans le Caucase, en Syrie, en Libye, la CIA a armé, financé et manipulé les desperados de l’islamisme radical. La Russie soviétique, puis post-soviétique, les a toujours combattus.
Chaque fois que son interlocuteur (qui n’est pas dupe) mentionne la rhétorique occidentale sur la menace russe, M. Poutine demeure le plus souvent impassible, esquissant parfois un sourire narquois. A Moscou, on l’a compris depuis longtemps : les Américains font le contraire de ce qu’ils disent et ils vous accusent de faire ce qu’ils font eux-mêmes. L’accusation d’ingérence russe dans l’élection présidentielle américaine (2016) est un véritable cas d’école. Lorsque la présidente du conseil national démocrate démissionna à la suite de la publication d’emails compromettants, Julian Assange a nié que sa source fût russe. Mais l’establishment a quand même pointé un doigt vengeur vers Moscou.
Car il fallait un coupable, et il ne pouvait être que moscovite. “Dans cette affaire, souligne M. Poutine, les Américains prétextent une intervention extérieure pour régler leur problèmes intérieurs”. Pour les USA, la Russie est à la fois un repoussoir et un bouc-émissaire. Un repoussoir, quand on brandit la prétendue “menace russe” pour contraindre les Européens à faire bloc derrière les USA. Un bouc-émissaire, quand on attribue à Moscou la responsabilité de sa propre incurie. Tout se passe comme si l’affrontement idéologique hérité de la “Guerre froide” avait fourni un prêt-à-penser inusable. Le manichéisme américain peint le monde en noir et blanc, et Moscou sera toujours la source du mal.
L’accusation d’ingérence russe dans la démocratie américaine est d’autant plus ahurissante que les dirigeants US, eux, interviennent ouvertement en Russie. Lors de la campagne présidentielle russe de 2012, Victoria Nuland, secrétaire d’Etat adjoint US, a déclaré : “Nous travaillons à l’intérieur et à l’extérieur de la Russie avec les militants russes qui souhaitent renforcer l’état de droit et la liberté de la presse, avec les LGBT”. Que dirait-on si le gouvernement russe “travaillait” aux USA avec des militants américains qui combattent le gouvernement des Etats-Unis ? Mais cette hypothèse est invraisemblable, car comme le dit M. Poutine, “nous ne nous mêlons pas des affaires intérieures des autres pays”.
Respect de la souveraineté des Etats et refus de l’ingérence étrangère, ces deux principes (qui en réalité n’en font qu’un) définissent l’approche russe des relations internationales. Si Moscou intervient en Syrie, c’est à la demande d’un gouvernement légitime en proie à l’invasion étrangère et au terrorisme de masse. Si la Russie a accueilli la Crimée, c’est parce que le peuple de Crimée l’a voulu expressément, au terme d’un référendum organisé par le Parlement de Crimée. Et cette sécession de la péninsule n’eût peut-être pas vu le jour si un putsch des nationalistes ukrainiens soutenu par la CIA, en février 2014, n’avait renversé le pouvoir légalement issu des urnes à Kiev.
Mais il est vrai que la Russie, elle, ne fomente pas de coup d’Etat avec l’aide de néo-nazis. Elle ne finance pas d’ONG pour déstabiliser les autres pays au nom des droits de l’homme, elle n’envoie pas ses troupes pour y instaurer la “démocratie”, et elle ne bombarde pas les populations pour “punir” les dirigeants qui lui déplaisent. Elle ne provoque pas la guerre civile pour s’approprier les ressources des autres pays, elle ne finance, n’arme ou ne manipule aucune organisation terroriste. Que l’on sache, la Russie n’a jamais utilisé l’arme atomique, ses services secrets n’ont jamais créé de “centres de torture” à l’étranger, et elle n’envoie pas ses drones tueurs dans une douzaine de pays. Elle ne couvre pas les océans de ses porte-avions, elle a 5 bases militaires à l’étranger quand les USA en ont 725, et son budget militaire représente 8% de celui du Pentagone. La Russie telle qu’elle est gagne à être connue.
Merci, M. Poutine, pour cette conversation.
Bruno Guigue
https://www.legrandsoir.info/merci-pour-cette-conversation-m-poutine.html
L’esprit du McCarthysme est bien visible dans les attaques contre les « Conversations avec Poutine » d’Oliver Stone
Par Jeremy Kuzmarov – Le 26 juin 2017 – Source Huffington Post
Après la diffusion de la série d’entretiens entre Oliver Stone et le président russe Vladimir Poutine, les experts médiatiques ont commencé à attaquer M. Stone en termes virulents qui en disent beaucoup sur l’incivilité et l’anti-intellectualisme répandus dans notre culture politique.
Plutôt que de fournir une analyse ou une évaluation équilibrée qui pèserait les points forts et les points faibles du documentaire, les critiques ont qualifié Stone, un cinéaste réputé et vétéran militaire, d’« admirateur de dictateurs » (Joel Sucher, The Observer), de « complice des mensonges de Poutine » ( Emily Tamkin, Foreign Policy), de « conspirationniste » et de « lèche bottes dérangé » comme Alexander Nazaryan a traité Stone dans un violent article de Newsweek.
Aussi méprisant, le « journal de référence », The New York Times, a publié un article, le 25 juin, écrit par Masha Gessen et intitulé « Comment Poutine a séduit Oliver Stone et Trump ». Le ton de l’article rappelle celui utilisé contre les gauchistes séduits par Staline et l’idéal d’un paradis utopique ouvrier sous le communisme, dans les années 1930 et 1940.
Bien sûr, la critique de Gessen sur le film de Stone est complètement et totalement plate. Il dit que les échanges entre Poutine et Stone sont ternes et il se réfère à Stone en termes moqueurs comme « intervieweur inepte », ce qui n’est pas du tout vrai. Stone est un homme sympathique qui s’adapte à ses interlocuteurs et les met à l’aise, ce qui fait qu’ils sont sincères.
Gessen poursuit en suggérant que Stone, comme Donald Trump, aurait une « admiration sans bornes » pour Poutine, une allégation qui n’est nullement justifiée. M. Trump, par exemple, a convenu que Poutine était un tueur dans un échange célèbre sur Fox News, mais a déclaré que les États-Unis n’étaient eux-mêmes pas innocents. Ce genre de remarque ne montre pas vraiment une « admiration sans bornes ». Pas plus que les efforts de Stone pour donner à Poutine l’occasion d’expliquer son point de vue dans un style qui rappelle les interviews d’Erroll Morris avec Robert S. McNamara dans The Fog of War, où le jugement est laissé au spectateur.
Stone, parfois, pose des questions critiques, par exemple en ce qui concerne la contradiction de M. Poutine qui a exprimé de l’admiration pour Edward Snowden alors qu’il met en place ses propres lois « Big Brother ».
Gessen suggère que les images de Poutine dans ses bureaux ou en train de jouer au hockey sur glace font partie du panégyrique de Stone. L’intention principale semble plutôt être de montrer la vie d’un président russe et de contrer les stéréotypes sur Poutine qui inondent les médias occidentaux. Étant donné que les compétences de hockey de Poutine sont plutôt moyennes, si Stone cherchait à créer un culte de superman, ces scènes échouent complètement.
À un moment, Mme Gessen affirme que Poutine et Stone partagent une hostilité mutuelle envers les musulmans. Alors que Stone a simplement souligné le double standard de la politique étrangère étasunienne qui soutient les islamistes en Tchétchénie alors qu’elle les combat en Afghanistan et en Irak. À un autre moment, Stone convient avec Poutine de la folie de la politique de l’administration Reagan d’avoir soutenu Ben Laden et d’autres fondamentalistes extrémistes pendant la guerre antisoviétique en Afghanistan. Nulle part, Stone ne fait preuve d’islamophobie.
Enfin, Gessen dépeint Stone et Poutine comme des apologistes de Staline, alors que la réponse de Poutine à la question sur Staline reflète une certaine admiration dans les milieux nationalistes en raison du rôle de Staline dans la défaite du nazisme, son rôle dans le développement industriel de la Russie et l’affirmation du rôle de la Russie en tant que superpuissance. Ce n’est pas une position tout à fait irrationnelle si l’on considère que Poutine reconnait aussi le côté obscur du règne de Staline et l’importance de se souvenir des victimes du Goulag.
On remarquera que les pères fondateurs et les héros nationalistes étasuniens ont également du sang sur les mains, du massacre des Indiens à l’esclavage et aux guerres illégales, pourtant, beaucoup d’Américains les admirent toujours. Stone souligne également l’absence du corps de Léon Trotsky au Kremlin et discute du rôle de Staline dans le meurtre de Trotsky, montrant qu’il connait bien l’histoire de l’Union soviétique, alors qu’il n’est pas lui-même un apologiste des crimes de « l’oncle Joe ».
Personnellement, j’ai trouvé le film de Stone intéressant et une bonne suite de son Untold History of the United States and Snowden [L’histoire cachée des États-Unis et de Snowden]. Il a dépeint un portrait de M. Poutine que je n’avais jamais vu auparavant et a humanisé un homme vilipendé dans tous les médias occidentaux. M. Poutine est également informé de la politique américaine et pragmatique dans ses efforts pour résoudre certains des problèmes urgents de la Russie, hérités de l’ère Eltsine.
Le documentaire montre bien comment l’expansion de l’OTAN aux frontières russes (en violation d’une promesse faite à Mikhaïl Gorbatchev par l’administration George H. W. Bush), l’ingérence des États-Unis en Géorgie, en Ukraine et en Tchétchénie et l’installation d’armement accompagnées d’exercices militaires à proximité la frontière russe contribuent à créer une dangereuse nouvelle Guerre froide et une course aux armements.
La plupart des grands théoriciens militaires, de Karl Von Clausewitz à Sun Tsu, ont souligné l’importance de « connaître son ennemi ». C’est ce qui fait que les attaques de gens comme Gessen dans The New York Times et Nazaryan dans Newsweek sont infantiles et finalement nuisibles dans une perspective de sécurité nationale étasunienne.
Le film de Stone est important précisément parce qu’il offre une occasion de mieux comprendre la perspective russe sur la politique étrangère et les conflits américains en Ukraine et en Syrie – que nous soyons ou pas d’accord avec cette perspective.
En se forgeant une meilleure compréhension, nous pouvons à notre tour développer une politique étrangère plus intelligente qui diminuerait les possibilités d’antagonisme et favoriserait la perspective d’une coopération, ce que Poutine dit vouloir.
Cependant, à en juger par la réaction au film de Stone, nous semblons plutôt voués à répéter l’histoire de la première Guerre froide et de l’ère McCarthy, dont l’esprit reste vivant et bien visible dans nos journaux intellectuels libéraux.
Jeremy Kuzmarov enseigne l’histoire à l’Université de Tulsa et est l’auteur du prochain livre, avec John Marciano, The Russians are Coming, Again : What We Did Not Learn About the First Cold War [Les Russes arrivent, encore : ce que nous n’avons pas appris de la première guerre froide].
Traduit par Wayan, relu par Catherine pour le Saker Francophone
http://lesakerfrancophone.fr/lesprit-du-mccarthysme-est-bien-visible-dans-les-attaques-contre-les-conversations-avec-poutine-doliver-stone
Poutine, l’Ukraine et ce que les Américains en savent
Source : les-crises.fr, Olivier Berruyer, http://www.les-crises.fr/poutine-lukraine-et-ce-que-les-americains-en-savent-par-robert-parry/