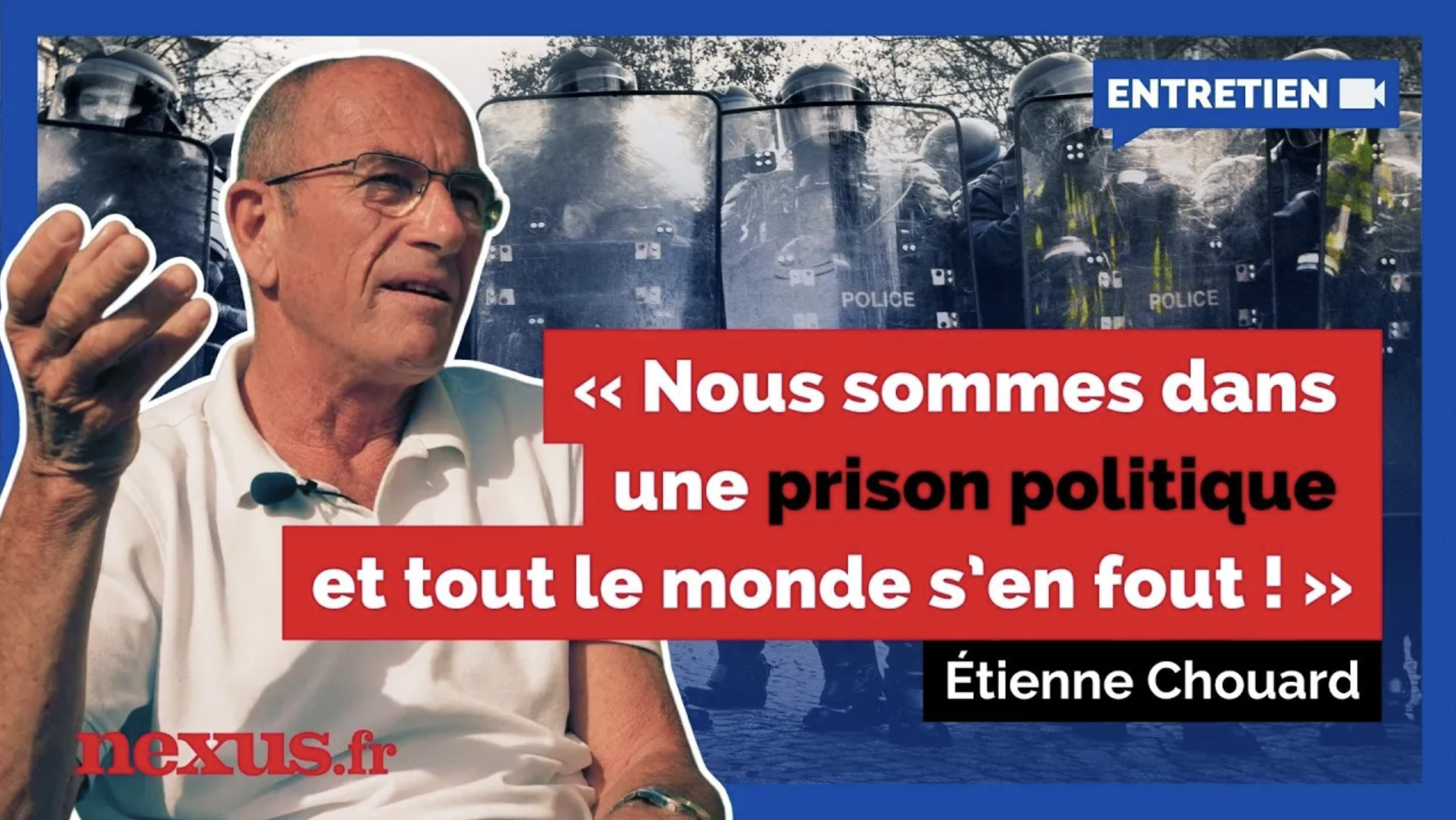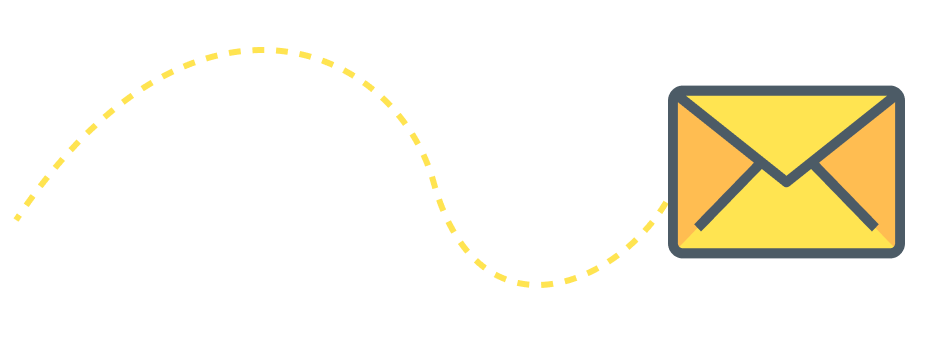Articles du blog
Les derniers articles du blog
« Le déclin et la chute de l’empire Cochrane », un nouveau livre essentiel de Peter C Gøtzsche traduit en français par Ronald Mazzoleni
Chers amis, Ronald Mazzoleni, ami belge, médecin et fidèle lecteur de ce blog depuis bien longtemps, a fait l’immense effort de traduire très soigneusement le dernier livre de Peter C Gøtzsche : « Le déclin et la chute de l’empire Cochrane ». C’est formidable de rendre disponible aux francophones ce livre important (sur la corruption tragique d’une grande institution scientifique de référence), et je remercie Ronald du fond du coeur. Nous avons contacté Peter, pour lui demander l’autorisation de…
Étienne Chouard : « Nous sommes dans une prison politique et tout le monde s’en fout ! » (entretien avec Nexus)
https://www.youtube.com/watch?v=H3lWY9YOPlc « Errements de la démocratie, crise des institutions, Constitution de 1958 « truquée », 3e guerre mondiale. Dans un entretien de 80 minutes qu’il a accordé au magazine Nexus, Étienne Chouard parle sans masque. Cet ancien professeur de droit et d’économie s’est surtout fait connaître lors de la crise des gilets jaunes en 2018 avec une idée en tête : convaincre la population de la nécessité d’un RIC, un référendum d’initiative citoyenne. Étienne…
Rendez-vous ce soir, avec Nicolas Bouvier, pour l’anniversaire du NON de 2005 contre l’anticonstitution européenne
https://www.youtube.com/watch?v=hRdT_-2qYBo
Tous les articles du blog
Format grille – Format articles complets
L’Union européenne veut la destruction du droit du travail en France, et le P$ lui obéira si les salariés ne bloquent pas tout pour l’empêcher
Le gouvernement impose au pays, et sans même passer par le Parlement (49.3), une loi qu’il n’avait pas annoncée dans son programme (c’est donc un tour de brigands) et qui supprime carrément la protection des salariés par le droit du travail ; c’est littéralement tyrannique : l’exécutif fait la loi ; cette confiscation du pouvoir législatif par ceux qui dirigent la police et l’armée (confiscation qu’on appelle confusion des pouvoirs) est la hantise principale de tous les penseurs qui cherchent à protéger les sociétés des abus de pouvoir, depuis toujours.
La régression principale, celle qu’il faut bien avoir repérée pour comprendre à la fois l’ampleur du danger social et le motif légitime pour une grève générale illimitée, c’est la possibilité prévue par cette loi scélérate, pour des accords locaux (accords de branche ou accords d’entreprise), d’imposer aux salariés des règles moins favorables que celles que prévoit la loi en général (ce qui est carrément une inversion dans la hiérarchie des normes), ce qui veut dire en clair que la protection de la loi disparaît. Les digues sautent, on va redécouvrir l’hubris des patrons, déjà bien éprouvée au 19ème siècle.
D’où vient cette loi El Khomery ? Directement des consignes (explicites) de la prétendue « Union européenne », https://youtu.be/E9bHcF9ckIU. L’UE aujourd’hui veut la disparition du droit du travail, pour baisser les salaires et hausser les profits. Ensuite, les gouvernements, comme de vils bourreaux, ne font qu’exécuter les ordres des technocrates — non élus et hors contrôle — de l’UE.
Le gouvernement dément qu’il obéit à l’UE ; Junker l’avoue pourtant tout net ; voyez ce bon papier de Coralie Delaume :
L’Union européenne assume : la loi El Khomri, c’est elle
Par Coralie Delaume

FIGAROVOX/DECRYPTAGE – Jean-Claude Juncker a déclaré que « la réforme du droit du travail voulue et imposée par le gouvernement Valls est le minimum de ce qu’il faut faire ». Pour Coralie Delaume, l’économie de notre pays est depuis longtemps l’application des orientations de l’Union européenne.
Coralie Delaume est journaliste. Elle a notamment publié Europe. Les Etats désunis (Michalon, 2014). Découvrez ses chroniques sur son blog.
La loi El Khomri est un produit d’importation made in Union européenne (voir explications détaillées ici). Les « Grandes orientations de politique économique » (GOPÉ), dont l’existence est posée par les traités, et le « Programme national de réformes » (PNR), qui s’inscrit lui-même dans le cadre de la stratégie Europe 2020 « pour une croissance économique intelligente, durable et inclusive » (tsoin-tsoin), prescrivent à de nombreux pays et depuis longtemps le malthusianisme budgétaire et la modération salariale.
Dans même temps, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union (CJUE), n’a de cesse de promouvoir l’ordre concurrentiel et la dérégulation. Surtout, au travers d’arrêts à l’impact décisif mais mal connus du grand public, tels, par exemple, les arrêts Laval et Viking de 2007, elle œuvre à saper le droit du travail dans les pays membres, et à affaiblir la capacité de négociation des salariés dans les conflits sociaux.
Enfin, l’appartenance à l’euro interdit toute dépréciation de la monnaie. Dès lors, elle conduit les pays de l’eurozone non à renforcer leur coopération, non à développer entre eux la solidarité, mais à se mener les uns aux autres une véritable « guerre de la désinflation salariale », selon une expression de Steve Ohana. Pour livrer cette guerre, ajoute l’économiste, « la France ne semble plus avoir d’autre choix que de s’engager plus franchement dans des politiques de dévaluation interne, non plus seulement via la baisse de la fiscalité sur le travail, mais via la compression des salaires eux-mêmes ( …) c’est l’option qui sous-tend la loi El Khomri ».
Face au caractère scandaleux de l’affaire, face à la blessure d’orgueil que ne peut manquer d’occasionner, chez n’importe quel peuple encore un peu conscient de lui-même, l’idée d’être « gouvernancé » depuis Bruxelles, Francfort ou Luxembourg au lieu d’être normalement gouverné par les dirigeants qu’il a élus, on pourrait s’attendre à ce que les « Européens de métier » fassent profil bas. Par décence
Face au caractère scandaleux de l’affaire, face à la blessure d’orgueil que ne peut manquer d’occasionner, chez n’importe quel peuple encore un peu conscient de lui-même, l’idée d’être « gouvernancé » depuis Bruxelles, Francfort ou Luxembourg au lieu d’être normalement gouverné par les dirigeants qu’il a élus, on pourrait s’attendre à ce que les « Européens de métier » fassent profil bas. Par décence. Par souci de ne pas attiser la colère. Parce que le fait de bénéficier de pouvoirs exorbitants dont ils ne doivent la titulature qu’à une série d’erreurs d’aiguillage de l’Histoire, devrait suffire à les contenter.
Mais non. Jouir en silence du confort sans risque qu’offre le séjour dans cet Olympe grisâtre depuis lequel ils nous surplombent n’est pas assez bien pour ces encravatés. Il faut encore qu’ils portent en bandoulière leur bonheur niais d’être là où ils sont, et qu’ils l’ouvrent à tout propos. Sans se rendre compte qu’à la fin, « les gens » commencent à comprendre. Et à s’agacer.
L’ouvrir très grand, c’est l’une des choses que Jean-Claude – « il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens » – Juncker fait le mieux. Aussi a‑t‑il trouvé judicieux, dans un récent entretien au journal Le Monde de formuler ces quelques regrets : « à voir les réactions que suscite la ‘loi travail’, je n’ose pas m’imaginer quelle aurait été la réaction de la rue, à Paris ou à Marseille, si votre pays avait dû appliquer des réformes comme celles qui ont été imposées aux Grecs ». Ah, ces Français rétifs ! Comme il est dommage de ne pouvoir vitrifier leur économie avec cette même brutalité joyeuse dont on à usé contre l’économie grecque !
Ceci dit, rien n’est jamais perdu pour qui sait s’armer de patience. Durant l’été 2015, au cœur de la « crise grecque », le ministre hellène Yanis Varoufakis avait donné quelques clés pour comprendre la dureté des créanciers vis-à-vis de son pays. Selon lui, la véritable cible des « Européens » (et de l’Allemagne, plus encore que de l’Europe institutionnelle) était en fait l’Hexagone. « La Grèce est un laboratoire de l’austérité, où le mémorandum est expérimenté avant d’être exporté. La crainte du Grexit vise à faire tomber les résistances françaises, ni plus ni moins », avait-il osé. Pour lui, les cibles terminales étaient l’État-providence et le droit du travail français.
Pour Jean-Claude Juncker, il se trouve que « la réforme du droit du travail voulue et imposée par le gouvernement Valls est le minimum de ce qu’il faut faire ». Le minimum seulement.
Or pour Jean-Claude Juncker, il se trouve que « la réforme du droit du travail voulue et imposée par le gouvernement Valls est le minimum de ce qu’il faut faire ». Le minimum seulement. Et, avec un peu de chance, de constance et d’audace, une simple étape vers ce rêve éveillé que constitue l’idéal grec !
Autre grand bavard : Pierre Moscovici. Lui assume mieux encore que Juncker, et ses insinuations n’en sont plus. Ce sont même des aveux : oui, l’Union européenne veut la loi El Khomri. Dans un entretien publié ici le 18 mai soit, précisément, le jour de la parution des recommandations adressées par la Commission à la France dans le cadre du « semestre européen », le commissaire aux Affaires économiques faisait connaître sa volonté. S’il minaudait tout d’abord en prétendant qu’il ne lui appartenait pas de « juger » la Loi travail, il rappelait toutefois qu’il lui appartenait bien de l’exiger : « Tout ce que je peux dire, c’est que la réforme est indispensable et qu’y renoncer serait une erreur lourde (…) les Français ont souvent le même réflexe quand une réforme se présente : celui de s’y opposer. Cela ne signifie pas que la réforme n’est pas nécessaire et qu’elle ne doit pas être menée (…) En outre, je pense que la volonté du peuple doit s’exprimer dans les élections, pas dans les sondages ».
C’est vrai. En principe, sauf à vivre dans le chaos de la démocratie d’opinion, les scrutins font foi bien plus que les sondages. Mais en principe aussi, le pouvoir exécutif français se situe à l’Élysée et à Matignon (Paris, France), et non dans le bâtiment du Berlaymont (Bruxelles, Belgique). Sauf à vivre dans le chaos de la démocratie congédiée.
Évidemment, si les choses en sont là, et Moscovici le dit fort bien, c’est en raison « des traités que les gouvernements et les Parlements de l’Union européenne, à commencer par celui de la France, ont signés ». C’est là l’argument dont les européistes se prévalent sans cesse, car il n’y a plus que ça en magasin. Au passage, ils se hâtent d’oublier que le dernier des traités, celui de Lisbonne, a tout de même nécessité pour être signé que l’on s’assoie en 2005 sur les résultats de deux référendums, le néerlandais et le français. Tout comme on s’est assis sur le résultat de la consultation grecque de juillet 2015. Autrement, c’était début du détricotage de la zone euro.
Au sujet du mouvement social actuellement en cours, Myriam El Khomri a eu ces mots très contestés : « il n’est pas question que l’économie de notre pays soit prise en otage ». Ils sont pourtant incontestables : l’économie de notre pays est, depuis longtemps, en situation de captivité. Simplement, les rançonneurs ne sont pas forcément ceux que l’on croit.
________
On rappelle que la presse patronale (pléonasme), experte de l’inversion accusatoire, ose traiter « d’extrême droite » tous ceux qui résistent à ce néofascisme qu’est l’UE, tous ceux qui défendent la souveraineté populaire et nationale.
Je rappelle deux ou trois choses que je dis sur ce sujet depuis onze ans :
httpv://youtu.be/7EhbGQUoy5o
httpv://youtu.be/8Ak-gFFhJ70
httpv://youtu.be/fEwCJEbJ9Pc
________
Citons aussi ces aveux importants, publiés par Fakir et Là-bas et qu’il faut connaître : dès avril 2012, avant l’élection de Hollande, les eurocrates savaient que le prochain élu ne pourrait pas faire autrement que détruire les diverses protections des salariés (notamment le CDI, mais pas seulement) ; l’UE est un piège antisocial, voulu comme tel par ceux qui le défendent :
httpv://youtu.be/4jXmdF8MjNo
_______
Rappelons enfin les explications par Gérard Filoche de la catastrophe en cours pour tous les salariés du pays : pour comprendre l’importance cruciale, intime, quotidienne, pour nous tous du Code du travail, et pour réaliser que c’est sa destruction qui est programmée par la loi « El Khomry » :
httpv://youtu.be/c3Bd-0q4sas
httpv://youtu.be/rWTFUPFVwtE
Voir aussi ce lien (importante explication) : http://rmc.bfmtv.com/emission/projet–de–loi–el–khomri–gerard–filoche–ps–milite–pour–une–greve–generale–953533.html
Et enfin ce très bon plaidoyer :
——-
PS : scandale absolu, quand on y pense :
De jeunes technocrates de l’Union Européenne dictent la politique de la France
httpv://youtu.be/uTinsboWJaM
10 raisons qui imposent de quitter l’Union Européenne – François Asselineau (UPR) :
httpv://youtu.be/ycfOvIZC3Rc
________
Il n’y a que nous
pour défendre le Code du travail,
personnellement,
maintenant.
_____
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10154215916447317
Formidable « étincelle zapatiste »
Vous allez aimer étudier ces expériences populaires au Chiapas, je suis sûr, bande de virus démocratiques 🙂

Première approche, le résumé de Wikipédia :
« On peut considérer l’autonomie zapatiste comme une forme d’autogouvernement permettant l’exercice d’une démocratie radicale (ou tout simplement, d’une démocratie au sens plein du terme, dans laquelle le peuple exerce lui-même les tâches de gouvernement).
Il ne s’agit donc en aucun cas d’une autonomie entendue au sens d’une simple décentralisation des pouvoirs d’État, comme c’est souvent le cas dans les pays européens.
Il s’agit de la construction d’une autre réalité sociale et politique, dans une perspective antisystémique. Comme dit l’un des membres d’un Conseil de bon gouvernement,
« l’autonomie est la construction d’une nouvelle vie »
L’autogouvernement implique que, peu à peu et de manière rotative, l’ensemble de la population participe aux tâches d’organisation de la vie collective.
La politique cesse alors d’apparaître comme une activité de « spécialistes » ; elle est, littéralement, la chose de tous.
L’un des principes auxquels se réfèrent les zapatistes est le mandar obedeciendo (gouverner en obéissant). Cet énoncé paradoxal éloigne de la conception habituelle du pouvoir : celui qui exerce une charge de gouvernement doit le faire en obéissant à ceux qu’il doit « diriger ».
Pourtant, le mandar obedeciendo n’implique pas une conception strictement horizontale de l’organisation collective (qui supposerait que les assemblées puissent être consultées en permanence et constituent la seule source d’initiative collective).
Au contraire, ceux à qui l’on confie des charges éminentes au sein des Conseils de bon gouvernement, s’ils doivent consulter les assemblées autant que possible, jouent néanmoins un rôle particulier, parce qu’ils doivent parfois prendre des décisions urgentes et parce qu’ils ont le devoir de proposer des initiatives pour améliorer en permanence l’organisation de la vie collective.
Enfin, lorsque les décisions ont été prises, à travers le mécanisme complexe de consultation déjà indiqué, les autorités ont aussi le devoir de faire respecter ce qui a été collectivement décidé :
« l’autorité commande sans donner d’ordre parce qu’elle le fait en obéissant aux citoyens… Celui qui commande doit obéir, mais les citoyens doivent aussi obéir à ce que dit l’autorité », explique un membre des Conseils.
Le « mandar obedeciendo » se décline en plusieurs principes dont le respect contribue à lutter contre la dissociation des gouvernants d’avec le monde des gouvernés (notamment « servir et non se servir », « convaincre et non vaincre », « proposer et non imposer »).
Comme l’expliquent les zapatistes, l’autonomie consiste à « découvrir que nous sommes capables de nous gouverner nous-mêmes ».
Ce principe va rigoureusement à l’encontre de la séparation entre gouvernants et gouvernés, qui est au fondement de l’État moderne. En ce sens, l’expérience zapatiste suggère la possibilité d’instaurer des formes non étatiques de gouvernement. »
Source : wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/Zapatisme
______________
J’entends parler depuis 10 ans du Chiapas et du sous-commandant Marcos, bien sûr, et je sais depuis longtemps que je devrais l’étudier comme il faut. Mais il a fallu que je lise ce long et très intéressant papier dans Ballast — où Frédéric Lordon est sévèrement critiqué — pour commencer vraiment ce travail (tout arrive) :
http://www.revue-ballast.fr/frederic–lordon–au–chiapas/
Texte inédit pour le site de Ballast
Frédéric Lordon, que nous avions longuement interrogé pour le troisième numéro de notre revue papier, est l’un des penseurs radicaux les plus stimulants de cette dernière décennie. Économiste et philosophe, il ferraille contre ce qu’il tient pour des impasses, dans les rangs de l’émancipation : l’européisme béat, l’internationalisme incantatoire et le consensus démocratique. Son dernier ouvrage, Imperium, cible notamment la tradition libertaire : si l’intellectuel marxiste loue certains de ses traits, il n’en mord pas moins aux mollets anarchistes en jurant de sa candeur inconséquente. Une vieille querelle politique : Marx et Proudhon avaient ouvert le bal fratricide il y a maintenant deux siècles de cela. Les libertaires, c’est de bonne guerre, ne consentent pas à tendre l’autre joue : c’est ainsi que l’historien Jérôme Baschet, auteur d’ouvrages de référence sur le zapatisme, entend déconstruire, par ce copieux article, le dernier ouvrage de Frédéric Lordon en s’appuyant sur l’expérience révolutionnaire et autonomiste mexicaine. Mais Baschet assure ne pas s’inscrire dans une énième querelle de chapelles ou d’ego entre intellectuels : assumer les tensions est la première étape pour avancer ensemble. Un dialogue fructueux — à condition, hélas, d’en maîtriser les contours. ☰ Par Jérôme Baschet
Débattre d’Imperium1, le dernier ouvrage de Frédéric Lordon, est certainement utile, tant la ligne de clivage entre l’option anti-étatique à laquelle il s’en prend et l’option étatique qu’il défend divise profondément. À l’adversaire qu’il se donne – la « pensée libertaire » –, F. Lordon prête quatre caractéristiques : un idéal d’horizontalisme absolu, la croyance en une nature humaine idéalement bonne, le caractère innécessaire de l’État, un internationalisme universaliste. Imperium a pour objectif de saper ces positions. De les dégriser. Dégriser l’horizontalisme : le social est nécessairement vertical. Dégriser l’anti-étatisme : il y aura toujours de l’État. Dégriser l’universalisme : il y a et il y aura toujours des appartenances particulières. Dégriser le « rousseauisme » : il y a et il y aura de la servitude passionnelle, de sorte que l’émancipation ne pourra être qu’incomplète. Avant d’aborder ces quatre points de discussion, on pourra relever que la manière de construire l’adversaire – cette pensée parfois qualifiée de « libérale-libertaire » – est pour le moins cavalière, malgré quelques hommages ponctuels. Or, lorsqu’on prétend proposer une avancée à partir d’une réduction des idées que l’on récuse à une caricature d’elles-mêmes, on risque de ne produire soi-même que la caricature inverse de celle que l’on s’est faussement donné comme adversaire. Par ailleurs, et même si on ne peut négliger le fait que la conclusion affiche une claire détestation de l’État dans sa forme actuelle (à quelques prudences préalables près, « État du capital » dont il n’y a rien à faire d’autre que de chercher à « s’en débarrasser » ; p. 318), l’élaboration sophistiquée que F. Lordon engage sous la bannière du spinozisme se situe sur un plan résolument abstrait, écartant presque toute analyse historique spécifique, pour s’en tenir à une saisie des implications politiques des configurations passionnelles caractéristiques d’une « nature humaine » (heureusement en partie modifiable).
« Dégriser l’anti-étatisme : il y aura toujours de l’État. Dégriser l’universalisme : il y a et il y aura toujours des appartenances particulières. »
Dans ce contexte de haute abstraction, l’expérience zapatiste fait partie des rares ancrages concrets auxquels quelques pages sont consacrées, avec sans doute pour intention de prendre à contre-pied ses sympathisants : « Le Chiapas [on supposera que le terme désigne la lutte zapatiste, à laquelle la géopolitique chiapanèque ne se réduit pas, ndla] présente les attributs… d’une structure étatique » ; il est « une nation » (p. 131–132). On pourrait s’amuser d’un discours qui, élaboré si loin de son objet, ne craint pas, pour autant, d’asséner des sentences définitives. Mais on préférera prendre ces quelques paragraphes comme un hommage (ironique, mais qu’importe !) adressé à une expérience qui constitue l’un des rares points d’appui potentiels accordés à l’adversaire désigné d’Imperium. Et puisque « le Chiapas » s’est invité dans le débat, je me propose de faire de l’autonomie zapatiste le terrain concret à partir duquel mettre à l’épreuve la conceptualisation lordonnienne2.
Une verticalité fourre-tout
À l’adversaire construit pour les besoins de sa cause et réputé confit dans un idéal d’horizontalité politique parfaite, F. Lordon oppose une indépassable verticalité. Mais son propos repose sur un enchaînement logique pernicieux, un usage biaisé du terme « verticalité » et une notion confuse de la hiérarchie. C’est dans la constitution même du social que le chapitre 2 inscrit le caractère nécessaire de la verticalité. En bon durkheimien, F. Lordon rappelle que le social est plus qu’une collection d’individus et qu’il implique une cohésion qui ne saurait dépendre uniquement des engagements volontaires ou des liens interpersonnels. C’est ce qu’il nomme « l’excédence du social » (du tout sur les parties), principe opposé à une conception contractualiste de l’organisation collective (p. 60–62). Certes, l’excédence du social ne relève pas d’une transcendance tombée du ciel mais d’une « transcendance immanente » qui procède du plissement du social sur lui-même : c’est par « le travail de sa propre puissance » que « la multitude devenue communauté… s’est adjointe une nouvelle dimension : la verticalité » (p. 67). Magie de la géométrie lordonienne : l’épaisseur du plan plissé devient « nappe » et la verticalité est ce supplément qui fait sortir d’une vision trop plate du collectif, comprimé en deux dimensions, pour lui adjoindre cette merveilleuse troisième dimension qui lui manquait…
(CC César Bojórquez)
Mais pernicieuse géométrie tout de même, car si l’on peut bien accepter le principe de l’excédence du social, rien n’oblige à l’associer à la métaphore de la verticalité. Tout le nœud de l’affaire est là, dans le fait de laisser s’instaurer une confusion, aux conséquences considérables, entre l’excédence du social constitué métaphoriquement en verticalité et l’existence de rapports sociaux de domination/subordination. De fait, Imperiumrepose sur un enchaînement entre excédence du social, verticalité hiérarchique et, on le verra plus loin, capture étatique de la puissance de la multitude. Dans la mesure où cette séquence est, le plus souvent, présentée comme nécessaire, domination et hiérarchie apparaissent comme inhérentes à l’ordre du social. Or, tout ceci repose sur une fâcheuse imprécision : par elle-même, l’excédence du social n’implique aucun rapport de subordination entre les membres du collectif ; elle ne fait que placer au-dessus d’eux tous un principe général (que l’on peut, dans un vocabulaire inspiré de Spinoza, nommer « puissance de la multitude »). Cet au-dessus d’eux tous ne fait pas, par lui-même, sortir d’un rapport d’égalité entre les membres du collectif. Il n’y a donc aucune relation nécessaire entre l’excédence du social et la formation d’une appropriation différenciée de la puissance, conduisant à la consolidation d’une hiérarchie entre les hommes. Que les formes historiquement attestées de l’excédence du social soient le plus souvent associées à l’existence d’un pouvoir séparé est évident, mais cela ne justifie en aucun cas l’opération qui consiste à confondre par principe, d’une part, la supposée verticalité du rapport entre les hommes et les principes du collectif auquel ils appartiennent et, d’autre part, la verticalité (effectivement hiérarchique) qui peut s’instaurerentre les hommes eux-mêmes.
« L’expérience zapatiste est étroitement liée à une organisation, l’EZLN, qui garde, aujourd’hui encore, un caractère vertical qu’elle n’a du reste jamais cherché à cacher. »
Un tel tour de passe-passe ne fait guère honneur à une volonté démonstrative qui, par ailleurs, s’emploie à impressionner par un luxe de raffinements savants. S’agissant de la notion de commun, cela tourne à la prestidigitation3. Voilà en effet le commun commué en verticalité, en domination des hommes sur eux-mêmes. C’est un « commun au-dessus de ses parties », car toute « forme de vie commune… est un commun de rang supérieur » (p. 220). À moins de n’énoncer qu’un truisme, on confond là, comme dans l’opération mentionnée auparavant, deux modalités du « au-dessus », ce qui est bien fâcheux, car les conséquences politiques de chacune d’elles sont radicalement différentes. Un exemple encore : la conclusion du livre affirme que l’horizontalité voue toute communauté à l’instabilité et qu’aucune ne peut durer si ce n’est « par le travail d’une verticalité cachée, ou déniée. Par exemple, un leader charismatique ou un gourou dominateur. Ou bien, mais c’est encore un opérateur de verticalité, la force d’un affect commun constitutif d’une forme de vie ». On aura la charité de supposer que F. Lordon fait quelque différence entre affect commun et gourou dominateur, mais il n’en reste pas moins que, du point de vue du principe même de la verticalité tel qu’il l’énonce, leur portée est identique. On voit là à quelle perversion conduisent le glissement conceptuel signalé et le postulat selon lequel le social est, en son essence, verticalité.
Engageons maintenant un premier « test » à l’épreuve du Chiapas. Vu le renversement analytique que F. Lordon met en scène, celui-ci devrait être, pour ses artisans et partisans, l’Éden de l’horizontalisme. Les choses sont pourtant nettement moins simples. En premier lieu, l’expérience zapatiste est étroitement liée à une organisation, l’EZLN, qui, pour avoir été capable d’assumer une dynamique d’auto-transformation profonde, n’en garde pas moins, aujourd’hui encore, un caractère vertical (au sens strict du terme) qu’elle n’a du reste jamais cherché à cacher4. Également reconnue est l’interaction, en grande partie indue, entre les instances civiles de l’autonomie et cette même structure verticale5. On peut, comme Gustavo Esteva, célébrer le transfert progressif par lequel la direction politico-militaire de l’EZLN restitue à ses membres civils le pouvoir qui lui avait été confié6 ; mais force est d’admettre que ce processus n’est pas achevé et qu’il implique des tensions très concrètes, dont il serait loisible d’analyser des exemples précis, entre des habitudes où l’intériorisation de la hiérarchie joue un certain rôle et des attitudes exigeant une pratique plus accomplie de l’autonomie.
© Moysés Zúñiga Santiago
On reviendra plus loin sur le fonctionnement des instances autonomes zapatistes, mais on peut déjà tirer quelques remarques du principe dont elles se réclament, le « mandar obedeciendo », explicité par les modestes panneaux qu’on découvre en entrant dans les territoires rebelles : « Ici, le peuple commande et le gouvernement obéit. » La manière dont les zapatistes expliquent ce principe et sa mise en pratique devrait suffire à décourager toute lecture purement « horizontaliste » (si, par là, on entend le primat absolu des assemblées et le fait que le pouvoir de décision soit en permanence également partagé par tous). Certes, exercer des charges (cargos) dans les instances de gouvernement en pratiquant le mandar obedeciendo écarte la relation de pouvoir-sur qui caractérise la logique de l’appareil d’État, en tant que mécanisme programmé en vue du dessaisissement de la capacité collective de décision. Mais le mandar obedeciendo ne peut pas non plus être analysé comme simple horizontalité, car si les conseils de gouvernement doivent consulter largement et suivre ce que demandent les communautés, il lui revient aussi d’appliquer et faire respecter ce qui a été décidé au terme de la délibération collective, ou encore lorsque l’urgence oblige à prendre des mesures sans pouvoir consulter7.
« Des femmes et des hommes, au Chiapas et ailleurs, œuvrent concrètement et quotidiennement à inventer des formes politiques qui renvoient au musée des antiquités la stérile opposition d’un horizontalisme idyllique et d’un verticalisme détestable. »
En outre, un rôle spécifique d’initiative et d’impulsion estreconnu à ceux qui assument temporairement le statut d’autorité : « Tout n’est pas toujours horizontal. Tout ne vient pas du peuple. Il y a une partie verticale, qui vient des autorités, mais qui agit comme représentant. Il faut que quelqu’un prenne les initiatives. Mais la décision, oui, elle est prise par le peuple »8. Plutôt que comme une totale horizontalité qui court le risque de se dissoudre par manque d’initiatives ou de capacités à les concrétiser, l’expérience zapatiste – telle qu’elle s’est développée jusqu’à présent – invite à comprendre le mandar obedeciendo comme articulation de deux principes : d’une part, la capacité de décider réside pour l’essentiel non dans les instances de gouvernement mais dans les assemblées, en leurs différents niveaux ; de l’autre, on reconnaît à ceux qui assument une charge de gouvernement (de manière rotative et révocable) une fonction spécifique dans le processus d’élaboration des décisions, ce qui ne va pas sans ouvrir le double risque d’une déficience ou d’un excès dans l’exercice de ce rôle. On ajoutera, pour finir sur ce point, que ni la pensée libertaire9 (ou anti-étatique) ni les pratiques qui lui correspondent ne sont nécessairement le règne de l’horizontalisme béat que, de très loin, imagine F. Lordon. De ce fait, celui-ci bataille un peu inutilement contre les moulins à vent de ses propres fantasmes. Pendant ce temps, des femmes et des hommes, au Chiapas et ailleurs, œuvrent concrètement et quotidiennement à inventer des formes politiques qui renvoient au musée des antiquités la stérile opposition d’un horizontalisme idyllique et d’un verticalisme détestable.
Un État (trop) général
La forme actuelle de l’État n’est assurément pas la seule possible et c’est, très logiquement, que F. Lordon pose la nécessité d’un concept de l’État qui ne se limite pas à ce cas particulier. Pour lui, ce sera l’État général. Mais ne passe-t-on pas alors d’une signification trop spécifique à un concept d’une portée si large qu’il en perd l’essentiel de sa pertinence ? En tout cas – et il faut y insister –, l’État général lordonnien ne saurait être confondu avec l’État au sens habituel du terme : ce serait donc un grave malentendu que de référer au second ce qu’Imperium dit du premier. Ainsi, affirmer que « le Chiapas » a reconstitué un État pourrait être contesté s’il était question de l’État au sens courant, mais c’est l’État général qui est discuté dans ces pages, de sorte qu’il n’y a là guère plus qu’une évidence, puisque tout le politique est englobé sous la notion d’État général.
(DR)
Celle-ci est assumée comme une catégorie politique limite. Elle plonge dans l’infra-politique, puisqu’elle n’est rien d’autre que la puissance de la multitude, c’est-à-dire le social entendu dans son excédence. Mais elle est, en même temps, une catégorie véritablement politique, car c’est de là que les institutions politiques tirent leur matière. « Ce droit que définit la puissance de la multitude » est ce que Spinoza nomme « imperium » et que F. Lordon choisit de traduire par « État général ». Il est donc « le pouvoir qu’a la multitude de s’auto-affecter », mais aussi la capture étatique et la formation d’un appareil de domination. Ainsi, « la structure élémentaire de la politique qu’est l’imperium (l’auto-affectation de la multitude) voue le corps politique à expérimenter la capture – capture interne par une de ses parties qui se subordonne la masse des autres » (p. 197). Diantre ! Il y aurait donc un enchaînement fatal conduisant de la nature même du social à la verticalité de l’excédence et, de là, à la capture de la souveraineté collective au bénéfice d’une domination politique exercée par certains.
« L’État dans sa forme actuelle n’est bien sûr qu’une forme spécifique d’une réalité plus ample – non de l’État général, mais bien plutôt de l’État en général. »
Cette même construction notionnelle permet également, par exemple, d’affirmer que les sociétés sans État, étudiées par Pierre Clastres, sont en fait des sociétés à État (général). Mais, outre que la thèse la plus singulière de ce dernier (l’existence de mécanismes visant à contrer la possibilité d’une dérive étatique) est esquivée – sans doute parce qu’elle cadre mal avec l’angélisme supposé de la pensée libertaire –, son propos central n’est nullement démenti. Car en quoi consiste cet Étatgénéral dont la découverte devrait désenchanter le rêve primitiviste ? Réponse : il est « la force morale du groupe capable de dominer tous les membres du groupe et de s’imposer à eux » (p. 126). Assurément. Mais, répétons-le, quelle que soit la capacité d’envoutement du vocabulaire lordonnien, l’État général n’est pas l’État et Lordon, commentateur de Clastres, ne peut que lui concéder, comme en passant, l’essentiel : il n’y a pas, chez les Guarani, « d’appareil étatique séparé ». Ce qui ne l’empêche pas – et c’est bien ce qui peut paraître extravagant – d’affirmer que ces sociétés « sont tout aussi [je souligne, ndla] verticalisées que les autres » (p. 128). Le concept lordonnien de verticalité comme celui d’État général marquent ainsi leur inefficacité, dès lors qu’ils autorisent à ne pas faire de différence – en essence, du point de vue de cette verticalité qui reste toujours la même – entre la chefferie sans pouvoir et, disons, l’absolutisme de droit divin. On peut alors supposer qu’en bonne géométrie lordonnienne une organisation collective fondée sur le mandat impératif et révocable sera, elle aussi, « tout aussi verticalisée » qu’une dictature militaire. On retrouve ici le problème soulevé au point précédent : de même que l’usage qui est fait du concept de verticalité permet de confondre excédence du social et rapports de domination, celui d’État général subsume la puissance de la multitude en tant qu’elle s’exerce sur elle-même et la capture de cette puissance au profit d’un appareil séparé ou d’un groupe particulier. Est oblitérée la différenciation pourtant décisive entre la « puissance de tous », vis-à-vis de laquelle chacun peut être dans un rapport équivalent, et le pouvoir-sur, véritable rapport de domination entre les hommes.
Dans les dernières pages, F. Lordon affirme, à juste titre, que se débarrasser de l’État du capital n’est pas se débarrasser « de l’État tout court – de l’État en général » (p. 318). Lui, si soigneux dans l’emploi des mots, ne dit pas ici l’État général, mais l’État en général. Serait-ce qu’au stade des conclusions, il convient de faire valoir qu’elles s’appliquent à quelque chose de plus que l’État général ? Le lapsus est cependant bienvenu et il invite à se saisir de cette distinction entre État général et État en général, dont l’absence, dans l’ouvrage, est peut-être ce qui autorise une constante équivoque. L’État dans sa forme actuelle n’est bien sûr qu’une forme spécifique d’une réalité plus ample – non de l’État général, mais bien plutôt de l’État en général. L’État général de F. Lordon, c’est le politique dans son ensemble10, c’est l’organisation de la puissance de tous. Quant à l’État en général (au sens habituel du terme), c’est ce qu’Alexandre Matheron qualifie de « confiscation par les dirigeants de la puissance collective de leurs sujets » (cité p. 111) ou ce que F. Lordon lui-même identifie comme « captation [de la souveraineté] en un appareil séparé » (p. 336), plaçant « des gouvernants au-dessus des gouvernés » (p. 198–9).
© Mario Marlo
Au total, la construction d’Imperium a ceci de pernicieux qu’elle occulte l’enjeu majeur d’une politique de l’émancipation, dont le souci devrait être de tracer une ligne de front entre les formes de domination étatique et les formes non étatiques du politique et, tout particulièrement, de nous aider à affiner l’analyse de la zone-frontière – tout sauf étanche ! – qui les sépare. Au contraire, F. Lordon noie le poisson de l’État (en général) dans l’océan du politique (l’État général). La démarche serait fondée s’il démontrait que le second conduit de manière absolument nécessaire au premier. C’est ce qu’on croit parfois comprendre, mais malgré tous les efforts déployés pour établir un continuum de l’un à l’autre et jouer de glissements subreptices, Imperium ne parvient à établir ni identité ni enchaînement fatal entre eux. On en conclura que les thèses lordonniennes relatives à l’État général ne peuvent, par elles-mêmes, s’appliquer à l’État en général que par une coupable absence de discernement conceptuel.
« L’autonomie zapatiste mêle une extrême humilité (le siège d’un conseil de bon gouvernement, c’est une petite maison en bois, une table et des bancs, quelques étagères et tout juste un ordinateur) et une relative complexité, qui met en jeu des interactions entre instances multiples. »
C’est précisément l’expérimentation de formes politiques non étatiques que l’autonomie zapatiste nous invite à explorer. Celle-ci mêle une extrême humilité (le siège d’un conseil de bon gouvernement, c’est une petite maison en bois, une table et des bancs, quelques étagères et tout juste un ordinateur) et une relative complexité, qui met en jeu des interactions entre instances multiples, ainsi qu’une l’articulation d’échelles différentes : la communauté (le village), la commune (l’équivalent d’un canton) et la zone (les territoires zapatistes en comportent cinq, ayant chacune une extension territoriale comparable à celle d’un département). À chaque niveau, interagissent une assemblée et des autorités élues pour deux ou trois ans (agents communautaires, conseil municipal, conseil de bon gouvernement). Les configurations sont différentes à chaque niveau et posent des questions spécifiques, de sorte qu’on échappe ici au « paralogisme scalaire » consistant, selon F. Lordon (p. 74), à penser que les problèmes politiques se posent de la même manière à toutes les échelles. Ainsi, au niveau du village, l’interaction entre agent et assemblée communautaire est étroite et presque constante. Le rôle du premier est d’autant plus circonscrit que la seconde se réunit aisément et même rapidement, dès qu’un problème exige discussion collective. Pour autant, l’agent n’en remplit pas moins un rôle spécifique, quoique restreint : outre le suivi des décisions de l’assemblée, sa capacité d’initiative peut être vitale et son autorité lui confère la possibilité d’exercer une influence particulière sur la manière de traiter certaines questions. À l’échelle de la zone, la situation est différente. L’assemblée se réunit moins aisément (tous les deux ou trois mois, ou pour des raisons extraordinaires) et la diversité des décisions qu’il revient au conseil de bon gouvernement d’assumer augmente. Toutefois, pour les questions les plus importantes, notamment pour les projets dans les domaines tels que la santé, l’éducation, l’agro-écologie, le processus d’élaboration et de prise des décisions est partagé avec l’assemblée de zone. Celle-ci peut trancher, mais si aucun accord clair ne se dégage, il revient aux représentants de toutes les communautés d’engager la discussion dans leurs villages respectifs afin de faire part à l’assemblée suivante d’un accord, d’un refus ou d’amendements. Le cas échéant, ces derniers sont discutés et l’assemblée élabore une proposition rectifiée, à nouveau soumise aux communautés. Plusieurs allers et retours entre conseil, assemblée de zone et villages sont parfois nécessaires avant qu’une proposition puisse être adoptée.
Au-delà des modalités d’articulation entre le rôle des autorités et celui des assemblées, un enjeu essentiel tient aux formes de la délégation. À partir de l’analyse de l’autonomie zapatiste, on peut proposer une distinction entre des formes de délégation structurellement dissociatives et d’autres qui sont faiblement dissociatives. Articulées à d’autres caractéristiques de la structure sociale, les premières ont pour vocation de produire une séparation-capture au profit des gouvernants-dominants ; ainsi, les formes classiques de la représentation sont l’organisation méthodique (et, aujourd’hui, de plus en plus patente) de l’absence effective du représenté. Les secondes réduisent autant que possible la dissociation entre gouvernants et gouvernés, même si le risque que cette dissociation en vienne à se restaurer n’est jamais absent. Aussi, une politique de l’autonomie ne vaut-elle que par les mécanismes pratiques qu’elle invente sans cesse pour lutter contre ce risque et pour entretenir une dynamique de déconcentration de l’exercice des fonctions d’autorité. Que la délimitation entre formes de délégation dissociatives et non dissociatives ne soit jamais tout à fait assuré est bien clair, mais cela n’empêche pas de considérer qu’il s’agit d’une dualité conceptuelle pertinente. On dira même qu’elle est le noyau de la distinction entre une politique étatique – fondée sur l’organisation méthodique d’une dépossession de la puissance du collectif et sur la condensation de l’autorité en pouvoir-sur – et une politique non étatique, laquelle écarte toute consolidation de la dissociation entre gouvernants et gouvernés et lutte activement contre sa reproduction, de sorte que l’exercice de l’autorité demeure essentiellement une manifestation de la puissance collective11.
Image du film ¡Viva México ! de Nicolas Défossé, 2010
Encore faut-il indiquer les caractéristiques qui différencient concrètement les formes de délégation fortement ou faiblement dissociatives. Pour les secondes, la révocabilité des mandats est un trait essentiel, justement souligné par F. Lordon. Mais l’expérience zapatiste permet d’en ajouter d’autres : faire en sorte que les charges politiques ne puissent être des occasions de bénéfice personnel (n’y sont attachés ni rétribution, ni avantage matériel), de sorte qu’elles exigent une éthique effectivement vécue du service rendu ; absence de personnalisation et exercice pleinement collégial des charges ; contrôle de leur exercice par d’autres instances ; non-concentration des tâches d’élaboration des décisions. Mais on insistera surtout sur la de-spécialisation des rôles politiques qui, au lieu d’être monopolisés par un groupe spécifique (classe politique, caste fondée sur l’argent ou sur une autre forme de pouvoir symbolique ou de prestige, etc.), doivent faire l’objet d’une circulation généralisée au sein du collectif concerné par ces décisions. Cela suppose de renoncer – point difficile ! – à lier le choix des délégués à l’évaluation d’une « compétence » particulière. Dans l’expérience zapatiste, cela se traduit par le fait que les autorités élues assument sans rougir n’en savoir pas plus – sinon même plutôt moins – que les autres, quant à la chose publique. Accepter cela, c’est la condition d’une pleine dé-spécialisation du politique. Enfin, une autre condition proprement décisive est la non-dissociation des modes de vie entre ceux qui exercent des charges, même de manière très temporaire, et tous les autres. C’est la raison pour laquelle les membres des conseils de bon gouvernement (situés dans les centres régionaux, les caracoles, dont les villages peuvent se trouver fort éloignés) accomplissent leur tâche par rotation, en se relayant par période de 10 à 15 jours, et ce afin de ne pas interrompre trop longtemps leurs activités habituelles, de continuer à s’occuper de leurs familles et de leurs terres. C’est une autre condition jugée indispensable pour garantir la non-spécialisation des tâches politiques et pour éviter que ne réapparaisse une séparation entre l’univers commun et le mode de vie de ceux qui, fut-ce pour un temps bref et de manière très délimitée, assument un rôle particulier dans l’élaboration des décisions collectives.
Identité nationale contre rance universel
« Dans l’expérience zapatiste, les autorités élues assument sans rougir n’en savoir pas plus – sinon même plutôt moins – que les autres, quant à la chose publique. »
F. Lordon nous enjoint d’assumer le sentiment d’appartenance, ciment réel des corps politiques, renvoyant l’universalisme à son manque de consistance. Que tout collectif produise un sentiment d’appartenance – attachement à ce même collectif et satisfaction d’y avoir part –, on ne voit guère de raison de le récuser. « Appartenance », le mot est du reste plutôt aimable, contrairement à celui d’identité, tenu pour équivalent par F. Lordon, mais qui, charriant une relation appauvrie à soi-même, paraît décidément trop compromis avec les conceptions fixistes et substantialistes de l’appartenance qu’il s’agit d’écarter. Quant à l’acception lordonnienne du mot « nation », elle est tout aussi personnelle que celle de la « verticalité » ou de l’« État (général) ». Il désigne en effet toute forme d’appartenance à un collectif un tant soit peu stabilisé et délimité – et ce, par opposition à l’appartenance au genre humain. Redéfinie comme « communauté souveraine », fondée sur « le décider en commun », la nation est ici une « collectivité régie, non par un principe d’appartenance substantielle, mais par un principe de participation – de participation à une forme de vie » (p. 333). Mais si tout collectif fondé sur une forme de vie est une nation, il n’y a plus à s’étonner de lire que « le Chiapas est une nation ». Tout aussi bien, Longo Maï est une nation et le plateau de Millevaches idem. Mais quel sens y a‑t‑il à nommer ainsi toute appartenance à une entité politique finie ? Simplement pour faire place aux attachements particuliers ? Le choix terminologique ne laisse pas alors d’être déconcertant, et il importe de souligner que ce que l’on affirme de ces particularismes ne dit rien, en propre, de ce que l’on appelle communément nation. Ou alors choisit-on ce terme parce qu’il autorise, là encore, à passer par glissements successifs de la « nation » au sens lordonnien à la nation au sens historique du terme ? Se reproduirait alors le même tour de passe-passe qu’à propos de la verticalité et de l’État (général).
S’agit-il de prôner une revitalisation de l’appartenance à la nation (au sens courant), contre la supposée détestation, à gauche, du sentiment national ? D’un côté, F. Lordon revendique « l’affect de fierté nationale » et argumente qu’il peut être arraché à ce qu’il a produit de pire, pour peu que l’on abandonne les conceptions substantialistes de la nation au profit d’une approche adoptant comme critère de l’appartenance « la participation contributive à l’effort collectif de la persévérance du groupe dans l’être » (p. 271–2). D’un autre côté, il conclut qu’une tâche essentielle consiste à « se désintoxiquer de l’imaginaire de la grandeur nationale » (p. 310). Quoi qu’il en soit, F. Lordon fait grand cas de l’appartenance nationale : « Le pensable de notre époque est statonational. » Argument qui se pare du caractère indiscutable du réalisme, mais n’en reste pas moins douteux, dès lors que F. Lordon lui-même s’autorise ailleurs à penser à rebrousse-poil de l’époque. Quant à la valorisation du sentiment national, elle appelle au moins deux remarques. Si elle est, pour une large part, une création de l’État moderne, il y a tout lieu de penser qu’elle est fonctionnelle à une domination dont on ne peut que chercher se débarrasser. Par ailleurs, on ne saurait trop rappeler que le sentiment national(iste) est une construction largement artificielle, imposant une prééminence exclusive au sein d’un entrelacement d’appartenances multiples (cette appartenance-là occulte toutes les autres pour devenir, précisément, une « identité ») et qu’une nation est d’abord une « communauté imaginée »12.
(DR)
Mais l’essentiel, dans Imperium, semble plutôt consister à défendre l’existence des particularismes, contre l’universalisme prêté à la gauche internationaliste. Pour F. Lordon, l’universalisme n’est qu’une « chimère » (p. 100), une idée sans consistance qui dénie la force des « communautés politiques existant réellement ». On pourra juger réductrice, sinon douteuse, la manière dont est traité l’affect internationaliste, exécuté au motif de sa déconfiture en 1914. Mais ce qui est vraiment malencontreux est que, cette fois encore, F. Lordon choisisse si mal sa cible et parte en guerre contre une conception bien rancie de l’universalisme (le chapitre IX opte pour un dialogue avec l’œuvre de Badiou). L’adversaire, construit ad hoc, veut « l’universel comme affranchissement complet d’avec toute particularité, c’est-à-dire comme seul appel à l’humanité générique des hommes, convoqués hors de toute autre propriété distinctive » (p. 280). C’est l’universel comme déliaison et « arrachement de la glèbe » des particularismes. F. Lordon a beau jeu, alors, de dénoncer une opération impossible, dès lors que toute destinée humaine est tissée des appartenances singulières qui l’ont constituée. Malheureusement, dans la phrase citée, comme ailleurs, il se révèle incapable d’envisager que plusieurs échelles d’appartenance puissent ne pas être mutuellement exclusives et omet d’envisager qu’une autre conception de l’universel puisse s’affirmer sans nier les particularités. De ce fait, la critique de l’universalisme demeure tronquée. Il remarque certes que cet universel est produit à partir d’un substrat particulier : il n’est que l’universalisation de valeurs particulières. Mais cette conception même de l’universel n’est pas analysée de manière critique ; elle est seulement récusée. S’interrogeant par exemple sur « les grandes œuvres de l’histoire culturelle », F. Lordon indique qu’elles « saisis[sent] quelque chose de l’humanité générique et s’adress[ent] aux hommes dans leur humanité générique, sans faire acception d’aucune autre qualité particulière » (p. 303). On reste sidéré que le maître des affects imagine que l’on puisse être touché par une œuvre en tant qu’être humain générique, c’est-à-dire en faisant abstraction de toutes les singularités qui, précisément, nous rendent capable d’affects. À l’évidence, ces œuvres n’expriment aucune humanité générique ; elles ont simplement la puissance, à partir d’une forme particulière de l’expérience humaine, de résonner auprès d’autres humanités particulières. Ce qui est en jeu est de l’ordre du trans-historique, nullement d’une généricité anhistorique.
« Dans les rencontres et les fêtes zapatistes, on chante l’hymne mexicain, avant même l’hymne zapatiste, et on rend les honneurs au drapeau national, ce qui ne va pas sans faire grincer bien des dents parmi les sympathisants libertaires. »
Alors que F. Lordon fait la démonstration de son incapacité à penser des appartenances multiples et emboîtées, comme à dépasser le cadre de l’universalité abstraite héritée des Lumières, il y aurait sur ce point une belle leçon à tirer des propositions zapatistes. Certes, F. Lordon suggère que le Chiapas « offre peut-être l’une des meilleures illustrations contemporaines » de ce qu’il appelle une nation (p. 333). Loin de la nation au sens courant du terme, il s’agit, selon lui, d’une appartenance à l’indigénité, reformulée dans une perspective universelle ouverte (p. 131–132). Cela évite au moins les poncifs parfois assénés sur le caractère essencialiste d’une lutte purement ethnique. Mais ce qui est curieux, du point de vue même de F. Lordon, c’est qu’il ignore entièrement, dans sa construction de la supposée nation zapatiste, tout ce qui se réfère à la nation au sens historique du terme13. Dans les rencontres et les fêtes zapatistes, on chante l’hymne mexicain, avant même l’hymne zapatiste, et on rend les honneurs au drapeau national, ce qui ne va pas sans faire grincer bien des dents parmi les sympathisants libertaires – lesquels n’en ont que plus de mérite de tenter de comprendre au-delà de ce que leurs aversions spontanées leur commanderaient de conclure. F. Lordon, qui aimerait tant que l’on parle de la nation autrement qu’en termes de célébration éternitaire ou de répulsion viscérale, aurait donc pu trouver chez les zapatistes, comme auprès d’autres luttes en Amérique latine, une conjonction du projet d’émancipation et de l’attachement à la nation (historique).
Mais le plus intéressant est ailleurs : ce sont (au moins) trois échelles d’appartenance qu’articule le zapatisme, à la fois soulèvement indigène pour la dignité retrouvée et pour l’autonomie, lutte de libération nationale pour transformer le Mexique et rébellion anti-capitaliste pour l’humanité. Même si cette articulation n’a pas toujours été sans tensions, elle transforme le sens de chacun des registres concernés et permet d’écarter les périls que chacun d’eux, pris isolément, pourrait comporter. Ainsi, l’ethnicisme essentialiste est évité au profit d’une conception ouverte de l’indianité, qui ne se laisse pas circonscrire à la revendication d’une identité culturellement définie et constitue bien plutôt le point d’ancrage d’une lutte pour la transformation sociale et politique, associant indiens et non indiens14. Ce que l’appartenance nationale pourrait avoir d’exclusive et d’intolérante est déjoué par sa combinaison avec un internationalisme mis en acte avec constance depuis l’organisation de la Rencontre intercontinentale pour l’humanité et contre le néolibéralisme, en 1996, tandis que l’universalisme abstrait, qui finit par être un instrument de négation des différences réelles entre les femmes et les hommes qui composent l’humanité, est récusé par le fait même de son association avec les autres échelles d’appartenance.
(DR)
Sur ce dernier point, l’expérience zapatiste est riche d’inspiration pour engager la construction d’une autre conception de l’universel. Non un universel abstrait postulant une « humanité générique », mais un universel concret pensé à partir des singularités constitutives de la multiplicité des expériences humaines. Dans la proclamation de la major Ana Maria, lors de la Rencontre intercontinentale de 1996 – « nous sommes tous égauxparce que nous sommes différents » – le paradoxal « parce que » brise l’idée selon laquelle l’égalité et l’unité humaines devraient être définies en dépit des différences entre les individus, les peuples et les sexes. Il revendique une égalité élaborée à partir des différences, sur la base de leur pleine reconnaissance. Au lieu de penser l’humanité en postulant l’identité abstraite de tous les humains et en déniant leur diversité réelle, l’universel peut – et doit – se fonder sur la reconnaissance de la diversité des êtres humains et de la multiplicité de leurs formes de vie. La formule que les zapatistes mettent en œuvre – par exemple dans leurs pratiques éducatives – consiste à viser à la fois plus de soi et plus de l’autre. Ils invitent à penser la complémentarité des appartenances particulières, ancrées dans des expériences territorialisées singulières, et le souci d’une communauté planétaire en quête de son accomplissement. Mais il faut pour cela cesser de postuler un universel générique et faire prévaloir la construction, ô combien ardue, d’une universalité conçue comme traversées mutuelles des singularités.
Anthropologie boiteuse et émancipation triste
« L’expérience zapatiste est riche d’inspiration pour engager la construction d’une autre conception de l’universel. »
S’agissant de la question anthropologique, décisive pour la pensée des formes politiques, F. Lordon entend proposer une position équilibrée : refuser l’idée – « l’illusion occidentale », dirait Marshall Sahlins – d’une nature humaine perverse et égoïste, conduisant à la nécessité d’un pouvoir surplombant (Église, puis État), tout autant qu’une conception postulant « l’exclusivité des passions bonnes », « condition de possibilité anthropologique de [la] forme politique rêvée » de l’horizontalisme (p. 251). Il s’agit de récuser une « anthropologie hémiplégique » (p. 27), qui ne prendrait en compte qu’un seul versant de cet homme bi-face, tissé d’affects passifs et actifs, de convenance autant que de disconvenance passionnelle15. On acceptera une caractérisation qui a l’avantage d’écarter à la fois la nécessité du Léviathan hobbessien et l’idéal d’une société parfaite et sans conflit. Mais, outre que F. Lordon, ici encore, caricature effrontément la pensée libertaire en la ramenant au rêve d’atteindre « les plaines de la paix civile perpétuelle » où règne la « coexistence harmonieuse des communs » (p. 100), on lui reprochera de ne pas tenir l’équilibre annoncé entre les deux versants des penchants humains. C’est que l’enjeu d’Imperium est de faire la guerre à la pensée anti-étatique, en même temps que d’éviter d’être pris en défaut de réalisme anthropologique. C’est donc le versant des tendances à la disconvenance qui est systématiquement souligné et c’est lui seul, ou presque, qui est opérant quant à la détermination des formes politiques viables. Quant à l’autre versant, celui des penchants à la coopération par exemple, il fait l’objet d’une minoration constante et n’ouvre guère d’autre option politique spécifique, selonImperium, que l’illusion de l’associationnisme horizontal. L’anthropologie politique lordonnienne ne marche donc pas sur ses deux pieds, et on peut craindre qu’elle en revienne, sous couvert de spinozisme, à une modalité un peu honteuse d’hobbesianisme. Du reste, F. Lordon n’hésite pas à affirmer que « « sous la conduite des passions plus que de la raison », le monde sans État n’est pas le monde des associations : il est le monde des bandes » (p. 89). Il a beau répéter qu’il faut voir en l’homme et le loup et le dieu, c’est le loup seul, ou presque, qui occupe, chez lui, la scène politique.
Dans ces conditions, quelles sont les chances de l’émancipation ? Imperium en propose une conception prudente et hautement restrictive. Les ambitions émancipatrices sont nécessairement bornées (p. 296) et le communisme est « inatteignable complètement », ce qui n’empêche pas de le désirer (p. 310). F. Lordon multiplie les cautions de « réalisme critique » et prétend récuser à la fois le « déni de servitude passionnelle » et le « renoncement réactionnaire empressé » (p. 301). Sauf que, si vive est sa crainte d’être pris en défaut que, jusqu’à la page 255 du livre, sa manière de raisonner ne diffère guère de celle du « réalisme conservateur ». Les choses changent ensuite, timidement certes, mais cela ne saurait être négligé : ainsi avance-t-il, par exemple, que « rappeler que les modes sont modifiables ouvre une formidable possibilité de principe » (p. 259). Mais on sent l’économiste-philosophe si craintif de se laisser aller à libérer cette « formidable possibilité », de peur sans doute de trop lâcher la bride, qu’il stérilise l’élaboration possible d’une théorie politique de l’émancipation.
(DR)
Il est sans doute judicieux de faire voir ce qu’une révolution ne peut pas – la réalisation magique d’un monde parfait. Et on peut, à la limite, comprendre le souci de la rendre à la fois désirable et crédible. Mais l’excès de prudence (est-elle même réaliste ?) oublie trop de la rendre désirable, en refermant bien vite l’horizon des possibles sur l’existant, le déjà connu. S’il y a bien une chose qui n’a pas sa place sous l’élégance recherchée de la plume lordonnienne, c’est l’enthousiasme. Cela tient peut-être en partie à l’habitus universitaire, pour lequel ce penchant est perçu comme un manquement à l’éthos professionnel de distanciation critique, exposant au terrible soupçon de naïveté. Pourtant, n’y aurait-il pas quelque raison de s’enthousiasmer un tant soit peu, sans pour autant perdre toute vigilance critique, à la pensée de ce que la sortie – difficile, lente, conflictuelle – de la société de la marchandise ouvrirait de possibles inédits ? Mais l’imaginaire lordonnien de l’émancipation fait trop de place aux affects tristes et bien peu aux affects joyeux. Son idée de la révolution est assurément dégrisée, mais elle est aussi bien grise.
« L’auteur d’Imperium lie essentiellement la transformation de l’humain à l’éducation, plutôt qu’à la transformation des conditions mêmes de l’existence. »
Imperium fait toutefois une place remarquable à la puissance transformatrice du moment insurrectionnel, associé à l’intensité de la lutte commune, dans l’urgence et le danger. Pourtant, comme épouvanté par le potentiel de transformation ainsi convoqué, F. Lordon s’empresse de refermer la porte à peine entr’ouverte : cela ne peut être qu’un moment fugace et, dès l’effervescence du moment insurrectionnel passée, prévaut « la stabilisation de nouveaux rapports sociaux ». Après l’incandescence de l’incendie, les froides « cendres de l’ordinaire » (p. 339). Juste quelques jours d’embrasement, puis tout rentre dans la convenance de l’ordre institué, comme si une nouvelle forme de vie était sortie tout armée de l’intensité émeutière. Quelle extravagante conception de la révolution ! – qui reproduit de la manière la plus grossière la mythologie du Grand Soir, pourtant gaussée, et qui évacue toute perspective d’un processus continué, construisant une réalité collective sans cesse renouvelée16. Quant aux expérimentations présentes de formes de vie non capitalistes, elles pourraient avoir la vertu, concède F. Lordon, de produire à froid ce que le moment insurrectionnel engendre à chaud. On aurait alors la confirmation d’un état des affects révolutionnaires à haute température et en même temps durable (p. 264–6). Il faut donc, là encore, faire marche arrière et adopter un point de vue franchement dépréciatif sur ces expériences, qualifiées « d’isolats » pour « virtuoses de la révolution », « voués à ne rassembler que les convaincus ». Mais c’est là coupablement minimiser ce qu’il y a à apprendre d’elles et l’affirmation brille de la gratuité d’une pure pétition de principe : c’est exclure d’emblée une force d’attraction susceptible de s’exercer sur ceux qui n’en sont pas encore – une force qui, le moment venu, pourrait bien s’avérer décisive.
Sans doute est-il salutaire de prendre ses distances vis-à-vis d’une conception totale de l’émancipation, d’admettre les effets potentiellement divergents de la servitude passionnelle et d’écarter le mirage d’une société débarrassée de tout conflit. Mais il convient aussi, symétriquement, de ne pas minimiser les capacités d’auto-transformation et d’inventivité, et de faire toute sa place, en termes de possibilités d’agencements politiques, au versant positif et coopératif d’une anthropologie véritablement bi-face. Visiblement angoissé, F. Lordon craint pour la révolution : « Qui va descendre les poubelles ? » (p. 294). La question n’a rien de triviale, si l’on entend par là l’interrogation sur les « mobiles par lesquels on se plie aux réquisitions de son insertion personnelle dans un agencement collectif ». L’auteur d’Imperium lie essentiellement la transformation de l’humain à l’éducation, plutôt qu’à la transformation des conditions mêmes de l’existence. Il note cependant que l’opposition entre attitudes coopératives ou compétitives dépend, non d’une quelconque nature humaine, mais des « conditions externes telles qu’elles vont induire préférentiellement tels ou tels mécanismes passionnels » (p. 248–9). Ce point est d’une extrême importance et on regrette que F. Lordon s’y intéresse si peu et ne fasse presque jamais mention des différences radicales qui pourraient exister, quant à ces conditions, entre le réel actuel et la pluralité des mondes post-capitalistes. Or, c’est tout à la fois la nature et l’échelle des problèmes à résoudre (par exemple ceux qui découlent des modes de production des déchets) et les formes de subjectivité qui se trouveraient très profondément modifiés. Enfin, la « question des poubelles » pourrait être, sinon résolue, du moins éclairée en convoquant la conception contributive de l’appartenance, proposée par F. Lordon lui-même. Il y a désir de contribuer, parce qu’il y désir d’appartenance. Sans postuler une dissipation de toutes les questions organisationnelles par la seule vertu d’enthousiasmes inépuisables et toujours bien agencés les uns aux autres, on ne saurait minimiser l’énergie des désirs contributifs, dès lors qu’ils sont aussi désir de faire exister la forme de vie que l’on éprouve comme propre (sans exclure qu’en cas de défaillance, le rappel des règles collectives et le recours à une forme de médiation puissent être nécessaires).
(DR)
Il y a, dans l’autonomie zapatiste, matière à rejeter l’opposition que F. Lordon établit entre le feu du moment insurrectionnel et les lendemains de cendre. Car voilà une expérience qui résiste, avance, construit une « utopie réelle » depuis 22 ans, malgré les offensives contre-insurrectionnelles de tous ordres, lancées contre elle. Et elle ne tient que par l’engagement quotidien de ses membres. Il serait vain de nier que la fatigue, pour certains plus que pour d’autres, s’insinue dans cette guerre (d’usure, justement). Mais il y a toutefois assez d’énergie renouvelée pour soutenir durablement le goût de vivre dans la lutte. « Le Chiapas » ne se réduit ni au feu du soulèvement insurrectionnel ni aux cendres d’un ordinaire redevenu gris : ses braises se renouvellent depuis plus de deux décennies, non sans quelques étincelles jaillissant vers d’autres cieux. Les zapatistes nous invitent du reste à une autre conception de l’ordinaire, lorsqu’ils affirment : « Somos rebeldes porque somos gente común [Nous sommes rebelles parce que nous sommes des gens ordinaires] ». Des virtuoses, les zapatistes ? D’humbles virtuoses de l’ordinaire, sans doute. Mais à quoi tient l’énergie subjective tranquille de leur art simple de faire d’autres mondes ? Certainement pas à une quelconque essence indienne (encore qu’on ne saurait négliger le fait que le sens du collectif soit, là-bas, tendanciellement plus développé qu’ici). Durant la « petite école zapatiste », l’un desmaestros nous a demandé : « Et vous, est-ce que vous vous sentez libres ? » Pour eux, la réponse est claire. Ils ont fait le choix de vivre dans la lutte et de construire une réalité inédite ; ils décident eux-mêmes de leur propre manière de vivre et de se gouverner. Il est permis de penser que c’est dans l’exercice même de cette liberté – le fait de décider collectivement pour faire croître en plénitude leur forme de vie – et dans la dignité retrouvée que cela confère que se trouve une bonne part de l’énergie subjective nécessaire pour tracer, jour après jour, le long chemin de la transformation permanente qu’est l’émancipation.
« Des virtuoses, les zapatistes ? D’humbles virtuoses de l’ordinaire, sans doute. Mais à quoi tient l’énergie subjective tranquille de leur art simple de faire d’autres mondes ? »
Ce chemin s’avance vers un horizon, mais n’atteindra nulle cité idéale. F. Lordon clôt l’ouvrage par cette phrase : « La politique de l’émancipation est interminable. » L’un des maestroszapatistes l’avait devancé en déclarant : « L’autonomie n’a pas de fin » (l’autonomie, c’est le nom qu’ils donnent à l’expérimentation de formes politiques non étatiques et, plus largement, à la construction d’une forme de vie inédite). Il s’agissait, par là, de reconnaître l’imperfection de l’autonomie : imperfection présente, mais aussi imperfection principielle, car on n’en a jamais fini avec la lutte contre la possible reproduction d’une séparation entre gouvernants et gouvernées, contre la pétrification de l’institué. Proclamer la pleine réalisation de l’autonomie – ou de l’émancipation – serait le symptôme de sa mort. Mais plutôt que de s’en tenir à l’énoncé d’une impossibilité de l’auto-gouvernement, les zapatistes inventent quotidiennement des formes politiques qui, bien qu’imparfaites et contraintes de lutter contre les dérives de la séparation, se transforment sans cesse, au gré de l’analyse des difficultés et des erreurs commises. Pas de fin, pas de perfection, rien de figé ; mais un auto-gouvernement en acte, tout de même.
*
Au total, Imperium livre quelques mises en garde qu’on peut partager (pas d’humanité entièrement libérée de la servitude passionnelle, pas de monde idéal et sans conflit, pas de forme politique sans risque de séparation et de pétrification). Mais les concepts lordonniens sont d’une élasticité telle qu’ils prêtent à confusion et risquent d’autoriser des glissements subreptices, au-delà de ce que l’argumentation soutient véritablement. Surtout, ils manquent de cette capacité de discernement qui importe tant, du point de vue d’une politique de l’émancipation, et dont l’objet prioritaire devrait être de nous aider à faire le partage, aussi incertain soit-il en ses limites, entre des formes politiques étatiques et non étatiques, entre l’invention de procédures qui favorisent l’accroissement de la puissance du collectif et la dépossession de celle-ci au profit du pouvoir-sur des uns sur les autres. Redisons l’essentiel : Imperium ne parvient pas à jeter aux oubliettes de l’histoire la perspective d’une émancipation sans l’État. De l’État en général, rien ne fonde le caractère indépassable ; quant à l’État général, rien ne justifie de lui donner ce nom, sinon le tour de passe-passe qu’il prétend autoriser. Et quand bien même devrait demeurer ce que F. Lordon nomme ainsi, cela ne contredirait en rien la possibilité de destituer ce que nous continuerons à nommer État.
(DR)
L’horizon de l’émancipation, entendue comme processus toujours en cours, n’est pas la paix civile perpétuelle, ni une quelconque coexistence harmonieuse parfaite. Néanmoins, il serait dommageable de ne pas s’employer à faire valoir, à rebours des pesanteurs systémiques qui prétendent éterniser l’état de fait, que la sortie du monde de la destruction capitaliste ouvre à l’inédit, au-delà même de ce que nous sommes présentement en mesure d’imaginer – alors que, malgré ses dénégations, dans l’univers lordonnien, l’existant borne (trop) le possible. Il ne s’agit certes pas de basculer dans l’idéal, ni de postuler une parfaite maîtrise, surtout si on comprend celle-ci au sens classique de l’autonomie individuelle. Bien au contraire, on pourrait assumer la notion d’appartenance plus radicalement que ne le propose Imperium. Dès lors que, récusant l’idée de l’individu auto-institué, on adopte une conception proprement relationnelle de la personne (selon laquelle celle-ci tient son être même des relations qui la traversent), les collectifs auxquels chacun appartient sont littéralement constitutifs de l’existence singulière. Le collectif dans lequel nous nous insérons, avec ses usages et ses règles, se loge donc en nous et il lui revient parfois de le faire savoir explicitement, sinon abruptement, sous forme de rappel à la nécessaire discipline associée à cette appartenance. Les normes collectives – quelles qu’en soient les modalités – sont modifiables à tout moment, mais il s’agit là d’un processus, non d’une auto-définition ex nihilo permanente. Rien n’est figé dans l’institué, mais la manière de transformer l’existant est tributaire de ce qu’il y a à transformer et qui informe partiellement la manière de vouloir le modifier. La dimension du transindividuel n’est pas hors de portée des collectifs, mais elle échappe par définition à la pleine maîtrise des êtres individués qu’elle contribue à inscrire dans le devenir.
Photographie de portrait de Frédéric Lordon : © Stéphane Burlot
NOTES
1. Frédéric Lordon, Imperium. Structures et affects des corps politiques, Paris, La Fabrique, 2015.
2. Et qu’on ne dise pas que c’est là sombrer dans cette pensée « par modèle » que dénonce F. Lordon. Les zapatistes eux-mêmes n’ont pas cessé de mettre en garde contre la tentation de les idéaliser et de voir dans leur trajectoire singulière un modèle à reproduire. Cela n’empêche pas de se saisir de cette expérience comme d’un point d’appui et d’une source d’inspiration pour aider à penser d’autres situations également singulières.
3. La notion ne suscite que quelques commentaires condescendants, tandis que le livre de Pierre Dardot et Christian Laval (Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle, Paris, La Découverte, 2014) est réduit à la mention de deux phrases isolées et congédié avec dédain (p. 74–75).
4. « La partie politico-militaire de l’EZLN n’est pas démocratique, puisque c’est une armée », Sixième Déclaration de la Selva Lacandona, http://cspcl.ouvaton.org/spip.php?article204.
5. « L’accompagnement se convertit en direction, le conseil en ordre… et l’appui en gêne » (Leer un video, août 2004, http://palabra.ezln.org.mx/).
6. Y, sí, aprendimos (La Jornada, http://www.jornada.unam.mx/2013/08/19/opinion/018a2pol).
7. « Il y a des moments où le peuple dirige et le gouvernement obéit ; il y a des moments où le peuple obéit et le gouvernement dirige » (maestro Fidel, « Petite école zapatiste », août 2013). Pour tout ce qui concerne l’autonomie zapatiste, voir l’analyse plus détaillée dans Jérôme Baschet, Adieux au capitalisme. Autonomie, société du bien vivre et multiplicité des mondes, Paris, La Découverte, 2014 et, avec Guillaume Goutte, Enseignements d’une rébellion. La petite École zapatiste, Paris, Éditions de l’Escargot, 2014.
8. Commentaires de mon Votán lors de la « petite école zapatiste » (à chacun des milliers d’invités était attribuée en propre une personne chargée de prendre soin de lui et de dialoguer de manière interpersonnelle).
9. Récusant une conception libertaire qui consisterait en « une négation du pouvoir », Tomas Ibañez, par exemple, distingue utilement trois sens du terme « pouvoir » (capacité de, relation dissymétrique entre agents, macrostructures de régulation et contrôle), soit précisément ce que l’approche lordonnienne écrase (« Pour un pouvoir politique libertaire », 1983, http://www.grand-angle-libertaire.net/pour–un–pouvoir–politique–libertaire–thomas–ibanez/). Voir aussi Vivien Garcia, L’anarchisme aujourd’hui, Paris, L’Harmattan, 2007, qui distingue, par exemple, relations autoritaires et relations d’autorité légitime.
10. « Tous les groupements politiques sont des États au sens de l’État général », p. 122.
11. On peut définir l’État (en général) par la combinaison de deux caractéristiques : le weberien « monopole de la violence légitime » et une séparation consolidée entre qui est destiné à figurer du côté des gouvernants et qui est voué au statut de gouverné, soit en langue lordonnienne (mais déplacée par rapport aux énoncés d’Imperium) la capture de la puissance du collectif par un de ses sous-ensembles (souverain, caste, classe politique dissociée, appareil bureaucratique fondé sur la revendication d’une compétence sélective et organisant le consentement des dominés à la gestion du monde conformément aux intérêts dominants).
12. Référence pourtant canonique, l’ouvrage de Benedict Anderson – Imagined Communities, dans la version originale – n’est mentionné qu’un seule fois, du bout de la plume (L’imaginaire national, Paris, La Découverte, 2006).
13. Voir ses contorsions cocasses (p. 131) pour expliquer, en référence à sa propre définition, le sens du mot « national » dans l’acronyme de l’EZLN, alors qu’il s’agit d’un héritage de la tradition anti-impérialiste latino-américaine.
14. Sur tout ceci, voir J. Baschet, « Autonomie, indianité et anticapitalisme : l’expérience zapatiste », dans Les Amériques indiennes face au néolibéralisme, Actuel Marx, 56, 2014, p. 23–39.
15. On laisse de côté la discussion sur la notion de « nature humaine » que F. Lordon admet, en s’inspirant de Spinoza, en un sens faible, « sous-déterminé » et éminemment flexible (les hommes sont modifiables), mais qu’on peut tout aussi bien préférer ne pas utiliser, tant elle est chargée d’une dimension fixiste, dont on aura peine à la débarrasser.
16. A propos du Grand Soir, relevons cette affirmation curieuse : « Si la révolution politique de l’horizontalité appelle comme sa condition de possibilité une révolution morale, le problème des révolutions morales c’est qu’elles ne connaissent pas le Grand Soir. » (p. 269). Truisme, encore. Mais qui croit encore à la mythologie du Grand Soir, les adversaires que F. Lordon se donne ou lui-même ?
REBONDS
☰ Lire « Ne vous sentez pas seuls et isolés — par le sous-commandant Marcos » (Memento), avril 2015
☰ Lire « Daniel Bensaïd : Du pouvoir et de l’État », (Texte inédit), avril 2015
☰ Lire notre entretien avec Michael Löwy, « Sans révolte, la politique devient vide de sens », décembre 2014
☰ Lire notre entretien avec Guillaume Goutte : « Que deviennent les zapatistes, loin des grands médias ? », novembre 2014
…
Je pense que Lordon a raison de dédiaboliser les mots État et nation, parce que nous en avons besoin pour résister aux plus grands prédateurs capitalistes. Et plusieurs des reproches que lui fait Baschet à la fin sont mal fondés (à mon sens).
Dans cette intéressante controverse, les protagonistes négligent tous les deux, je trouve, la possibilité (et l’intérêt) d’une appropriation populaire du processus constituant : un peuple devenu constituant saurait fort bien limiter et contrôler le pouvoir vertical dont il a besoin.
…
Toujours est-il que j’ai ensuite commencé à travailler le livre de Jérôme Baschet, « La rébellion zapatiste » (2002), initialement intitulé « L’étincelle zapatiste », et je le trouve absolument passionnant :
Encore un beau grand chantier pour progresser vers l’auto-institution d’un régime politique juste et pacifiant.
Étienne.
________
Page Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10154202864567317
[incroyable] BRAQUETONBANQUIER.COM 🙂
Le corps social commence à s’insurger contre les usuriers.
Paul vient de publier un site pour nous défendre contre les pratiques malhonnêtes des banquiers.
Il l’a appelé braquetonbanquier.com 🙂

En attendant de changer vraiment les institutions, et entre deux mini ateliers constituants avec vos proches et vos collègues de travail, vous pouvez toujours aider Paul : faites passer 🙂
Page Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10154200482022317
Une pensée profonde et généreuse d’Ana, pensée utile pour accélérer et polariser notre prise de conscience, et enforcer notre exigence
Une pensée profonde et généreuse d’Ana, pensée utile pour accélérer et polariser notre prise de conscience, et enforcer notre exigence.
https://www.facebook.com/ana.sailland/posts/1756667707884852
Les gens qui ne trouvent pas d’emploi ne sont pas des paresseux.
Ils sont en réalité l’avant garde des milliards d’individus qui un jour ne trouveront pas d’emploi rémunéré, pour cause de technologie avancée, reléguant aux oubliettes l’obligation de suer, de donner son temps, voire son sang, de se vendre ou de se brader pour mériter pitance, et souvent pingre.Un jour, pas si lointain que ça, le dividende universel ne sera pas une revendication mais un passage obligé, une nécessité.
Sauf à accepter que ces milliards d’individus libérés de la nécessité du travail contractuel ne meurent de cette liberté nouvelle.
Il ne faut pas croire que le dividende universel sera alors une incitation à l’oisiveté. Bien au contraire : libérés de l’obligation de se vendre, les gens pourront se passionner.
« Tu vivras à la sueur de ton front » est une maxime moribonde.
La passion créatrice et la pulsion de contribution seront un jour le moteur essentiel de l’action participative. Dommage qu’on doive attendre la nécessité pour comprendre. Car déjà maintenant cette repolarisation est possible.
Lisez aussi les commentaires : Ana est passionnante à tout instant…
Par exemple :
Ana Sailland :
« Chacun est libre d’être pessimiste, c’est un droit fondamental que je ne suis pas légitime à vous contester. Mais si donc la nature humaine est mauvaise, laissez nous dans ce mauvais piège qui consiste à la penser bonne.Maintenant, vous remarquerez quand même qu’à dividende universel, vous répondez revenu de base. Ce n’est pas équivalent du tout. Si un revenu de base n’est qu’un revenu, dont le montant est à négocier en effet entre dominants et dominés, un dividende universel est un droit universel au gâteau universel, hérité de la Terre, hérité du grand œuvre passé, autant que du présent, il n’est pas une aumône concédée à la piétaille pour la maintenir silencieuse et docile, il est au contraire l’une des conditions nécessaires et suffisantes pour faire du peuple le Souverain et non plus le quémandeur. Il est un changement de paradigme profond, qui opère la transition de la civilisation du contrat truqué vers la civilisation du partage et de l’abondance, la transition de la pingrerie conditionnelle vers des jours heureux car inconditionnels. »
Autre lumière allumée par Ana :
Anna-Bea Duparc :
Hey les gars!!! Vous savez que quel que soit le résultat de cette votation on est en train de faire un truc incroyable ? On est en train de créer un mouvement citoyen en Suisse…! On est + de 20’000 ! En dehors des partis politiques, des milliers de citoyens sont en train de se mobiliser pour le RBI et de s’activer en ce moment même… de tracter un peu partout, de parler autour d’eux d’un projet auquel ils croient et d’espoir pour demain. C’est beau, presque incompréhensible… et ça me rend heureuse !Cette initiative, contrairement à presque toutes les autres, est réellement populaire, elle est portée par le peuple, soutenue par des gens qui pour beaucoup n’avaient jamais fait de politique. Des gens qui n’ont pas d’intérêts à défendre et ne sont pas payés pour porter ce en quoi ils croient. Des citoyens qui, parce qu’ils ne font pas métier en politique, sont libres de penser sans pression.
Nous sommes nombreux à préparer l’avenir, à vouloir que nos vies soient alignées sur beaucoup plus que nos fiches de paie, à vouloir libérer l’incroyable créativité présente en chacun, ressource renouvelable, inépuisable. Humains, libres, debout, heureux, au service de nous-mêmes, des autres et de la vie sur cette terre. Humains qui font un pas de côté pour penser leur vie en dehors de la rentabilité.
Je ne suis pas née pour produire, je suis née pour vivre, pour développer mon potentiel, pour grandir, pour aimer. Gagner ma vie m’a toujours paru un concept infiniment étrange. Mon travail chaque jour est d’apprendre à donner le meilleur de moi-même. C’est précieux la vie…
Je vous conseille de suivre les réflexions d’Ana Sailland, c’est quelqu’un d’important, une magicienne des mots décapants 🙂
Étienne.
PS :
• Le chômage n’est pas qu’une conséquence de la mécanisation, il est AUSSI une construction politique pour intimider les pauvres et les rendre dociles :
httpv://youtu.be/_x1eck6ZHks
• Le chômage est un des fouets des négriers (prétendument « libéraux ») ; le chômage sert à terroriser les salariés pour qu’ils cessent de revendiquer et acceptent de se faire voler :
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2011/06/22/130–uelutte–contre–l–inflation–prioritairechomage–institutionnalise–etes–vous–d–accord
_______
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10154199215597317
L’autorité, analysée par Yann Martin (EM Strasbourg)
Je vous recommande cette conférence sur l’autorité (et les pouvoirs, les abus de pouvoir, les ruses des pouvoirs, etc.), absolument passionnante d’un bout à l’autre :
Yann Martin : l’autorité
httpv://youtu.be/jHfTJe4-XLQ
Ça s’écoute et se réécoute le crayon à la main.
Il faudrait retranscrire les meilleures formules, et les publier ici en commentaires, pour nous aider à les digérer ensemble.
Toutes ces clefs nous serviront sans doute, dans notre apprentissage populaire des différentes façons d’organiser et de limiter les pouvoirs.
Hâte de vous lire à ce propos 🙂
Étienne.



Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10154179279577317
————————
[Edit (8 juillet 2016) : Anne nous a retranscrit toute la conférence (quel boulot !!!):
L’autorité
Yann Martin
Je vous propose de commencer par un lieu commun en vous rappelant qu’en philosophie il est toujours de bon ton de commencer par le plus simple, quitte à interroger à partir de là ce qui pourrait ressembler à des lieux communs, à des clichés, et à des idées reçues. Il se trouve que ça tombe bien avec le thème de l’autorité parce que les idées reçues sur l’autorité ça ne manque pas.
Le lieu commun le plus classique c’est celui qui consiste à affirmer que nous traversons aujourd’hui une crise de l’autorité qui serait même pour certains, une crise majeure, et pour les plus alarmistes une crise sans précédent, et que cette crise de l’autorité se manifesterait en particulier à travers quelques victimes qui en subiraient des dommages collatéraux : Les politiques, les prêtres, les enseignants…
S’il est vrai que nous traversons aujourd’hui quelque chose qui est une crise d’autorité, cette crise ne date pas d’hier. Je voudrais vous rappeler à propos de Nietzche qui écrivait déjà dans le crépuscule des idoles : On se croit en danger d’esclavage dès que le mot autorité se fait seulement entendre. Ca veut dire qu’on est dans la deuxième moitié du 19ième siècle et que Nietzche fin observateurs des mœurs de son temps, remarque déjà le problème avec le mot lui-même qui est devenu insupportable aux oreilles de ses contemporains.
Cette crise d’autorité dont je ne nie pas le caractère contemporain, se manifeste d’une double façon :
- d’abord par une sorte de mise à mal des hiérarchies. La hiérarchie au sens étymologique c’est le pouvoir en ce qu’il a de sacré (hiéros en grec : le sacré / arché : le pouvoir). Or s’il y a une chose qui semble relativement claire c’est que la revendication d’autonomie qui est une composante de la pensée occidentale, a produit une mise à mal des hiérarchies, qui aujourd’hui n’ont plus grand-chose de hiéros, qui n’ont plus grand-chose de sacré. Elles nous semblent si peu sacrées, si peu légitimables qu’elles semblent souvent au contraire à la fois oppressives et arbitraires. Là où il y aurait des hiérarchies, nombreux sont ceux qui ne voient qu’oppression, exercices arbitraires du pouvoir.
- La deuxième manifestation de cette crise de l’autorité tiendrait peut-être dans la manière dont nous pensons aujourd’hui l’égalité, comme si la seule égalité qui vaille était une égalité purement horizontale sans la moindre dissymétrie. Cette idée sans doute fausse que là où il y a des hiérarchies, là où il y a des subordonnées c’est l’égalité elle-même qui serait mise à mal. Or il y a là sans doute une mauvaise conception de l’égalité, une fausse représentation de l’égalité, mais qui explique en partie le discrédit qui affecte aujourd’hui la question de l’autorité.
En même temps ce qu’il y a de bien dans une crise c’est que ça permet de voir un peu mieux ce qu’on voyait très mal auparavant. Tant que l’autorité fonctionne, dans les sociétés traditionnelles, on n’a pas à se demander ce qu’est l’autorité, on n’a pas à se demander ce qu’est le pouvoir, on n’a pas à se demander ce qu’est le sacré, on n’a pas à se demander ce qu’est une hiérarchie, quand il n’y a pas de problème ça va de soi. L’avantage d’une crise c’est que ça nous oblige à penser ce que d’ordinaire nous ne pensons pas et ça nous oblige à nous demander : mais qu’est ce qu’il en est de cette autorité qui nous semble aujourd’hui, à tort ou à raison, dans une situation critique ?
Et cette crise d’autorité manifeste déjà quelque chose, elle nous fait découvrir que le pouvoir ne suffit pas à ordonner la société. Parce que le pouvoir ça existe toujours, ça a toujours existé. S’il y a crise de l’autorité aujourd’hui, ce n’est pas parce qu’il y aurait défaut de pouvoir mais cette crise de l’autorité se manifeste justement quand ceux qui sont sensés avoir le pouvoir ne sont plus en mesure de l’exercer de manière efficace ou quand leur légitimité dans l’exercice de leur pouvoir, se trouve contestée.
Mais si la crise de l’autorité se manifeste lorsqu’est remise en question la légitimité du pouvoir, ça nous fait découvrir que le pouvoir ne suffit pas à ordonner, le mot « ordonner » est à entendre avec une oreille décrassée, ordonner ce n’est pas seulement commander, ce n’est pas seulement donner un ordre, bien sur que tout pouvoir est pouvoir d’ordonner, seul celui qui a le pouvoir peut donner l’ordre de faire quelque chose. Mais ordonner, dans un sens plus courant, plus modeste, c’est mettre en ordre, c’est mettre de l’ordre. Et cette crise de l’autorité qui manifeste une certaine impuissance du pouvoir, nous montre que quand le pouvoir est nu, quand le pouvoir est brut, quand il est abandonné à lui-même, quand il n’est rien d’autre que le pouvoir, il échoue aussi bien à mettre de l’ordre qu’à donner des ordres.
Le pouvoir ne suffit pas à l’autorité et il y a une conséquence que vous pouvez dégager immédiatement, c’est que l’autorité c’est autre chose que le pouvoir. Non seulement l’autorité c’est autre chose que le pouvoir mais il semble bien qu’elle puisse parfois se passer de lui et qu’on puisse parler avec autorité alors même qu’on n’a quasiment aucun pouvoir. Vous connaissez peut-être une parole qui revient souvent dans les évangiles, on dit que Jésus parlait avec autorité, je ne sais pas quelle est cette autorité particulière qu’on lui attribut mais elle n’est pas l’autorité de quelqu’un qui serait doté d’un pouvoir.
Si je poursuis ma réflexion, je voudrais aussi vous mettre en garde contre un risque de malentendu, c’est que ce substantif « autorité » est sensé correspondre à un adjectif qui est « autoritaire ». On serait tenté de dire ce n’est pas compliqué, est autoritaire celui qui a de l’autorité, il suffit que je le dise pour que vous vous rendiez compte que ce n’est absolument pas vrai. L’autoritaire est peut-être celui qui a si peu d’autorité qu’il est obligé de la sur-jouer, qu’il est obligé d’en rajouter et qu’il se retrouve par conséquent dans une posture faussée . L’autorité véritable pourrait être ce qui me dispenserait d’avoir à être autoritaire, ça veut dire aussi que l’autorité véritable n’est pas à chercher du côté des autoritaires, elle est sans doute à chercher ailleurs.
Pour comprendre de quoi il s’agit il nous faudra distinguer ce que nous sommes parfois tentés de confondre. Je n’arrête pas de dire depuis des années que la philosophie c’est d’abord l’art de mettre de l’ordre dans les concepts et de distinguer ce que le discours commun tente à confondre. Quand on commence à ordonner, à mettre de l’ordre, à distinguer, on commence à y voir plus clair et on peut commencer à s’entendre parce qu’on multiplie les chances d’être d’accord sur ce dont on parle.
Or justement ce qu’on risque de confondre ici c’est trois notions : Le pouvoir, la puissance et l’autorité. En produisant ces distinctions on va peut-être se donner les moyens de commencer à y voir un peu clair.
- Le pouvoir (je reprends la définition de Julien Freund, philosophe et sociologue) c’est le commandement structuré socialement et partagé en fonctions hiérarchiques. Ce qui est important ici sont les termes commandement et hiérarchie. Celui qui a le pouvoir a le pouvoir de commander au nom du caractère reconnu comme légitime du pouvoir qui est le sien et qu’il est habilité à exercer. Pas de pouvoir sans hiérarchie, pas de pouvoir qui ne soit en même temps pouvoir de commander.
- La puissanceelle est capacité à faire ou à faire faire. Si je sais faire quelque chose j’en ai la puissance, mais en même temps si je peux le faire faire c’est que j’ai bien une puissance qui m’est reconnue, aussi mystérieuse soit-elle, qui me permet de produire un effet. La puissance se mesure aux effets concrets quelle produit.
Le pouvoir est du côté du droit, de la reconnaissance d’un droit ; la puissance est du côté du fait et de l’effectivité. Le pouvoir réel est bien évidemment un pouvoir puissant. Un pouvoir réduit à l’impuissance ne serait que nominal et formel.
Celui qui a la puissance peut l’avoir pour différentes raisons, il peut avoir la puissance parce qu’il dispose du savoir faire, il peut avoir la puissance parce qu’il dispose d’un pouvoir coercitif (la puissance parentale par exemple, qui est autre chose que l’autorité parentale, peut s’accommoder d’une part de coercition, l’enfant est contraint d’obéir à ses parents). La puissance peut passer par le savoir-faire, la compétence, qui peut s’exercer à travers la coercition, peut s’exercer aussi par la persuasion. La puissance peut-être douce et souple, elle peut être la capacité à faire faire à quelqu’un ce dont on est parvenu à le persuader. La puissance peut être de l’ordre de la compétence, elle peut être coercitive, elle peut être persuasive.
- L’autorité c’est ce qui exclu aussi bien la contrainte que la persuasion. Si j’ai recours à la contrainte ou si je suis obligé d’avoir recours à la contrainte c’est que je manque d’autorité. L’autorité n’a pas à jouer le jeu des discussions interminables au cours desquelles j’essaierai de persuader quelqu’un de ce qui est bon pour lui. Le mystère et la magie de l’autorité c’est quelle n’a pas besoin de l’arsenal de la puissance pour produire des effets. L’autorité comme le pouvoir a avoir avec le droit, celui à qui je reconnais une autorité c’est celui a qui je reconnais le droit de dire ce qu’il dit ou de faire ce qu’il fait. Il n’y a d’autorité véritable que là où il est reconnu qu’il a le droit de parler et d’agir comme il le fait, l’autorité ne tient que par le droit reconnu à celui dont on reconnait l’autorité.
L’enjeu de mon propos sera de chercher la source de ce droit, d’où vient ce droit reconnu à certains de parler ou d’agir avec autorité. On peut déjà remarquer l’effet majeur de l’autorité, c’est qu’elle met de l’ordre dans les relations sociales, la famille, l’entreprise, une association. S’il n’y a pas de pôle d’autorité dans une entreprise, c’est le désordre, quand bien même il y aurait un pouvoir bien déterminé, quand bien même on saurait qui est le chef et comment est structurée la société.
Je dirais donc que si le pouvoir est le pouvoir en tant que donner l’ordre, c’est-à-dire commander ; l’autorité est l’autorité en tant qu’elle met de l’ordre. Et il va de soi que dans toute société on a besoin des deux, on a besoin d’un commandement qui assure la circulation des ordres on a besoin d’une autorité qui rend possible la mise en ordre.
Pour le dire autrement, elle substitue des relations de subordination à des relations de domination. Là non plus il ne faut pas confondre les deux, dans le mot subordination vous entendez le terme « ordre », être subordonné ce n’est pas être soumis, c’est recevoir sa place d’un ordre qui me surplombe et à partir duquel je reconnais mon rôle et ma fonction. Etre subordonné c’est être placé sous un ordre à partir duquel je reçois la place et la fonction qui est la mienne.
Etre dominé bien évidemment c’est subir l’emprise de plus fort ou de plus puissant que soi. Les relations sociales sont parfois de simples relations de domination, bien ça veut dire que ça marche mal. Quand une société est fonctionnelle, quand elle assure la circulation de l’ordre, c’est qu’elle a su substituer des relations de subordination à des relations de domination.
Cette distinction en subordination et domination va me servir d’arrière plan pour chercher la source et les conditions à partir desquelles on pourra penser les effets d’une autorité authentique. L’autorité implique bien quelque chose qui est de l’obéissance, mais une obéissance qui est autre chose que la soumission, autre chose que la servitude. Donc pour que mon obéissance puisse être vraiment obéissance et non pas soumission, qu’est ce que doit être l’autorité ? Ou bien, ce qui revient au même, qu’est ce que peut être le pouvoir quand il accepte de ne pas être réduit au jeu barbare d’une simple domination coercitive ? Vous comprenez bien que l’enjeu de mon topo c’est de repenser les liens de subordination qui n’ont pas grand-chose à voir avec les distinctions faciles et faussées entre inférieur et supérieur. Je crois que quand on aura banni de notre discours des termes qui sont infâmants et qui ne disent pas la réalité des rapports d’autorité, nous aurons peut-être contribués à pouvoir mettre de l’ordre dans les relations sociales quand nous sommes vis-à-vis d’elles investis d’une certaine responsabilité.Penser l’autorité comme ce qui structure des rapports de subordination sera peut-être nous dispenser d’un pouvoir qui ne serait rien d’autre que la constitution de rapports de domination supérieurs / inférieurs.
Comment fonctionne le pouvoir et sur quoi ça bute ? Quand on comprend comment marche le pouvoir on est amené à comprendre ce qui fait sa faiblesse et ce qui fait le caractère nécessaire et indispensable de l’autorité.
Le pouvoir est un thème qui mériterait à lui seul une conférence. Je vais me contenter d’une approche qui joue avec trois personnages pour qui j’ai une grande affection : Saint Augustin qui a vécu il y a très longtemps, l’autre un peu plus proche Pascal et encore plus proche Pierre Bourdieu, Pierre Bourdieu qui a d’ailleurs écrit « les méditations pascaliennes », et Pascal qui est un Augustinien, au fond il y a bien une filiation assez naturelle qui va d’Augustin à Pascal et à Bourdieu. Ils ont ceci de commun, (même si je ne suis pas tout à fait d’accord) qu’ils considèrent que les relations sociales sont toujours fondamentalement, constitutivement, des relations de domination. Qu’est ce que c’est que la vie sociale ? Pour n’importe lequel d’entre eux c’est le jeu qui correspond au fait que chacun veut dominer chacun, et ce jeu structure ou déstructure, aussi bien les familles que les associations ou les entreprises ou la politique. Une fois qu’on a dit qu’il y a société là où chacun aspire à dominer chacun, on bute sur le fait que tous ne sont pas aussi forts et qu’il faut bien que certains consentent à être dominés. Mais si nous consentons à être dominés ce n’est jamais de gaité de cœur parce que nous avons reconnu notre faiblesse ou notre position basse, c’est pour s’assurer par là même, une marge de domination possible. Un exemple tout bête : Si je consens à ne pas être le meilleur de ma classe et à reconnaitre ceux qui sont plus forts que moi aussi nombreux soient-ils, il faut bien une compensation symbolique, qu’on me reconnaisse alors comme le plus drôle, comme le boute-en-train de service, comme le plus sportif ou le plus sympa… ou à la limite comme le plus agressif peu importe, mais il faut quelque part qu’une plus-value symbolique me soit reconnue et accordée. Je ne peux tenir ma place dans l’ordre social qu’à condition que ma libido dominandi pour parler comme Saint Augustin, ma pulsion de domination trouve des possibilités de satisfaction.
Donc Augustin je viens de vous le dire, rattache cela à la libido dominandi et il rattache cette libido dominandi à l’amour propre, au fait que corrompu par ce qu’il appelle le pêché originel je me préfère moi-même à tout autre et me préférant moi-même à tout autre je trouve juste d’être en situation de pouvoir dominer tout autre possible.
Pascal reprend ce jeu de la libido dominandi et il en fait le principe même de la politique et des stratégies de pouvoir. Pour Pascal la politique c’est ce jeu par lequel chacun veut le pouvoir parce qu’il est convaincu d’être le seul légitime pour l’exercer et qu’il a un droit absolu de domination sur autrui. Et pour Pascal c’est le nerf de la guerre, c’est le nerf de la politique. Le problème, et là Pascal devient un très fin penseur politique, c’est que si ça se savait on ne jouerait pas le jeu et on n’accepterait pas d’être gouvernés par ceux-là même qui voudraient nous imposer leur libido dominandi. Pascal dit que la ruse du pouvoir politique c’est de réussir à camoufler la vérité du jeu politique, c’est-à-dire de réussir à cacher suffisamment l’instinct de domination pour que ça puisse passer par exemple pour un service du bien commun, un service public. Pascal n’est pas un cynique, ce n’est pas quelqu’un qui dit tous pourris et je crois qu’il aurait tort s’il le disait, c’est quelqu’un qui nous dit que la société est telle, que tout homme est asservi par la libido dominandi, que chacun veut dominer chacun et si on laisse libre cours à cette pulsion de domination il n’y a plus de société possible. Il faut donc bien que nous soyons gouvernés. Et ceux qui nous gouvernent par là même satisfont leur libido dominandi, mais il faut qu’ils puissent la satisfaire, il faut qu’ils puissent exercer le pouvoir pour pouvoir brider nos passions et rendre possible la vie sociale malgré la libido dominandi. Il faut qu’ils rusent avec nous, il faut qu’ils nous trompent, même s’ils nous trompent pour notre bien. Pascal disait que le plus sage des législateurs (et il pensait à Saint Augustin) affirmait que pour le bien des hommes il est souvent nécessaire de les piper. De les tromper, de les abuser, de les circonvenir, de flatter leur libido dominandi de manière à leur permettre de vivre ensemble. Et comment on flatte la libido dominandi de ceux dont on est responsable ? En multipliant dans la société des situations concurrentielles qui permettent à chacun de recueillir le bénéfice symbolique de sa propre puissance individuelle. Donc pour Pascal qu’est ce que c’est que la société ? C’est un espèce de champ de force structuré par des rapports de force, quand chacun veut dominer chacun, chacun en même temps à besoin de chacun. Si j’assassine tous ceux qui sont autour de moi sous le prétexte de satisfaire de manière absolue ma libido dominandi, je ne pourrais plus dominer personne et en plus il n’y aura plus personne pour me reconnaitre comme le plus puissant et le plus fort. A quoi bon être le plus fort si je n’ai pas face à moi des individus qui me renvoient l’image de ma force.
C’est ça la société pour Bourdieu. C’est ce jeu de rapport de force qui est telle que chacun est en position d’être pour chacun le miroir de sa propre puissance et chacun peut satisfaire dans son ordre propre sa libido dominandi.
La forme la plus simple de la domination, pourrait-on croire, c’est la force. La force a un avantage qu’avait bien vu Pascal et Jean de la Fontaine, elle ne se discute pas. On peut toujours discuter pour savoir si vous êtes plus intelligents que moi, on peut discuter pour savoir qui est le plus beau, le plus gentil, le plus humble, mais pour savoir qui est le plus fort ce n’est pas la peine de discuter il suffit d’un ring, frappez-vous dessus, le premier qui tombe c’est le plus faible, je vais l’exprimer comme Pascal : La force est très reconnaissable et sans dispute ; ou à la façon de La Fontaine : La raison du plus fort est toujours la meilleure, quelques soient les arguments de l’agneau de toute façon il finira pas se faire bouffer par le loup et le loup aura prouvé qu’il est bien le dominant.
La force est pratique, pourquoi l’ordre social ne serait pas assuré par la force puisqu’elle est indiscutable, mais le paradoxe de la force est qu’elle est toujours insuffisante, le paradoxe de la force c’est qu’en réalité elle est toujours faiblesse. Pour citer Rousseau : le plus fort n’est jamais assez fort pour rester le maitre, et pour une raison toute simple c’est que d’abord le plus fort va vieillir, il va devenir plus faible, le pouvoir qu’il se sera acquis sera évidemment très vite menacé par plus fort que lui, puis il y a une deuxième raison c’est que même s’il reste fort assez longtemps il suffit que deux ou trois se liguent contre lui et sa force viendra buter sur une force plus grande. Le paradoxe de la force est qu’alors même qu’elle est sans dispute, incontestable, elle est dotée d’une faiblesse qui la rend insuffisante pour s’assurer l’acquisition et la conservation du pouvoir. Ce que savent tous les politiques à part peut-être les tyrans (et encore ils font semblant de pas savoir), c’est qu’au fond la force ne suffit jamais, ni pour conquérir, ni pour conserver le pouvoir, il faut autre chose. Il faut au plus fort quelque chose qui ne relève pas simplement de sa force, le plus fort va devoir ruser. Il va devoir nous dit Rousseau : Transformer sa force en droit et l’obéissance en devoir, extrait du « contrat social » livre 1, chapitre 3. Il faut qu’il nous convainc qu’il est le plus fort, ca c’est facile il suffit qu’il nous tape dessus, mais il faut qu’il arrive à nous persuader que sa force même lui donne le droit de l’exercer, qu’il a le droit de nous gouverner parce que c’est le plus fort. Au passage c’est la stratégie du loup dans « le loup et l’agneau », le loup met un temps fou à dévorer l’agneau, il discute 107 ans avec lui, il écoute les arguments de l’agneau. Pourquoi ? Parce que le loup ce qui l’intéresse n’est pas seulement de dévorer l’agneau, il n’est pas seulement tenaillé par la faim, la libido dominandi c’est plus puissant que la libido habendi, le loup ce qu’il aimerait arracher à l’agneau c’est la reconnaissance de son droit à le dévorer, c’est un pervers le loup. L’agneau il ne joue pas le jeu, il discute, il pinaille, il n’est pas d’accord et résultat il se fait bouffer mais pour le loup c’est un échec, il a raté quelque chose, il n’a pas réussi à transformer sa force en droit, et la stratégie du pouvoir c’est toujours de transformer la force en droit et l’obéissance en devoir. Le pouvoir ne se satisfait jamais de l’obéissance, il faut que cette obéissance soit considérée comme du, le pouvoir ne consiste pas seulement à dire « obéissez-moi », mais « vous devez m’obéir ». Et dire vous devez m’obéir veut dire non seulement subir le pouvoir qui est le mien mais vous devez en reconnaitre la légitimité. Bref la force est si fragile que pour se transformer en pouvoir elle requière d’être justifiée, elle demande à être légitimée. Mais là encore on bute sur une difficulté, comment pourrait-on légitimer la force que nous reconnaitrions comme une force supérieure et que nous transformerions en pouvoir en la légitimant ? Ce n’est pas possible ! Si la libido dominandi est le lot de tous quelque chose devrait résister, on ne devrait pas jouer le jeu, on le joue tous, on accepte tous l’idée que le plus fort, à condition que ça joue pas à 53 voix près, c’est celui qui légitimement est là pour dominer, pour gouverner, pour exercer son pouvoir. Et que faut-il pour ça ? Quelque chose de tout simple qu’avait bien remarqué Pascal, il faut qu’on y croie, il faut que celui qui exerce le pouvoir produise en même temps des effets de croyances. C’est-à-dire que celui qui veut dominer parvienne à nous faire croire que son pouvoir est légitime. Ca ne veut pas dire qu’il s’agit simplement pour lui de nous duper et de nous tromper, faire croire à quelqu’un ce n’est pas forcément lui vouloir du mal. Si je fais croire à un ami gravement malade qu’il a toutes les chances de guérir s’il se soigne, même si j’y crois pas vraiment moi-même, j’augmente pour lui les chances de guérison, si je laisse croire à l’élève en grosse difficulté qu’il va progresser s’il s’accroche, je ne le fais pas pour le tromper mais pour l’aider à progresser. Le jeu du pouvoir c’est de réussir à produire des effets de croyances, selon Bourdieu, selon Pascal, selon Machiavel… c’est-à-dire de réussir à ce qu’on croit en lui parce que ça ne tiendra pas si on n’y croit pas. Ca marche à un niveau tout simple si vous n’étiez pas là entrain de croire que j’ai un minimum de compétence pour vous parler de l’autorité, ça ferait longtemps que vous seriez partis. C’est parce que vous croyez que j’ai un droit particulier à être moi derrière ce bureau alors que vous êtes assis sagement sur vos chaises, que je peux parler dans une situation qui est globalement une situation d’ordre, ça marche parce que vous y croyez. Un des grands théoriciens de l’autorité Max Weber, rattache toutes les formes de l’autorité à des procédures de croyances, on peut noter dans « le savant et le politique » Weber distingue trois types d’autorités : Une qu’il appelle « traditionnelle », l’autre qu’il appelle « charismatique » et la troisième qu’il appelle « l’égal rationnel », il considère que ce qu’elles ont en commun c’est qu’elles sont toutes fondées sur la croyance et à partir de là il construit un concept de herrshaft, pouvoir, autorité… on ne sait pas trop bien comment le traduire le herrshaft de Weber, domination, maitrise, commandement… mais ce qu’il appelle herrshaft c’est ce qui ne fonctionne qu’à condition de susciter une adhésion, il n’y a d’autorité véritable que si j’adhère à celui dont je reconnais l’autorité et je ne peux y adhérer qu’à condition d’y croire. Je vous renvoie à un petit ouvrage éclairant, de Myriam Revault d’Allonnes « Le pouvoir des commencements », elle connait très bien Max Weber, je la cite : Est rationnel laherrshaft fondée sur la croyance en la légalité des règles instituées. Est traditionnel la herrshaft fondée sur la croyance en la sainteté des traditions éternellement valables. Est charismatique la domination fondée sur la dévotion à l’égard du caractère sacré de la force héroïque ou de la valeur exemplaire d’une personne. Quelque soit la forme de l’autorité évoquée par Max Weber, elle n’existe comme puissance, comme herrshaft que dans la mesure où on y croit. Pour que le pouvoir puisse s’exercer durablement il faut qu’il puisse produire des effets de croyance.
Comment fait-il ? Il fait en sorte que ce qui est fort soit juste, si vous me trouvez cynique, je suis persuadé de ne pas l’être, je vous prends un exemple très simple parce que dans nos sociétés démocratiques on pourrait dire qu’est ce que c’est la démocratie ? C’est ce qui justifie des rapports de droit, des rapports de force, on va laisser ça pour le catéchisme républicain, ce n’est pas ça le fonctionnement réel de la démocratie. Je prends un exemple tout bête, vous êtes à l’assemblée nationale, vous avez un projet de loi à défendre, il va y avoir des discussions, des débats, des arguments, puis un vote, puis en fonction de la majorité le projet de loi s’il est validé sera reconnu comme légitime. Très bien, mais au fond ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les plus nombreux seront les plus forts et que le projet de loi sortira parce qu’il aura pour lui une majorité capable de le défendre. Ce sont les plus forts parce que les plus nombreux qui parviendront à faire passer un projet de loi qui sous une autre majorité ne serait pas passé. Ce qui veut dire que sa légitimité n’est pas une légitimité absolue, quasi divine, que sa légitimité que je ne conteste pas est une légitimité advenue dans un jeu de rapport de force. Le fonctionnement démocratique c’est ce qui permet précisément d’habiller des rapports de force en puissance de légitimation, même quand il y a élections présidentielles celui qui est élu c’est celui qui a eu le plus de force pour provoquer l’adhésion à sa personne, quelques soient les moyens légaux qu’il ait pu employer. Pour le dire comme Pascal en politique la force est toujours première, la politique n’abolit jamais les rapports de force, elle les constitue en rapports symboliques de domination ; tout pouvoir est usurpée, on prend toujours le pouvoir, on ne vient jamais vous l’offrir sur un plateau. Justement parce que le pouvoir se prend et que sa légitimation n’est jamais absolue, il lui faut produire les effets de croyance qui lui permettent de durer et d’apparaitre comme légitime. Même sur la scène internationale, même quand un pouvoir est pris par un coup d’état, généralement la communauté internationale va s’émouvoir pendant quelques semaines, puis si ça tient, si les relations sociales et politiques sont stabilisées, on va se calmer, on laissera passer quelques mois et celui qui quelques mois plus tôt était regardé comme un odieux tyran qui vient de faire un coup d’état inacceptable, sera regardé comme le chef légitime de l’état dont il aura pris le pouvoir.
Pour que le pouvoir tienne il faut qu’il réussisse à produire des effets de croyance qui assurent sa légitimité. Il faut faire croire que la loi de la succession héréditaire, par exemple dans un système monarchique, est parfaitement légitime, ou faire croire que la loi de l’élection démocratique est plus légitime que la loi de la succession héréditaire, ou faire croire que les privilèges de la noblesse sont légitimes… et tant qu’on y croit ça marche. Et quand on n’y croit plus on est en août 89.
Il y a une autre manière, il y a une manière de faire que tous les politiques connaissent, pas que les politiques, les enseignants, les curés, les chefs d’entreprise… Pour que ça marche il faut frapper l’imagination, c’est-à-dire qu’il faut pouvoir mettre en scène, il faut théâtraliser son pouvoir. Le pouvoir du roi ne tiendrait pas longtemps sans le sceptre, la couronne, la cour, le trône, le palais princier… Le pouvoir démocratique ne nous impressionnerait pas beaucoup sans le balai des limousines dans la cour de l’Elysée, les protocoles. On pourrait imaginer que je vous parle du milieu d’entre vous, mais il y a quelque chose de théâtral ici, on m’a mis en hauteur et devant moi une longueur pas possible qui me sépare bien de vous, théâtralisation massive de ma présence qui vise à assurer un effet de pouvoir.
Dans le jeu du pouvoir c’est qu’il n’y a pas de pouvoir sans représentation du pouvoir, il n’y a de pouvoir que mis en signes, à travers des signes qui vont frapper l’imagination et qui supposent une mise en scène théâtrale de ces signes. Cette représentation du pouvoir à travers ses signes est toujours ce qui assure le pouvoir de la représentation. Nos représentations sont puissantes, au fond nous sommes gouvernés par nos propres représentations bien d’avantage que par ceux qui croient nous gouverner, la preuve est qu’ils ne peuvent nous gouverner que tant que la représentation que l’on se fait d’eux coïncide avec la représentation qu’ils espèrent qu’on a d’eux.
Le pouvoir s’il est fragile, il est fragile puisqu’il a besoin de signes, de croyances, d’être théâtralisé, d’être légitimé il est fragile d’une manière telle que ce qui le rend nécessaire Pascal, Bourdieu, Augustin sont d’accord là-dessus, aussi fragile, aussi trompeur qu’il soit le pouvoir est nécessaire pour mettre de l’ordre dans les relations sociales. Mais ce qui rend le pouvoir nécessaire c’est aussi, et c’est le drame du pouvoir, c’est ce qui le rend fragile, parce qu’en réalité on n’est pas si dupe que cela. Pascal a le souci de démystifier le jeu politique pour nous montrer comment ça marche, il est à mon avis bien plus précis que Machiavel, Pascal nous dit « ce que je vous dis là il ne faut pas le répéter », il est bon que le peuple ne le sache pas, là Pascal est un peu naïf, le peuple le sait toujours, on a parfois besoin de se le cacher un peu à nous-mêmes mais au fond on sait bien comment ça marche, on n’est pas si dupe que ça, il est arrivé à chacun de nous de douter de l’absolu légitimité d’un supérieur hiérarchique, d’un professeur, d’un homme politique.
Tout pouvoir vient buter sur la libido dominandi de ceux sur qui il s’exerce, le problème c’est que le pouvoir ne peut jamais tenir par sa propre force justement parce que face à lui il y a d’autres volontés de pouvoir. Moi j’ai le pouvoir de faire en sorte que mes élèves restent assis dans la classe sans bouger mais s’ils décidaient massivement de se lever, de plus m’écouter et de foutre le souk, c’est-à-dire d’affirmer leur propre libido dominandi contre la mienne, ce n’est pas certain du tout que je ferai le poids, il est même certain que je ne le ferai pas. Ca veut dire que tout pouvoir vient buter sur la libido dominandi de ceux sur qui il s’exerce, c’est-à-dire qu’il a toujours à conjurer le risque de la révolte, de la contestation, de la révolution, de la critique, c’est donc compliqué.
La légitimation n’est jamais totale on sait qu’aucun pouvoir n’est absolument pas légitime. Le pouvoir pour fonctionner vraiment a besoin d’autre chose et ce quelque chose dont il a besoin c’est l’autorité. L’autorité est toujours ce qui doit relayer le pouvoir pour que le pouvoir puisse continuer à s’exercer comme pouvoir. L’autorité est peut-être même parfois ce qui assure le pouvoir, du pouvoir, ce qui l’augmente et lui permet de tenir. Et la puissance de l’autorité est parfois plus grande que celle du pouvoir. Je cite Cicéron, à propos d’un sénateur : Ce qu’il ne pouvait pas réaliser par le pouvoir, il l’obtint par l’autorité, Cicéron reconnait déjà que la puissance de l’autorité est parfois plus grande que la puissance du pouvoir. Comment c’est possible qu’on puisse obtenir par l’auctoritas ce qu’on ne peut pas obtenir par le potestas ? Etymologiquement le mot autorité vient de verbe latin augere qui veut dire accroitre, augmenter, l’autorité c’est donc ce qui augmente le pouvoir de persuader, non pas à partir d’un pouvoir qu’il aurait reçu institutionnellement mais à partir de qualités qui sont celles de sa personne (exploits, compétences, vertus, succés…). Ce qui donne pouvoir est reçu d’ailleurs, ce qui donne autorité provient toujours de quelque chose qui est reconnu comme étant de la personne. L’autorité ne s’institue pas c’est une caractéristique personnelle, non transférable. On peut transférer un pouvoir, on peut donner pouvoir à quelqu’un, l’autorité est intransférable. Emile Benveniste, spécialiste de l’indo-européen, va chercher parfois l’étymologie bien plus loin que dans le latin, il voit dans le augere (moi je vais chercher dans le latin la racine du mot autorité, lui va chercher dans l’indo-européen la racine du mot augere) il lui semble que le verbe latin augere vient d’une racine indo-européenne aug qui désigne la force, mais pas n’importe quelle force, pas une force humaine, une force qui est d’abord celle des Dieux, une puissance particulière de faire être hors de soi quelque chose par sa puissance propre, aug c’est donc la puissance efficace quasi divine. On trouve au passage quelque chose de ce sens dans le mot auteur qui est la même racine qu’autorité, dans un sens métaphorique, quand on dit de quelqu’un « il est auteur de nos jours », l’auteur de mes jours c’est bien celui qui a pu produire hors de soi ce qu’il avait la puissance de produire hors de soi, l’efficace d’un faire être entièrement du à l’auteur de mes jours. Si on parle de l’auteur comme un écrivain c’est encore plus net, l’auteur est moins celui qui est autorisé que celui qui a le pouvoir de faire exister hors de lui quelque chose qui a ensuite sa force propre de produire certains effets.
Si nous comprenons l’autorité à partir de ce que nous révèle Ciceron ou Benveniste, ou simplement un examen de l’étymologie, je crois qu’on peut en tirer un certain nombre de caractères, je vais vous en proposer 7 :
- L’autorité exclue la coercition, elle ne fonctionne pas sur le mode de la contrainte. Celui qui parle avec autorité n’a pas besoin d’élever la voix. Celui qui agit avec autorité n’a pas besoin de forcer les évènements. Il suffit qu’il parle, il suffit qu’il oriente, il suffit qu’il dise ce qu’il faut faire et on fait comme il dit et on écoute sa parole.
- L’autorité repose sur la reconnaissance, il n’y a autorité réelle que d’autorité reconnue, à tel point que l’expression « autorité reconnue » peut être considérée comme un pléonasme. Si elle n’est autorité que si elle est reconnue c’est que son parcours est contraire à celui du pouvoir. Le pouvoir s’exerce de haut en bas mais puisque l’autorité n’est autorité qu’à être reconnue elle s’exerce de bas en haut puisque n’a autorité que celui a qui vous donnez autorité en reconnaissant précisément l’autorité qui est la sienne.
- L’autorité bien qu’elle fonctionne que sur la base d’une reconnaissance qui nécessairement me vient d’en bas, elle n’est pas pour autant égalitaire, elle exclue le débat, l’argumentation, la discussion. Si on est entre égaux on peut discuter, débattre, argumenter, faire valoir nos points de vue, mais quand quelqu’un parle avec autorité on reconnait la puissance et l’efficacité de sa parole. L’autorité ne se discute pas. Dans la mesure où l’autorité fonctionne hors débat, l’ordre autoritaire est toujours un ordre hiérarchique.
- Si l’autorité a quelque chose de personnel, contrairement au pouvoir, sa source semble toujours quelque chose qui transcende la personne autorisée. On reconnait à celui dont on reconnait l’autorité, des qualités particulières et en même temps on reconnait en sa présence, quelque chose qui le dépasse, quelque chose de plus grand que lui.
- Dans la sphère politique la source de l’autorité est toujours la loi. Quelque soit l’autorité dont on dispose on ne peut jamais conserver l’autorité contre la loi ou dans le jeu de la transgression de la loi. C’est ce qui distingue un régime autoritaire (il s’en tient au respect des lois, il reste ordonné à l’ordre de la loi) d’une tyrannie.
- Le mot et le concept d’autorité sont issus du droit romain. En droit romain on distingue bien l’auctoritas et le potestas. Le pouvoir c’est le monopole de la maison impériale, l’empereur et les proches de l’empereur qui ont le pouvoir. L’autorité c’est le privilège du sénat, c’est-à-dire des anciens. La politique romaine à l’époque impériale est structurée entre ces deux pôles.
- L’autorité est de nature spirituelle c’est-à-dire non coercitive. Hannah Arendt nous le dit. La chute de l’Empire romain 476, au Vème siècle l’église, institutionnellement, se retrouve dans une situation où elle peut faire valoir son expérience, sa compétence, son mode d’organisation, et elle entre dans une dimension politique. Pour exercer ce pouvoir l’église va adopter la distinction romaine entre le pouvoir et l’autorité, et elle revendique pour elle la vieille autorité du sénat et abandonne le pouvoir aux rois et aux empereurs du monde. Même ce jeu qui va traverser tout le moyen âge, non pas un jeu de séparation, mais l’articulation du pouvoir religieux et du pouvoir royal au moyen âge n’est pas un conflit de pouvoir parce qu’elle fonctionne bien déjà sur ce qui est une séparation des pouvoirs. Le pouvoir revendiqué par l’église médiévale c’est l’autorité, c’est le pouvoir spirituel non coercitif, et le pouvoir qu’elle abandonne qu’elle reconnait aux princes et aux rois de ce monde, c’est le pouvoir de la maison impériale. On comprend qu’il n’y ait pas vraiment de crise de l’autorité pendant plusieurs siècles.
Ce qui est intéressant ici c’est ce partage des rôles de la pensée. Ca nous aide à comprendre que toute société a besoin de ces deux pôles. Toute société a besoin d’un pôle de pouvoir institué et d’un pôle d’autorité. Le pôle d’autorité c’est ce pôle où se joue la capacité à mobiliser plutôt qu’à contraindre. Quand on doit contraindre ses subordonnés à faire leur travail, c’est déjà que ça va mal. Et le pouvoir qui est le notre est frappé d’insuffisance. Mais si on arrive à mobiliser une équipe, des énergies, c’est quelque soit le pouvoir que l’on a ou que l’on n’a pas, on joui d’une certaine autorité. Donc le pôle d’autorité c’est ce qui permet de mobiliser plutôt que de contraindre, autrement dit de faire qu’on y croit sans pour autant nous faire croire. Je crois que l’autorité véritable c’est ce qui peut se passer des effets de théâtralisation dont je faisais tout à l’heure le jeu du pouvoir parce que le pouvoir n’est jamais de lui-même assez sur de sa légitimation il faut qu’il se mette en scène, il faut la bonne cravate et le beau costume. L’autorité peut nous dispenser des effets de pouvoir et en particulier des effets de théâtralisation. Ce qui me frappe chez les gens dont je reconnais l’autorité c’est qu’ils n’ont pas besoin d’en rajouter, ils n’ont pas besoin de sur-jouer. Ca me rappelle la confidence d’un ami qui me parlait d’un ancien doyen de l’inspection générale, il me parlait de lui avec beaucoup de bonté, de gentillesse, d’affection… puis il a eu une formule étonnante, il me dit « ce qui a de bien avec lui c’est qu’il ne joue pas au doyen ». Au fond c’est ça l’autorité c’est ce qui nous dispense d’avoir à jouer, quand vous n’êtes pas sur vraiment d’être à la place qui devrait être la votre vous devez en rajouter pour convaincre les autres que c’est bien vous le chef et que votre pouvoir est légitime. Mais quand vous êtes à l’aise dans vos propres compétences, avec votre pouvoir, avec votre fonction vous n’avez pas besoin de sur-jouer. Il se pourrait bien que l’autorité ce soit ça.
Je voudrais terminer sur les conditions de l’autorité.
- Elle s’ignore elle-même comme autorité. L’autorité que je revendique, l’autorité que je pose comme étant la mienne c’est toujours celle que je risque de sur-jouer et en la sur-jouant, celle que je risque de perdre. On n’a jamais autant d’autorité que quand on ne se pose pas la question de son autorité, quand on ignore notre autorité et quand on est dispensé par là-même d’avoir une posture affectée qui tomberait immédiatement dans l’imposture. L’autorité qui se prend au sérieux, l’autorité qui ne s’ignore pas elle-même, l’autorité trop sure d’elle c’est ce qui risque toujours de nous faire sombrer dans l’autoritarisme ou dans le ridicule, au choix et je ne sais ce qui est le pire.
- L’autorité a à voir avec une certaine sagesse reconnue, cette sagesse peut être aussi bien une sagesse pratique, qu’une sagesse théorique. Elle peut être une sagesse pratique parce qu’elle peut être de l’ordre de la compétence, du savoir-faire, de la prudence, de l’expérience et quand on a acquis une certaine compétence qui nous donne une certaine efficacité, quand notre savoir-faire est relativement indiscuté, quand nous sommes suffisamment prudent pour prendre le temps de mesurer une situation, quand nous avons l’expérience qui nous permet peut-être de ne pas faire les mêmes erreurs, d’autres éventuellement mais pas les mêmes, à partir de là nous pouvons apparaitre comme ayant une certaine autorité. Même chose pour la sagesse théorique, celle qui se caractérise par un certain recul, une certaine distance critique, une certaine hauteur de vue et celui qui a cette hauteur de vue, cette distance critique, c’est celui dont on sera enclin à reconnaitre l’autorité.
Ce que je suis entrain de vous dire là c’est que l’autorité n’est pas un espèce de don naturel, on ne nait pas avec l’autorité chevillée à l’âme, l’autorité c’est ce qui nous advient avec l’expérience, avec le recul, avec la compétence, avec le savoir-faire, avec la prudence, avec tout ce qu’il a fallu construire, avec tout ce qu’il a fallu acquérir. La mauvaise nouvelle c’est que ce n’est pas un don magique et la bonne nouvelle c’est que mine de rien ça peut se travailler. D’une manière paradoxale parce qu’à vouloir acquérir de l’autorité je risque de perdre le peu d’autorité qui me restait. Mais ça veut dire que si j’oublie l’autorité et que je pense vraiment à devenir plus compétent, plus efficace, plus prudent, à tirer parti de mon expérience, l’autorité viendra comme de surcroit.
Je vois certains d’entre vous qui disent « oui mais y’a quand même l’autorité charismatique ! », celle là se joue à un niveau qui ne se travaille pas. Charis en grec c’est la grâce, le don, et l’autorité charismatique ça serait une sorte de don quasi surnaturel et miraculeux que l’on reconnaitrait chez certains. On voit parfois dans l’autorité la marque d’un charisme, il est d’ailleurs étonnant qu’on soit dans le vocabulaire don divin quasi théologique et mystique, je suis assez perplexe, j’y crois pas trop. Je vous raconte une anecdote par laquelle on a essayé de me convaincre que certains avaient une autorité charismatique en me présentant une petite dame extraordinaire et dont on disait qu’elle avait un charisme, c’était la présidente d’ATD quart monde il y a quelques années, une petite bonne femme pleine d’énergie, déjà assez âgée, elle allait régulièrement frapper à la porte des ministères et on la faisait pas attendre ¼ d’heure, elle avait ses entrées, on l’accueillait, on l’écoutait, elle engueulait les ministres et les ministres se laissaient engueuler par elle. « Donc là on est vraiment dans l’autorité charismatique ! » cette personne s’appelait Geneviève Anthoniosz qui avait bien pris soin de ne pas enlever son nom de jeune fille qui était De Gaulle alors oui quand on s’appelle Geneviève Anthonioz De Gaule ça produit des effets de croyance et de sidération qui n’auraient pas été produits si elle s’était appelée Arlette Dupont. L’autorité charismatique à discuter.
- L’autorité implique le respect, il n’y a pas d’autorité sans respect et le respect en deux sens : « tenir quelqu’un en respect » c’est le tenir à bonne distance, je crois que c’est ça le respect, la vertu de la bonne distance ni trop près, ni trop loin. Trop loin c’est de l’indifférence, trop près c’est de la confusion. Respecter ses élèves, respecter ses enfants c’est n’être pas trop près, ni trop loin d’eux, trouver la juste distance qui permet à chacun d’être à sa place.
Puis respect dans un sens plus technique, c’est la reconnaissance de l’inaliénable dignité de ceux à qui on s’adresse, je ne peux pas être reconnu comme ayant autorité par quelqu’un que je mépriserais, par quelqu’un dont je bafouerais la dignité. Les conditions d’exercice de l’autorité c’est toujours le respect scrupuleux de celui à qui on s’adresse, avec qui on agit.
- L’autorité implique la mise entre parenthèses des hiérarchies instituées c’est-à-dire que l’autorité permet de les court-circuiter provisoirement. C’est ce que Pascal dans un texte extraordinaire qui s’appelle « trois discours sur la condition des grands » appelait les grandeurs d’établissement c’est-à-dire des grandeurs qui sont socialement établies mais qui ne doivent rien aux vertus, aux qualités particulières de ceux à qui on reconnait ces grandeurs, pascal disait par exemple qu’être Duc c’est une grandeur d’établissement.
Elle ouvre une brèche dans le jeu des hiérarchies formelles. Celui qui a autorité n’est pas celui qui conteste le pouvoir, il ne conteste pas la légitimité de son chef, mais c’est celui qui, parce qu’il a autorité bouscule un peu les hiérarchies et qui peut être éventuellement entendu bien au-delà de sa fonction formelle. Il y a dans certaines entreprises, dans certaines écoles, dans certains clubs… des individus qui n’ont pas de fonction officielle élevée et qu’on écoute pourtant quand ils parlent, auxquels on est attentif sans que l’attention qu’on a pour eux soit à la mesure du pouvoir officiel qui est le leur. Ca c’est indispensable dans une société, ça veut dire que ça donne du jeu aux hiérarchies instituées, ça permet de ne pas les scléroser, de ne pas les rigidifier, ça fait circuler du sens, de l’énergie, qui rend possible une relativisation des rapports de domination et justement de ces jeux entre supérieur et inférieur.
Si on appliquait ça au monde de l’entreprise, quand je dis monde de l’entreprise c’est aussi le monde de l’éducation nationale, plus je fréquente les deux plus je me rends compte qu’ils fonctionnent selon les mêmes schémas. Le monde de l’entreprise est souvent celui des hiérarchies un peu formelles, ces hiérarchies sont nécessaires et en même temps on sait qu’elles sont insuffisantes. Formaliser autant que vous voulez une hiérarchie ça ne suffira jamais à assurer son bon fonctionnement. Il ne suffit pas d’avoir du pouvoir pour parler et agir avec autorité et en même temps si le monde de l’entreprise est toujours le monde des hiérarchies formelles, il n’est pas condamné à être le lieu des hiérarchies oppressives. Une hiérarchie n’est pas oppressive quand l’autorité lui donne du jeu, cette autorité ça peut être l’autorité d’un chef… quand on a à la fois le pouvoir et l’autorité on est pour une entreprise, quelqu’un de précieux. Mais cette autorité peut être celle d’un employé expérimenté sans pouvoir effectif, d’un cadre qu’on qualifiera de charismatique, ou d’un personnage simplement attentif aux autres, à leurs soucis, et qui pour autant ne se dispense pas de faire son travail et que l’on écoute parce qu’il est capable de se déprendre un peu de lui-même et qu’il peut parler avec un peu d’autorité parce qu’on sait que quand il parle ce n’est pas pour lui, ni à partir de lui.
L’autorité a bien de visages possibles qu’il est important de savoir reconnaitre. Mais elle exige trois choses indispensables :
- Le refus des postures. Dès qu’on commence à jouer au chef on a déjà perdu toute autorité
- Le respect de chacun. Et le respect de chacun nous oblige à considérer qu’il ne faut confondre un subordonné et un inférieur. Un subordonné ne m’est en rien inférieur, c’est seulement sur un plan fonctionnel qu’il est sous mes ordres, ce que veut dire exactement subordonné. Mais sa subordination fonctionnelle n’a rien d’une infériorité.
- Pour que ce jeu de l’autorité puisse fonctionner, il faut une troisième chose liée aux deux premières : la capacité à distinguer fortement rapports de domination et rapports de subordination. C’est là mon désaccord avec Bourdieu, Pascal malgré l’admiration que j’ai pour eux je refuse de croire que les rapports sociaux soient essentiellement des rapports de domination plus ou moins bien camouflés. En vertu même du jeu de l’autorité les rapports sociaux peuvent être des rapports de subordination bien sur, et de véritables rapports sociaux. Mais pour qu’ils puissent l’être il faut ce jeu de l’autorité sans lequel aucun pouvoir n’est effectif
Question : Vous confluez en parlant des trois aspects : refus des postures, respect de chacun et capacité à distinguer rapports de domination et rapports de subordination, vous n’évoquez pas le fait d’accepter de laisser sa place à sa propre autorité. Il me semble que parfois on ne s’autorise pas sa propre autorité, on y renonce.
Yann Martin : C’est vrai que le verbe s’autoriser a quelque chose d’un peu sidérant, il est compliqué à comprendre. Le problème c’est que je ne suis pas sur que ce soit d’autorité qu’il s’agisse quand on ne s’autorise pas quelque chose. Il se peut que parce que je suis un peu complexé où parce que je pense que le moment n’est pas venu, que je ne m’autorise pas à dire ou à faire ce que je devrais dire ou faire, mais soit c’est de l’ordre de l’autorité et dans ce cas là en ne m’autorisant pas à rabrouer quelqu’un sous le motif par exemple que ça serait inefficace, qu’il a trop de problèmes, que ça va le détruire et que ça l’aidera pas, mais en laissant de côté, en ne m’autorisant pas à lui dire ses quatre vérités, je manifeste par là mon autorité, je manifeste que je ne suis pas soumis au pouvoir, ce pouvoir que j’ai et ce droit que j’aurai de le remettre à sa place j’y renonce en vertu de l’autorité qui est la mienne. Il se peut que ce renoncement soit faiblesse mais dans ce cas là mon autorité est déjà diminuée. Dans cette capacité à renoncer à cette autorité je vois soit une simple faiblesse, soit au contraire un acte paradoxal d’autorité.
Lien vers le document au format DOC :
https://old.chouard.org/Europe/Yann–Martin–LAUTORITE.doc
Merci Anne ! 🙂 ]
Proposition 69 mars pour l’AG #NUITDEBOUT : engager une réflexion sur la priorité d’un processus constituant populaire
Opportunité de focalisation de #NuitDebout sur l’essentiel :
nous concentrer et nous unir sur la cause première de notre impuissance politique,
(plutôt que nous disperser et nous diviser sur les conséquences de notre impuissance politique).
On va voir ce qu’en dira l’assemblée locale du moment.
[email protected]
L’AG NUITDEBOUT de PARIS décide d’engager un premier cycle de réflexions et de propositions pour enclencher — à terme — un processus constituant aboutissant à l’écriture d’une nouvelle Constitution citoyenne et démocratique.
Motivation de la proposition : initiative fédératrice (de long terme) en phase avec l’idée de convergence des luttes.
1. L’AG NUITDEBOUT de PARIS encourage et demande à la Commission « Constitution » de présenter à court terme un calendrier de travail, afin de présenter ultérieurement en AG les conclusions de ce premier cycle de réflexions, débat et de proposition concernant ce processus constituant en coordination avec les autres NUITDEBOUT de toute la France.
2. L’AG NUITDEBOUT de PARIS
– constate que pour fédérer le peuple et non rester dans l’entre soi, il est important de ne pas nous focaliser sur nos combats sectoriels potentiellement clivants et qui sont tous en butte à notre impuissance politique telle qu’instituée par la Constitution
– décide de s’orienter autour de la revendication unificatrice d’un processus constituant d’origine citoyenne.
3. L’AG NUITDEBOUT de PARIS décide d’engager les débats pour que les participants à NUITDEBOUT génèrent leur propre règlement incluant la rotation et le contrôle des organisateurs par l’AG.
Ces propositions ont été lues à l’AG ce dimanche 8 mai (#69mars) qui a décidé à une écrasante majorité (jaune) de les inclure dans les débats de cette semaine.

Source : Wikicrate sur Facebook
_____
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10154178431602317
Rendez-vous ce soir (vendredi 6 mai, 21 h), sur Mumble
Rendez-vous ce soir (21 h), sur Mumble :
https://lemumble.com/event/reservez-votre-soiree‑9/
[EDIT 9 mai : Le podcast du Mumble est là : https://lemumble.com/conferences/conference–etienne–chouard–la–cause–des–causes–6–mai–2016/
httpv://youtu.be/LzVuqtiabAc]
C’est comme une émission de radio, il n’y aura pas d’image (c’est très bien, ça aide à se concentrer sur ce qui est dit ; je préfère la radio à la télévision).
Je préférerais une séance questions/réponses (mutuelles) qu’une conférence, parce que j’ai vraiment l’impression de radoter 🙂
J’ai quelques livres importants à vous signaler, quelques pistes de réflexion sur #NuitDebout ainsi que sur les divers mouvements qui appellent à un rassemblement de mouvements, mais ce serait bien que ce moment soit plus un échange qu’une conférence, s’il vous plaît.
À tout à l’heure 🙂
Étienne.
________
Pour bosser un peu à l’avance le sujet (de notre nécessaire recherche de « la cause des causes » © Hippocrate), voyez cette page :
La cause des causes : le renoncement du peuple à écrire la constitution

http://wiki.gentilsvirus.org/index.php/La_cause_des_causes_:_le_renoncement_du_peuple_%C3%A0_%C3%A9crire_la_constitution
_______
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10154171812272317
L’ÉTAT RETORS et la prétendue théorie du complot : introduction remarquable au « Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu »
[billet blog janv. 2009]
« Chers amis,
Il y a environ deux ans [en 2007], je vous avais signalé [sur ce blog] un texte extraordinaire, littéralement passionnant à plusieurs titres, publié en 1864 et qui s’intitulait « Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu ». On le trouvait sur WikiSource et j’en avais fait une compilation en un seul fichier pdf pour une impression commode et soignée.
En 2006, un petit éditeur que j’aime bien (parce qu’il fait de très beaux livres, avec des textes souvent formidables), Allia, à réédité ce redoutable mode d’emploi de l’apprenti totalitaire.
Je vous recommande ce livre : c’est un de mes meilleurs livres, parmi les centaines que j’ai découverts et articulés depuis quatre ans [2005–2009]. C’est un objet précieux qui aide à progresser vite. Bien avant que George Orwell, inspiré par la société soviétique, ne décrive dans « 1984 » les ressorts effrayants d’un monde totalitaire, Maurice Joly en avait déjà dénoncé les plus intelligents mécanismes dans ce pamphlet, dirigé contre Napoléon III mais spectaculairement utile pour comprendre notre monde « moderne ».
En plus, ce livre est vraiment beau : le papier est superbe, le format est élégant, l’impression est légère et précise, un beau livre. Et pas cher : 15 €.
Je remercie les éditions Allia de m’avoir permis de découvrir Michel Bounan, qui signe une introduction vraiment très intéressante au texte de Maurice Joly ; c’est elle que je vous invite à lire ici. Je trouve que Michel Bounan s’en prend correctement aux abus de pouvoir et, comme par hasard, ça me plaît :o)
L’argument bidon de la prétendue « théorie du complot » (invoqué par tous les faux naïfs qui travaillent au service des privilégiés) prend un coup dans le nez. J’ai commandé quelques uns de ses livres pour mieux le connaître ; je vous en reparlerai.
Je n’en dis pas plus et je lui laisse la parole.
Étienne.
[C’est moi qui souligne. ÉC]
L’ÉTAT RETORS
« Je vous avertis… de vous tenir toujours en défense ; tremblez même dans la victoire ;
c’est alors qu’il fait ses plus grands efforts, et qu’il remue ses machines les plus redoutables. »
BOSSUET
« Dans la voie du bouleversement les meilleurs éléments sont toujours dépassés par les plus mauvais…
Derrière le révolutionnaire honnête apparaissent bientôt ces existences troubles. »
MARÉCHAL DE MOLTKE
« La révolution industrielle a connu en France sa plus rapide expansion au cours du Second Empire en même temps qu’étaient posées les bases d’un véritable État moderne.
Autoritairement établi par un coup d’État, maintenu par une police omniprésente et efficace, le nouvel instrument de gouvernement était indispensable à l’ambitieux projet de ses promoteurs. Deux cent cinquante mille fonctionnaires sont liés par serment au chef de l’État et étroitement surveillés par les préfets ; les magistrats, assimilés aux fonctionnaires, sont nommés et révoqués par décret ; la presse est soumise à de multiples contraintes financières et menaces judiciaires ; les opposants au régime sont purement et simplement déportés en Algérie. Ce sont ces moyens et le « pacte de sang » avec l’armée qui ont permis la militarisation du travail productif et l’extraordinaire essor industriel.
Les banquiers, les hommes d’affaires et les industriels qui soutenaient ce régime se considéraient, en général, comme des philanthropes ; beaucoup étaient sincèrement convaincus par les doctrines socialistes de Saint-Simon, et l’actuelle dictature ne devait être qu’une étape intermédiaire vers cette ère nouvelle et bienheureuse qu’un autre saint-simonien appellera plus tard « la grande relève de l’homme par la machine ». [Ce livre est d’ailleurs, lui aussi, remarquable : il est de Jacques Duboin. ÉC]
Dès 1860, la poigne de fer se relâche en effet sans qu’apparemment aucune force réelle d’opposition ne l’y contraigne. (Les historiens expliquent ce mystère par « la sympathie » que Napoléon III avait toujours marquée à l’égard des classes dites « laborieuses ».) Des pouvoirs sont donc rendus aux élus et l’État facilite lui-même la création d’un grand parti uni d’opposition. Simultanément des contacts sont pris avec des délégués ouvriers, on les encourage à rencontrer leurs camarades trade-unionistes anglais, on crée des chambres syndicales, le droit de grève est enfin reconnu.
L’Empire a terminé sa tâche, la démocratie moderne peut fonctionner. Il y aura encore le soubresaut de la Commune, et puis plus rien pendant un siècle, même entre les deux guerres mondiales, au cours des sursauts plus tardifs de l’Allemagne, de l’Italie, puis de l’Espagne. En définitive, on peut dire que le Second Empire français a accompli seul en quelques années l’œuvre des dictatures européennes et celle de leurs libérateurs, c’est-à-dire la grande relève de l’homme d’État par ce que Nietzsche appelait « le plus froid des monstres froids ».
En 1864, l’année même où fut fondée à Londres l’Association internationale des travailleurs, Maurice Joly écrit et publie son Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu. Ancien enfant rebelle, familier du barreau et futur exilé, il observe avec une effrayante lucidité la mise en place des nouveaux mécanismes du pouvoir. Machiavel est ici le porte-parole du despotisme moderne. Il expose cyniquement ses buts, ses procédés et leur développement historique. Initialement la force brutale, le coup d’État militaire, le renforcement de la police et de l’armée, la prééminence des hauts fonctionnaires sur les élus, la mise au pas des magistrats, de l’université, de la presse.
Mais la force, ostensiblement déployée, suscite toujours des forces contraires. Elle n’est utilisée que pour modifier en quelques années les institutions, la Constitution, et pour créer des formes légales au nouveau despotisme. Ainsi l’emprisonnement des journalistes doit être relayé rapidement par des dispositions économiques sur la presse et par la création de journaux dévoués au gouvernement. Une telle tribune associée à d’astucieux découpages électoraux permet de maintenir une tyrannie élue au suffrage universel.
Pour en finir avec toutes ces vieilles formes d’opposition, partis, coteries, cabales, complots, qui gênaient tant les anciens despotes, l’État moderne doit créer lui-même son opposition, l’enfermer dans des formes convenables et y attirer les mécontents. Il doit en outre infiltrer tous les rassemblements, en prendre la direction et les dévoyer. Il doit même manipuler policièrement tous les complots clandestins, les surprendre, les égarer, les déconsidérer. Voilà le principal ressort du pouvoir moderne : parler « tous les langages » du pays afin d’en détourner le fleuve.
Un dernier mécanisme régulateur garantit enfin la perpétuation du nouveau régime : une telle société développe vite chez ses membres un ensemble de qualités qui travaillent pour elle : la lâcheté, la domesticité et le goût de la délation sont à la fois les fruits et les racines de cette organisation sociale. La boucle est bouclée.
La force brutale utilisée par les anciennes tyrannies n’a donc plus de raisons d’être, sauf en de rares circonstances. Au temps du machinisme on peut faire travailler les forces hostiles au moyen de dispositifs convenables. On peut même utiliser leur énergie domestique à réduire celles qui viendraient à surgir. Cette autorégulation est la base de toutes les sociétés vraiment modernes.
En face de ce nouveau pouvoir personnifié par Machiavel, que représente Montesquieu ? Il énonce les anciens principes politiques, moraux et idéologiques de ceux qui, un siècle auparavant, se préparaient à prendre la direction de la nouvelle société. Le génie de Machiavel consiste à citer volontiers. Montesquieu : l’actuel despotisme n’est nullement contradictoire avec ces fondements et cette idéologie.
Notre XXe siècle a richement illustré les principes énoncés par Maurice Joly. Mais on aurait tort d’évoquer ici les multiples dictatures totalitaires où l’armée et la police s’affichent partout, où les tyrans ne dissimulent pas encore leur pouvoir. Le modèle décrit par Maurice Joly est précisément au-delà de cette étape historique : c’est celui du chef de l’État élu au suffrage » universel, celui des hauts fonctionnaires inamovibles, celui des consultations électorales qui masquent la véritable cooptation du personnel politique.
Ce mode de gouvernement n’est pas celui du parti unique, mais celui des pseudo-affrontements entre des partis politiques parlant « tous les langages » du pays, celui des faux complots organisés par l’État lui-même, celui enfin où l’appareil éducatif et médiatique, aux mains du même pouvoir, entretient un tel abaissement des esprits et des mœurs qu’il n’y a plus aucune résistance possible.
Le système de gouvernement décrit par Maurice Joly est celui du complot permanent occulte de l’État moderne pour maintenir indéfiniment la servitude, en supprimant, pour la première fois dans l’histoire, la conscience de cette malheureuse condition. »
[···]
Valeureux lanceur d’alerte, Denis Robert, toujours sur le pont, ici pour défendre Antoine Deltour à son procès inique au Luxembourg, navire amiral de la fraude fiscale unioneuropéenne
Merci Denis Robert, merci beaucoup.
Il faudrait qu’on soit des millions sur le pont avec vous, avec les lanceurs d’alerte.
Faites passer, faut se réveiller, ça suffit l’escroquerie capitaliste !
Denis Robert :
« Bilan de la journée… Me suis levé à six heures, ai commencé par RTL, ai enchaîné sur la RTBF, puis Canal, grand et petit journal, Radio bleue, I télé, BFM, Arte, TF1, Mirabelle, des luxembourgeois, des allemands, FR3, des alters, Basta mag, LCP, etc pour arriver au dernier, le stagiaire sympathique de Public Sénat qui oublie de mettre un disque dans son magnéto et qui veut qu’on recommence. Niet. Jet de l’éponge. Une vingtaine d’interviews où j’ai essayé de varier les formules. Au final, ce constat ancrée qu’on est ‑avec ce procès Luxleaks- dans un délire total. Ce sont les voleurs ‑et donc la société d’audit PWC- qui sont du (bon) côté de la justice et les justes qui sont sur le banc des accusés. Au centre de ce jeu de dupes, des magistrats qui ressemblent à des personnages de Daumier et de Kafka, engoncés dans leur orgueil, utilisant un vocabulaire qui se veut judiciaire et éclairé, mais qui n’est qu’un jargon visant à accabler celui qui dit la vérité. On a passé la matinée à écouter religieusement la représentante de la société d’audit qui a organisé la fraude fiscale nous expliquer comment Antoine Deltour avait fait pour s’emparer du « data ». Tu parles… Peut être suis je le fou de l’histoire ? Peut être suis je le seul à ressentir cela mais j’ai vraiment eu le sentiment d’être dans un hôpital psychiatrique grandeur nature. Les fous étaient ceux qui nous faisaient la leçon. »
httpv://youtu.be/eck65V9ve24
Rappel du soutien nécessaire à Antoine Delcour :
[Urgent] Nous devons aider Antoine Deltour, lanceur d’alerte, persécuté par les politiciens
_______
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10154151905442317?pnref=story
Une nouvelle « Semaine de la Démocratie » commence demain à Montpellier
L’an dernier, quelques jeunes gens bien décidés ont organisé une sorte de fête de la démocratie à Montpellier, et ils ont réussi à faire intervenir des chercheurs passionnants, comme Francis Dupuis-Déri.
Ils recommencent cette année ; ça commence demain, lundi 25 avril 2016 ; et ils ont besoin d’un peu d’aide pour financer l’événement.
• Voici donc leur site :
http://www.semainedelademocratie.fr/,
• le programme :

http://www.semainedelademocratie.fr/programme/
• Une petite vidéo de présentation :
httpv://youtu.be/diwfpjinRw0
• Le lien pour leur donner quelques sous :
http://fr.ulule.com/semaine–democratie/
Il nous reste 4 heures pour les aider !… un défi 🙂
• Et quelques vidéos de l’an passé, vraiment très intéressantes (elles viennent d’être publiées, ça va vous plaire, c’est sûr) :
http://www.semainedelademocratie.fr/2016/04/22/ledition–2015–en–videos/
Bon courage à tous les virus, dans leur travail quotidien de contamination démocratique 🙂
Étienne.
Semaine de la Démocratie 2015 – jour 1 :
« Démocratie, histoire d’un malentendu »
httpv://youtu.be/Qiv1CB7c-r0
Semaine de la Démocratie 2015 – jour 2 :
« Sommes-nous en Démocratie ? »
httpv://youtu.be/y_jKb3uFZfU
______
Lien Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10154147737932317?pnref=story
[De vrais représentants nous sortiraient de l’UE, au lieu de nous y enfermer] Miracle à l’islandaise : à Reykjavik, le taux de chômage est tombé à 1,9%
NOUS N’AVONS NI CONSTITUTION NI REPRÉSENTANTS
PARCE QUE NOUS N’AVONS PAS (ENCORE) APPRIS
À ÊTRE NOUS-MÊMES CONSTITUANTS.
IL EST PLUS QUE TEMPS.
______
Miracle à l’islandaise : à Reykjavik, le taux de chômage est tombé à 1,9%
Par Pierre Magnan@GeopolisFTV | Publié le 09/02/2016 à 09H45
Piscine chauffée par géothermie en Islande, île fortement volcanique.
L’information n’a pas fait la Une : « L’Islande a retrouvé son niveau de chômage d’avant la crise. » Un résultat impressionnant pour la petite île indépendante qui a connu l’une des pires crises économiques d’Europe. Depuis sa faillite retentissante en 2008, l’Islande et ses quelque 320.000 habitants ont réussi un retournement économique impressionnant. Avec quelles recettes ?
Le chômage en Islande est désormais de 1,9%, selon les chiffres officiels, le taux le plus bas depuis 2007. En 2007, le taux de chômage était de 1,3%… Au plus fort de la crise, survenue en 2008, le chômage avait dépassé les 10% (avec des pointes à 12%).
Pourtant, la crise islandaise a été un vrai tsunami pour cette île. « Peu de pays, voire aucun, avaient vécu une débâcle économique aussi catastrophique », notait le FMI à son propos.
Ce petit miracle à l’islandaise s’explique. Selon le Premier ministre, « nous n’aurions pu sortir de la crise si nous avions été membre de l’Union européenne », avait-il dit en novembre 2015. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson avait même été plus loin en affirmant que ne pas être membre de la zone euro avait été une chance pour l’Islande : « Si toutes ces dettes avaient été en euros, et si nous avions été obligés de faire la même chose que l’Irlande ou la Grèce et de prendre la responsabilité des dettes des banques en faillite, cela aurait été catastrophique pour nous sur le plan économique.»

Comparaison chômage Islande-Irlande entre 2005 et 2014 (source Alterécoplus) © alterecoplus
Pourtant l’Islande revient de loin. Le pays a connu une crise beaucoup plus violente que les autres pays européens du fait de la démesure de son système financier lors de l’éclatement de la crise des subprimes. Mais face à une telle situation, l’Islande a pris des mesures très différentes des autres pays européens, quitte à provoquer de vives tensions avec certains d’entre eux (leurs avoirs n’ayant pas été remboursés à la suite d’un référendum en Islande). « A la différence des autres pays heurtés par la crise, l’Islande a laissé ses banques faire faillite, ne préservant que les comptes des ménages résidents. Les étrangers qui avaient placé leur argent dans les banques du pays ont tout perdu lorsque ces banques ont fait faillite. Ailleurs, dans le reste de l’Europe, de nombreuses banques ont été nationalisées car il n’était pas concevable qu’elles puissent faire faillite », rappelait l’Express en 2015.
Le pays a mené une politique mêlant contrôle des capitaux (une idée mal vue en Europe), austérité budgétaire mais aussi hausse des impôts et surtout dévaluation importante de sa monnaie (60%) qui a entraîné une importante inflation, aujourd’hui maîtrisée… et une reprise de la croissance. Résultat, Reykjavik n’a pas sacrifié sa politique sociale et le FMI a été totalement remboursé de ses avances financières. Cette politique a fonctionné, moins d’entreprises ont fait faillite et il n’y a pas eu d’exode des jeunes comme au Portugal, Espagne ou Irlande.
De nombreux économistes font le parallèle avec le cas grec qui est toujours noyé dans sa dette et l’empilement des plans d’austérité. Mais les deux pays sont loin d’être semblables. La Grèce est enfermée dans les règles de la zone euro alors que l’Islande est libre de ses règles et de sa monnaie. Et a même décidé de ne plus demander son adhésion à l’Europe.
De plus, l’Islande a profité des capitaux qu’elle détenait du fait de l’énormité de son système bancaire, bloqués par le contrôle des changes. En conclusion de son rapport sur l’Islande, le FMI le reconnaît le côté peu orthodoxe de la reprise islandaise : « Cet ensemble éclectique de mesures a été efficace dans le cas de l’Islande, mais il n’est pas du tout certain que les enseignements à en tirer soient transposables ailleurs, y compris dans la zone euro en crise. »
En tout cas, l’Islande est devenue un exemple pour ceux qui critiquent l’intégration autour de l’euro. Avec raison ?
______
De vrais représentants nous sortiraient de l’UE, au lieu de nous y enfermer.
______
Lien Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10154146757002317
La tolérance n’est pas une concession que je fais à l’autre, elle est la reconnaissance du principe qu’une partie de la vérité m’échappe (Paul Ricoeur)
La tolérance n’est pas une concession que je fais à l’autre, elle est la reconnaissance du principe qu’une partie de la vérité m’échappe.
Paul Ricoeur.
À propos de #NuitDebout (vidéo) : un processus constituant digne de ce nom ne devrait être confisqué par aucun groupe (même bien intentionné), il devrait être populaire, vraiment populaire
À l’occasion de mon voyage récent à Nantes, j’ai rencontré un jeune homme qui s’est proposé d’enregistrer rapidement (30 min) ce que m’inspire le mouvement #NuitDebout ; je lui ai dit en substance : « de l’espoir et quelques craintes » :
Nuit Debout 1⁄7 – Que penses-tu du mouvement Nuit Debout ? (8 min) :
httpv://youtu.be/SF7yX4KNXJ4
Nuit Debout 2⁄7 – Les faiblesses de ND (4 min 30) :
httpv://youtu.be/mdhrv9mwxDw
Nuit Debout 3⁄7 Toucher les classes populaires (2 min) :
httpv://youtu.be/22u7yopDnn4
Nuit Debout 4⁄7 – Les assemblées citoyennes à ND (6 min 30) :
httpv://youtu.be/Cuhs53ibNBU
Nuit Debout 5⁄7 – Une « mini-constitution » pour ND ? (4 min 30) :
httpv://youtu.be/tfmipjoVJNU
Nuit Debout 6⁄7 – Viendra, viendra pas ? (6 min 40) :
httpv://youtu.be/WfJpwt3TAy4
Nuit Debout 7/7 – Bonus – L’idée du processus constituant (3 min 30) :
httpv://youtu.be/221iWuwMMZg
J’ai vu passer des articles sur cet entretien dont le titre était « ÉC accuse … » : c’est manipulatoire, car je n’accuse personne parmi les organisateurs, évidemment : je déplore les exclusions arbitraires et les préjugés sur un éventuel processus constituant ; c’est bien différent d’accuser, car je trouve ce mouvement intéressant et utile, à bien des points de vue.
Méfiez-vous, donc, des titres insidieusement venimeux qui nous jettent les uns contre les autres.
Je remercie tous ceux qui me défendent, et je vous demande avec insistance de rester gentils en toute occasion, sans céder aux provocations : je ne suis pas une victime de ce mouvement 🙂 On trouve des exagérations de toutes parts, ces temps-ci. Ne nous laissons pas hystériser par les semeurs de zizanie professionnels.
Et bon courage à tous les citoyens constituants, des places NuitDebout et d’ailleurs 🙂
Étienne.

Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10154136090507317?pnref=story
Frédéric Lordon : « Que la mobilisation ‘Nuit Debout’ doive aspirer à devenir Constituante », « c’est ce que je crois fondamentalement »
« Que la mobilisation ‘Nuit Debout’ doive aspirer à devenir Constituante », « c’est ce que je crois fondamentalement »
Wouaou… Qui parle ?
Frédéric Lordon ! 🙂
Yeesssss 🙂
Tout vient à point pour qui sait attendre 🙂
Encore un petit passage, allez (je bois du lait 🙂 ) :
« Comment sortir de l’antinomie entre l’improductivité et le retour à l’écurie parlementaire ? La seule réponse à mes yeux est : en se structurant non pour retourner dans les institutions mais pour refaire les institutions. Refaire les institutions, ça veut dire réécrire une Constitution.
Et voici alors la deuxième raison pour laquelle la sortie par la Constitution a du sens : le combat contre le capital. Pour en finir avec le salariat comme rapport de chantage, il faut en finir avec la propriété lucrative des moyens de production, or cette propriété est sanctuarisée dans les textes constitutionnels. Pour en finir avec l’empire du capital, qui est un empire constitutionnalisé, il faut refaire une Constitution. Une Constitution qui abolisse la propriété privée des moyens de production et institue la propriété d’usage : les moyens de production appartiennent à ceux qui s’en servent et qui s’en serviront pour autre chose que la valorisation d’un capital. »
Signé : Frédéric Lordon.
Elle est pas belle, la vie ? 🙂
Je note aussi :
« Toute notre entreprise vise à changer la logique des luttes. Évidemment, il faut continuer de revendiquer partout où il y a lieu de le faire ! Mais il faut avoir conscience que revendiquer est une posture défensive, qui accepte implicitement les présupposés du cadre dans lequel on l’enferme, sans possibilité de mettre en question le cadre lui-même. Or il devient urgent de mettre en question le cadre ! C’est-à-dire de passer non plus à la revendication mais à l’affirmation du cadre que nous voulons redessiner. Pour le coup, il n’y a personne auprès de qui nous pourrions « revendiquer » un autre cadre. C’est à nous de nous emparer de cette question et de le faire ! Voici alors comment nous articulons revendication et affirmation : nous disons « non à la loi et au monde El Khomri ». Nous revendiquons contre la loi mais nous affirmons que nous voulons un autre monde que celui qui réengendre sans cesse des lois comme celle-là. Tant que nous resterons dans le seul registre revendicatif, nous n’en finirons pas de devoir parer les coups les uns après les autres dans ce registre exclusivement défensif où le néolibéralisme nous a enfermés depuis trois décennies. Il faut passer à l’offensive, et passer à l’offensive, c’est cesser de dire ce que nous ne voulons pas pour commencer à dire ce que nous voulons. »
On se rapproche vraiment de la cause des causes, non ?
« Il faut cesser de dire ce que nous ne voulons pas pour commencer à dire ce que nous voulons »
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10154126893232317
[Outils de contamination démocratique] ARGUMENTS pour débattre autour de vous sur le thème « ÉLECTION ou TIRAGE AU SORT ? »
Jérôme vient de publier un chouette boulot 🙂
Voici son annonce :
Jérôme Brachet a ajouté 16 photos à l’album Vices de l’élection vs Vertus du tirage au sort.
Proposition de visuels graphiques (Format JPEG / Taille 1160 x 640 px) extraits du tableau de synthèse des 16 vices de l’élection et vertus du tirage au sort, réalisé par Etienne Chouard pour le Plan C : instituer une vraie démocratie par une Constitution d’origine Citoyenne.
En réponse à l’appel lancé sur l’article [Vidéos + Conférence et débats, Nantes-école des Mines, 6 avril 2016, les films sont disponibles] d’Etienne Chouard > https://www.chouard.org/2016/04/10/videos–conference–et–atelier–constituant–nantes–ecole–des–mines–6–avril–2016–les–films–sont–disponibles/
Sources :
Tableau sur le site du Plan C : https://old.chouard.org/Europe/tirage_au_sort.php
Page Facebook Etienne Chouard : https://www.facebook.com/etienne.chouard
Notes :
– Proposition graphique : Jérôme Brachet
– Crédit : graphisme Studio Jérôme Brachet – 2016
– Licence : images libre de droits dans le cadre du Plan C d’Etienne Chouard – Alsacerd.
Me contacter pour la source des visuels ou toute autre demande.
=================================================================
Mon commentaire :
Ces planches peuvent aider les gens à lancer des discussions autour d’eux sur un point précis (un seul à la fois), plutôt que se lancer d’emblée sur un tsunami d’arguments 🙂
J’espère que ça va circuler et que de nouveaux arguments vont apparaître, que ceux-là vont être améliorés, corrigés, organisés, renforcés.
On a déjà suggéré (sur Facebook) que l’on pourrait faire des planche qui incite les gens à répondre eux-mêmes plutôt que leur asséner ainsi les réponse. C’est une bonne idée. Produisez des planches, on les publiera si elles sont bien.
On a aussi suggéré qu’il manquait les arguments en défense de l’élection 🙂
Alors, je souhaite solennellement bon courage à ceux qui vont tenter de bâtir une liste des vertus de l’élection parmi des candidats 🙂 du point de vue de l’intérêt général bien sûr, parce que le tableau des vertus de l’élection du point de vue des ultras riches, c’est fastoche 🙂
Ça serait même marrant à rédiger, non ?
Bon, j’attends beaucoup de notre cerveau collectif 🙂
Bon courage au quotidien, les virus 🙂
Étienne.
PS : ce serait bien de couper la partie de bas, pour déchouardiser le truc, je pense.
En même temps, c’est une vachement bonne idée de router les gens sur la page dédiée au tirage au sort : il y a des milliers de trucs importants sur cette page…
Je ne sais pas ce qu’il faut faire 🙂
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10154124973207317
[Urgent] Nous devons aider Antoine Deltour, lanceur d’alerte, persécuté par les politiciens
Denis Robert défend Antoine Deltour à Ce Soir Ou Jamais :
httpv://youtu.be/YKTdQHqO0E4
Quel scandale, mais bon sang quel scandale ! Antoine Deltour nous alerte, au risque de sa liberté, sur un monstrueux hold-up permanent (le LuxLeaks), commis par les multinationales qui volent les peuples (grâce à la complicité active du Luxembourg) par milliards ; et que font nos prétendus « représentants » ? au lieu de poursuivre les banques et les multinationales ?
Ils poursuivent le donneur d’alerte !!!!!!
Avec le faux « suffrage universel » (élire des maîtres au lieu de voter nos lois), les pires gouverneront, et nous y sommes.
En attendant de sortir de ce piège, Antoine Deltour a besoin d’aide, et massive : il faut absolument que nous soyons très nombreux, mais vraiment très nombreux pour pétitionner, protester, pester, tonner, tempêter, fulminer, manifester, invectiver, vilipender, accuser, plaider, argumenter, et finalement empêcher cette incroyable injustice.
Nous devons défendre nous-mêmes nos lanceurs d’alerte, c’est simple.
Voici quelques liens, à commencer par celui de la pétition que nous devrions tous avoir signée dans les heures qui viennent (je m’y prends tard, le procès est dans quelques jours, ça urge).
Et puis ensuite, vite passer le mot à tous nos contacts :
• Le lien vers la pétition en faveur d’Antoine Deltour :
https://www.change.org/p/soutenons–antoine–deltour–luxleaks–support–antoine
• Le compte Facebook du comité de soutien à Antoine Deltour :
https://www.facebook.com/Support–Antoine–388682861307176/
• Le site de soutien :
https://support-antoine.org/
Jean-Luc Mélenchon a fait au Parlement européen une courte mais forte intervention sur ce scandale :
httpv://youtu.be/Jkojd3SskSY
Quand même, si on n’est pas foutus de défendre personnellement ces héros-là (Assange, Snowden, Deltour… et les prochains), on est vraiment minables lamentables indécrottables pitoyables 🙂
Bon, allez, faut se bouger pour l’aider, ce jeune homme. Faites passer !
Salut à tous, bande de virus 🙂
Étienne.
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10154123005147317
[Vidéos] Conférence et débats, Nantes-école des Mines, 6 avril 2016, les films sont disponibles
Les films de la soirée du 6 avril à l’école des Mines de Nantes
sont disponibles ici (deux parties => 2 vidéos) :
1. Histoire en deux mots (Athènes et les autres formes de démocratie), situation actuelle, mots importants à l’envers, et surtout comparaison élection vs tirage au sort, puis débat
http://imedia.emn.fr/videos/watch.php?id=772

2. Proposition : apprendre à vouloir écrire et protéger nous-mêmes la constitution, idée des ateliers constituants populaires, conseils pratiques pour la contagion, puis débat
http://imedia.emn.fr/videos/watch.php?id=771

_____________________
Remarque importante :
Je vous présente ici (de la minute 43:30 à 1 h 08:45 de la première vidéo) (est-ce que quelqu’un saurait isoler et publier ce passage-là ?), en prenant pour la première fois le temps d’en parler en détail, un tableau que je crois essentiel, qui devrait bien vous servir à fixer vos idées, et qui alimente le nécessaire procès citoyen du faux « suffrage universel » (élire des maîtres au lieu de voter des lois), possible source première du capitalisme, en réorganisant la liste des arguments « en miroir » : vices de l’élection parmi des candidats(*) dans la colonne de gauche, en regard des vertus correspondantes du tirage au sort dans la colonne de droite (cliquez sur l’image) :
J’appelle à l’aide ici notre « cerveau collectif » pour suggérer un meilleur plan de ce comparatif en deux ou trois parties, avec une mise en ordre logique et puissante à l’intérieur de chaque partie, de manière à laisser une trace plus profonde et plus déterminante dans l’esprit des lecteurs.
Je vous passe le fichier au format doc et rtf : ce sera plus simple pour le réordonner/compléter/simplifier à votre guise.
Au plaisir de vous lire 🙂
Elle était vraiment chouette, cette soirée 🙂
Le lendemain aussi a été formidable (les ateliers). Je suis un gros veinard…
Merci à tous pour vos encouragements, vous êtes très émouvants.
Étienne.
(*) l’élection sans candidats n’a rien à voir, absolument rien à voir.
[Vidéos] Conférence et atelier constituant, Montreuil, mars 2016, les films sont arrivés.
httpv://youtu.be/lNpSiQy7Cgc
httpv://youtu.be/ZPL6wkJMd1Q
Merci à tous les jeunes gens de « 4ème singe » 🙂
Allons tous constituer avec les indignés de Nuit Debout 🙂
#convergencedesluttes
Étienne.
Lien Facebook vers ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10154114466177317
#NuitDebout : témoignage épatant d’un citoyen constituant (ultra contagieux :o) )
#NuitDebout Place de la République :
témoignage épatant d’un citoyen constituant (ultra contagieux 🙂 )

« Hier après midi, je suis allé place de la République avec un panneau monté sur pied invitant les citoyens à écrire leur Constitution.

Avec aussi le document (pour les passants) que l’on trouve sur le site et la date de notre Prochain AC le 23 avril.
http://ateliersconstituants.com/
Alors que je donnais des infos, j’ai été sollicité par France Culture puis France inter pour des interviews destiné à leur journal et à l’émission « interception ».
Puis des citoyens m’ont proposé pour en organiser un tout de suite sur le trottoir, un citoyen, Fabien, est allé acheter 10 bics et un bloc de papier nous nous sommes assis par terre à 6.
Puis le cercle s’est agrandi, quand nous avons dépassé la vingtaine j’ai proposé qu’on fasse quatre groupes et que chacun se trouve un thème.
Trois groupes se sont formés et là le processus m’a complètement échappé, deux heures après un forum d’une centaine de personne parlait de constitution en respectant l’écoute de ceux qui parlaient et avec des citoyens qui notaient.
Une restitution du travail des groupes doit me parvenir par email aujourd’hui.
Je ne peux y retourner aujourd’hui mais Fabien va assurer le renouvellement de l’expérience à partir de 18h00 avec mon panneau.
Il faudrait imprimer 4000 chartes et les distribuer en masse ce soir place de la République.
De nombreux citoyens ont manifesté leur intention de venir le 23 avril.
On va être dépassés par le succès : tant mieux !
Dèmos kratiquement,
Wikicrate Lcc.
Merci Wikicrate ! 🙂
« La Charte » (à imprimer et à distribuer un peu partout) dont parle Wikicrate est sans doute ce document (cliquez dessus pour l’ouvrir) :

http://ateliersconstituants.com/documents/lieu_public.htm
Faites passer, bande de virus 🙂
Étienne.

http://ateliersconstituants.com/
______________
PS : Le fait que Frédéric soit (enfin) devenu favorable — et même militant ! — à un processus constituant populaire est une sacrée bonne nouvelle, je suis content, ça va stimuler encore plein de gens :
httpv://youtu.be/3IrACAg48OU
L’article charnière, dans le Diplo :
« Fin de cycle pour la social-démocratie
Pour la république sociale »
par Frédéric Lordon, qui nous vante ici (enfin ! ça fait 11 ans que je le tanne avec ça 🙂 ) l’écriture par le peuple lui-même de la Constitution, sans plus rien attendre des élus ni des puissants :
https://www.monde-diplomatique.fr/2016/03/LORDON/54925
Rappel (nostalgique 🙂 ) :
Frederic Lordon répond à Etienne Chouard sur le processus constituant
httpv://youtu.be/-Fn4mYdpMKI
______________
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10154104657787317?pnref=story
John Pilger : « une guerre mondiale a commencé – Brisez le silence ». – ÉC : « cherchez la cause des causes dans notre consentement au faux »‘suffrage universel’ (élire des maîtres au lieu de voter nos lois). »
Encore une remarquable synthèse de John Pilger, intitulée « Une guerre mondiale a commencé – Brisez le silence » (voir plus bas).

Mon commentaire : j’aime lire John Pilger. Mais, je désespère de ne trouver, même chez lui, toujours pas un mot sur la cause première de toutes ces grandes misères : notre consentement au faux « suffrage universel » (élire des maîtres au lieu de voter les lois), procédure ploutocratique qui donne (toujours) le pouvoir de décider aux ultras-riches et qui conduit donc – mécaniquement, depuis 200 ans – au capitalisme, et à la guerre.
Nous aurons la guerre tant que nous adorerons (idiotement) l’élection comme une vache sacrée.
La seule procédure qui retire toute prise aux escrocs politiciens est aussi la seule procédure authentiquement démocratique, c’est le tirage au sort.
Pas de paix sans démocratie et pas de démocratie sans tirage au sort.
Mais pas de tirage au sort sans processus constituant populaire => Vous n’y couperez pas, il va falloir travailler : si vous voulez une vraie constitution, il faudra apprendre à l’écrire vous-même.
Sinon, comme toujours, les pires gouverneront.
Une guerre mondiale a commencé – Brisez le silence (par John Pilger)

John Pilger est un journaliste de nationalité Australienne, né à Sydney le 9 Octobre 1939, parti vivre au Royaume-Uni depuis 1962. Il est aujourd’hui basé à Londres et travaille comme correspondant pour nombre de journaux, comme The Guardian ou le New Statesman.
Il a reçu deux fois le prix de meilleur journaliste de l’année au Royaume-Uni (Britain’s Journalist of the Year Award). Ses documentaires, diffusés dans le monde entier, ont reçu de multiples récompenses au Royaume-Uni et dans d’autres pays.
John Pilger est membre, à l’instar de Vandana Shiva et de Noam Chomsky, de l’IOPS (International Organization for a Participatory Society), une organisation internationale et non-gouvernementale créée (mais encore en phase de création) dans le but de soutenir l’activisme en faveur d’un monde meilleur, prônant des valeurs ou des principes comme l’autogestion, l’équité et la justice, la solidarité, l’anarchie et l’écologie.
Article initialement publié le 20 mars 2016 en anglais, sur le site officiel de John Pilger, à cette adresse.
Je suis allé filmer aux îles Marshall, qui se situent au Nord de l’Australie, au milieu de l’océan Pacifique. A chaque fois que je raconte cela à des gens, ils demandent, « Où est-ce ? ». Si je leur donne comme indice « Bikini », ils répliquent, « vous parlez du maillot de bain ».
Bien peu semblent savoir que le maillot de bain bikini a été ainsi nommé pour commémorer les explosions nucléaires qui ont détruit l’île de Bikini. Les États-Unis ont fait exploser 66 engins nucléaires aux îles Marshall entre 1946 et 1958 – l’équivalent de 1,6 bombe d’Hiroshima chaque jour, pendant 12 ans.
Bikini est silencieuse aujourd’hui, mutante et contaminée. Des palmiers y poussent sous une étrange forme de grille. Rien ne bouge. Il n’y a pas d’oiseaux. Les stèles du vieux cimetière sont vibrantes de radiations. Mes chaussures ont été déclarées “dangereuses” sur un compteur Geiger.
Debout sur la plage, j’ai regardé le vert émeraude du Pacifique disparaître dans un vaste trou noir. Il s’agissait du cratère laissé là par la bombe à hydrogène qu’ils avaient appelée « Bravo ». L’explosion a empoisonné les gens et leur environnement sur des centaines de kilomètres, peut-être pour toujours.
Lors de mon voyage de retour, je me suis arrêté à l’aéroport d’Honolulu, et j’ai remarqué un magazine états-unien intitulé « Women’s Health » (la Santé des Femmes) . Sur la couverture, une femme souriante dans un maillot de bain bikini, et comme titre : « Vous aussi, vous pouvez avoir un corps bikini ». Quelques jours auparavant, aux îles Marshall, j’avais interviewé des femmes qui avaient des« corps bikini » très différents ; elles souffraient toutes de cancer de la thyroïde ou d’autres cancers mortels.
Contrairement à la femme souriante du magazine, elles étaient toutes pauvres, victimes et cobayes d’un superpouvoir vorace, aujourd’hui plus dangereux que jamais.
Je relate cette expérience en guise d’avertissement et pour mettre un terme à une distraction qui a consumé beaucoup d’entre nous. Le fondateur de la propagande moderne, Edward Bernays, a décrit ce phénomène comme « la manipulation consciente et intelligente des habitudes et des opinions » des sociétés démocratiques. Il l’a appelé le « gouvernement invisible ».
Combien sont au courant qu’une guerre mondiale a commencé ? En ce moment, il s’agit d’une guerre de propagande, de mensonges et de distraction, mais cela peut changer instantanément au moindre ordre mal interprété, avec le premier missile.
En 2009, le président Obama se tint devant une foule en liesse au centre de Prague, au cœur de l’Europe. Il s’engagea à « libérer le monde des armes nucléaires ». Les gens applaudirent et certains pleurèrent. Un torrent de platitudes jaillit des médias. Par la suite, Obama reçut le prix Nobel de la paix.
Un tissu de mensonge. Il mentait.
L’administration Obama a fabriqué plus d’armes nucléaires, plus de têtes nucléaires, plus de systèmes de vecteurs nucléaires, plus de centrales nucléaires. Les dépenses en têtes nucléaires à elles seules ont plus augmenté sous Obama que sous n’importe quel autre président. Le coût sur 3 ans s’élève à plus d’1 billion de dollars.
Une mini- bombe nucléaire est prévue. Elle est connue sous le nom de B61-12. C’est sans précédent. Le Général James Cartwright, ancien vice-président de l’état-major interarmées, a expliqué que :« Miniaturiser [rend l’utilisation de cette bombe] nucléaire plus concevable ».
Au cours des dix-huit derniers mois, la plus grande concentration de forces militaires depuis la seconde Guerre Mondiale — opérée par les USA — a lieu le long de la frontière occidentale de la Russie. Il faut remonter à l’invasion de l’Union Soviétique par Hitler pour trouver une telle menace envers la Russie par des troupes étrangères.
L’Ukraine — autrefois membre de l’Union Soviétique — est devenue un parc d’attraction pour la CIA. Ayant orchestré un coup d’état à Kiev, Washington contrôle efficacement un régime frontalier et hostile envers la Russie, un régime littéralement infesté de Nazis. D’importantes personnalités du parlement Ukrainien sont les héritiers politiques des partis fascistes OUN et UPA. Ils font ouvertement l’apologie d’Hitler et appellent à la persécution et à l’expulsion de la minorité russophone.
Tout cela est rarement rapporté en Occident, quand ce n’est pas inversé pour travestir la vérité.
En Lettonie, Lituanie et en Estonie — à côté de la Russie — l’armée US déploie des troupes de combat, des tanks, des armes lourdes. Cette provocation extrême de la seconde puissance nucléaire du monde est passée sous silence en Occident.
La perspective d’une guerre nucléaire est d’autant plus dangereuse qu’une campagne parallèle a été lancée contre la Chine.
Il est rare qu’un jour passe sans qu’on parle de la Chine comme d’une « menace ». Selon l’Amiral Harry Harris, le commandant en chef US du Pacifique, la Chine « construit un grand mur de sable dans le Sud de la Mer de Chine ».
Il fait référence à la construction par la Chine de pistes d’atterrissage dans les îles Spratly, qui font l’objet d’un conflit avec les Philippines — un conflit sans importance avant que Washington ne mette la pression sur le gouvernement de Manille et ne tente de le soudoyer, et que le Pentagone ne lance une campagne de propagande appelée « liberté de navigation ».
Qu’est-ce que cela veut vraiment dire ? Cela signifie la liberté pour les navires de guerre états-uniens de patrouiller et de dominer les eaux côtières de la Chine. Essayez d’imaginer la réaction états-unienne si les navires de guerre chinois faisaient la même chose au large de la Californie.
J’ai réalisé un film appelé « La guerre invisible », dans lequel j’ai interviewé d’éminents journalistes aux USA et au Royaume-Uni : des reporters comme Dan Rather de CBS, Rageh Omar de la BBC, et David Rose de The Observer.
httpv://youtu.be/hJh_7Xjq1ek
Tous déclarèrent que si journalistes et radiodiffuseurs avaient joué leur rôle en remettant en question la propagande selon laquelle Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive, que si les mensonges de George W. Bush et de Tony Blair n’avaient pas été amplifiés et colportés par les journalistes, l’invasion de l’Irak de 2003 aurait pu ne pas avoir eu lieu, et des centaines de milliers de femmes, d’hommes et d’enfants seraient encore en vie aujourd’hui.
La propagande préparant actuellement le terrain pour une guerre contre la Russie et/ou la Chine n’est en principe pas différente. A ma connaissance, aucun journaliste du « mainstream » Occidental — un équivalent de Dan Rather, disons — ne pose la question de savoir pourquoi la Chine construit des pistes d’atterrissage dans le Sud de la mer de Chine.
La réponse devrait être flagrante. Les USA encerclent la Chine d’un réseau de bases militaires, de missiles balistiques, de groupes de combat, de bombardiers nucléaires.
Cet arc létal s’étend de l’Australie aux îles du Pacifique, les Mariannes, les îles Marshall et Guam, les Philippines, la Thaïlande, Okinawa et la Corée, et à travers l’Eurasie, jusqu’à l’Afghanistan et l’Inde. Les USA ont passé la corde autour du cou de la Chine. Cela ne fait pas l’objet d’un scoop. Silence médiatique. Guerre médiatique.
En 2015, dans le plus grand secret, les USA et l’Australie ont effectué le plus important exercice militaire air-mer de l’histoire contemporaine, sous le nom de Talisman Sabre. Il visait à répéter un plan de bataille Air-Mer, bloquant les voies maritimes, comme les détroits de Malacca et de Lombok, ce qui couperait l’accès de la Chine au pétrole, au gaz et à d’autres matières premières vitales provenant du Moyen-Orient et de l’Afrique.
Dans le cirque que constitue la campagne présidentielle états-unienne, Donald Trump est présenté comme un fou, un fasciste. Il est certainement odieux ; mais il est aussi un pantin de haine médiatique. Ce simple fait devrait suffire à éveiller notre scepticisme.
Les idées de Trump sur l’immigration sont grotesques, mais pas plus que celles de David Cameron. Ce n’est pas Trump le Grand Déportateur des USA, mais le prix Nobel de la Paix, Barack Obama.
Selon un prodigieux commentateur libéral, Trump « déchaîne les forces obscures de la violence » aux USA. Il les déchaîne ?
Ce pays est celui où des bambins tirent sur leur mère et où la police mène une guerre meurtrière contre les noirs américains. Ce pays est celui qui a attaqué et tenté de renverser plus de 50 gouvernements, dont de nombreuses démocraties, qui a bombardé de l’Asie au Moyen-Orient, entraînant la mort et le déplacement de millions de gens.
Aucun pays n’atteint ce niveau record de violence systémique. La plupart des guerres états-uniennes (presque toutes contre des pays sans défense) n’ont pas été déclarées par des présidents républicains mais par des libéraux démocrates : Truman, Kennedy, Johnson, Carter, Clinton, Obama.
En 1947, une série de directives du conseil de sécurité national illustrent l’objectif primordial de la politique étrangère états-unienne : « un monde considérablement fait à l’image [de l’Amérique] ». L’idéologie de l’américanisme messianique. Nous étions tous américains. Ou autres. Les hérétiques seraient convertis, subvertis, soudoyés, calomniés ou broyés.
Donald Trump est un symptôme de tout cela, mais c’est aussi un anticonformiste. ll dit que l’invasion de l’Irak était un crime ; il ne veut pas de guerre contre la Russie et la Chine. Le danger pour nous n’est pas Trump, mais Hillary Clinton. Elle n’a rien d’une anticonformiste. Elle incarne la résilience et la violence d’un système dont « l’exceptionnalisme » tant vanté n’est qu’un totalitarisme au visage occasionnellement libéral.
À mesure que se rapproche l’élection présidentielle, Clinton sera saluée comme la première femme présidente, sans considération aucune de ses crimes et de ses mensonges — tout comme Obama fut acclamé en tant que premier président noir, et que les libéraux gobaient ses propos absurdes sur« l’espoir ». Et l’illusion se perpétue.
Dépeint par le chroniqueur du Guardian Owen Jones comme « drôle, charmant, tellement cool qu’il éclipse pratiquement tous les autres politiciens », Obama a récemment envoyé des drones massacrer 150 personnes en Somalie. Il tue habituellement des gens le mardi, selon le New York Times, lorsqu’on lui remet une liste de personnes à tuer par drone. Tellement cool.
Lors de la campagne présidentielle de 2008, Hillary Clinton a menacé de « totalement oblitérer » l’Iran par voie d’armes nucléaires. En tant que secrétaire d’état sous Obama, elle a participé au renversement du gouvernement démocratique du Honduras. Sa contribution à la destruction de la Libye en 2011 fut une quasi-jubilation. Lorsque le leader Libyen, le colonel Kadhafi, fut publiquement sodomisé avec un couteau — un meurtre rendu possible par la logistique états-unienne — Clinton se réjouit de sa mort : « Nous sommes venus, nous avons vu, il est mort ».
L’une des plus proches alliés de Clinton est Madeleine Albright, l’ancienne secrétaire d’état, qui s’en est pris à des jeunes filles parce qu’elles ne soutenaient pas « Hillary ». La tristement célèbre Madeleine Albright qui célébra à la télévision la mort d’un demi- million d’enfants irakiens comme« valant le coup ».
Parmi les plus importants soutiens de Clinton, on retrouve le lobby Israélien et les compagnies d’armement qui ont alimenté la violence au Moyen-Orient. Elle et son mari ont reçu une fortune de la part de Wall Street. Et pourtant, elle s’apprête à se voir affublée du titre de candidate des femmes, à même de triompher du diabolique Trump, le démon officiel. On dénombre également de nombreux féministes parmi ses supporters : ceux de la trempe de Gloria Steinem aux USA et d’Anne Summers en Australie.
Une génération auparavant, un culte post-moderne que l’on appelle aujourd’hui « la politique identitaire » a bloqué de nombreux esprits libéraux intelligents dans leur examen des causes et des individus qu’ils soutenaient — comme les fraudes que sont Obama et Clinton ; comme le mouvement progressiste bidon Syriza en Grèce, qui a trahi son peuple en s’alliant avec ses ennemis.
L’auto-absorption [le narcissisme, NdT], une forme « d’égocentrisme », devint le nouvel esprit du temps dans les sociétés occidentales privilégiées et signala la défaite des grands mouvements collectifs contre la guerre, l’injustice sociale, l’inégalité, le racisme et le sexisme.
Aujourd’hui, ce long sommeil prend peut-être fin. Les jeunes s’agitent à nouveau. Progressivement. Les milliers de britanniques qui ont soutenu Jeremy Corbyn comme leader du parti travailliste font partie de cette agitation — ainsi que ceux qui se sont ralliés au sénateur Bernie Sanders.
Au Royaume-Uni, la semaine dernière, le plus proche allié de Jeremy Corbyn, le trésorier de l’opposition John McDonnell, a engagé le gouvernement travailliste au paiement des dettes frauduleuses des banques, et, dans les faits, à continuer sa politique de soi-disant austérité.
Aux USA, Bernie Sanders a promis de soutenir Clinton si ou lorsqu’elle sera nominée. Lui aussi a voté pour l’utilisation de la violence par les USA contre d’autres pays lorsqu’il jugeait cela « juste ». Il dit qu’Obama a « fait un excellent travail ».
En Australie, il règne une sorte de politique mortuaire, dans laquelle des jeux parlementaires assommants sont diffusés dans les médias tandis que les réfugiés et les peuples indigènes sont persécutés et que croissent les inégalités, ainsi que la menace d’une guerre. Le gouvernement de Malcolm Turnbull vient d’annoncer un budget de la soi-disant défense de 195 milliards de dollars, véritable incitation à la guerre. Il n’y eut aucun débat. Silence.
Qu’est devenue la grande tradition populaire d’action directe, libre de tout parti ? Où sont le courage, l’imagination et l’engagement qu’exige la lutte pour un monde meilleur, juste et paisible ? Où sont les dissidents de l’art, du cinéma, du théâtre, de la littérature ?
Où sont ceux qui oseront briser le silence ? Devons-nous attendre que le premier missile nucléaire soit tiré ?
John Pilger
Traduction : Nicolas Casaux
Édition & Révision : Héléna Delaunay
______
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10154101988737317?pnref=story