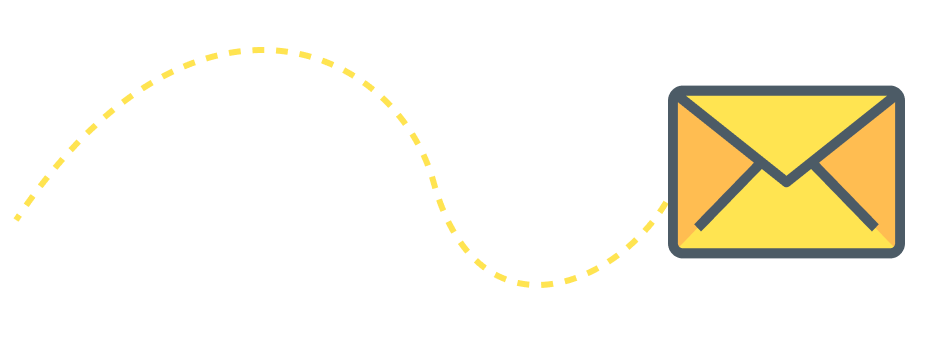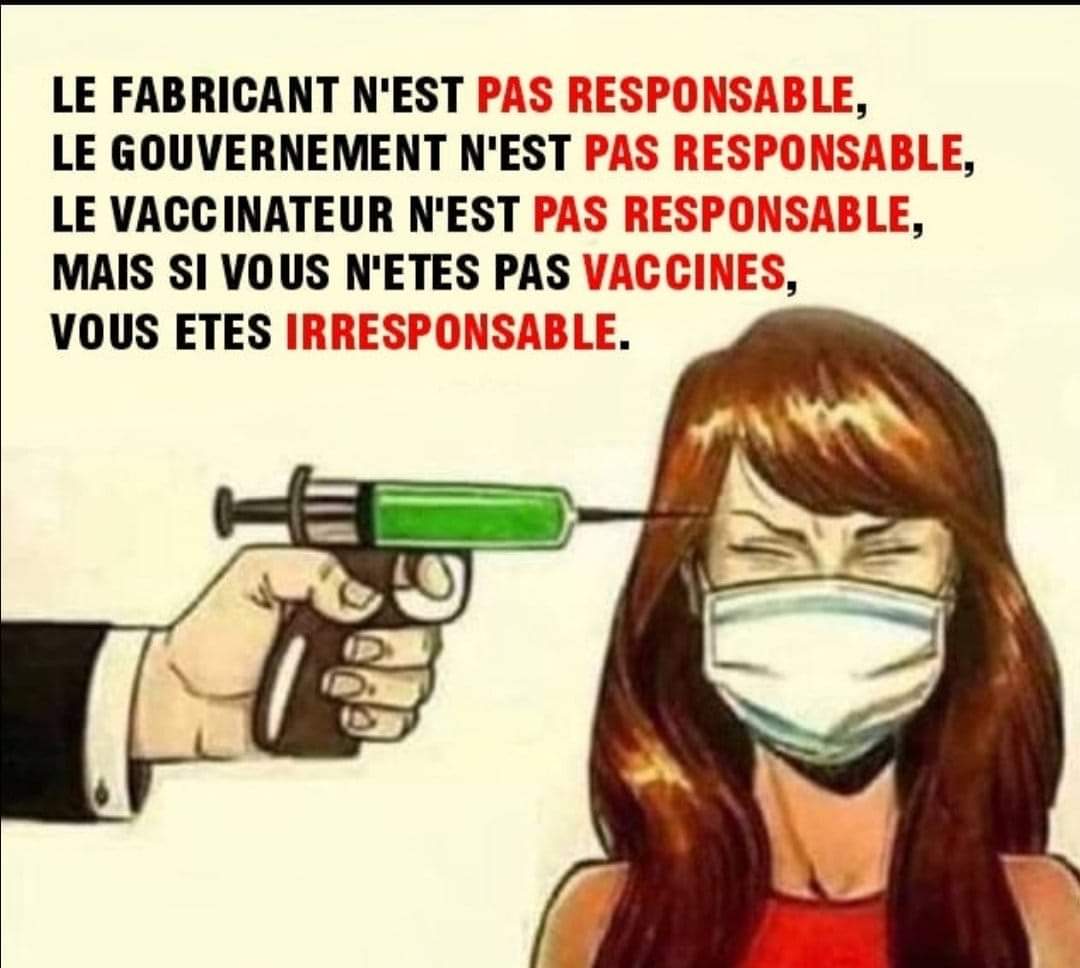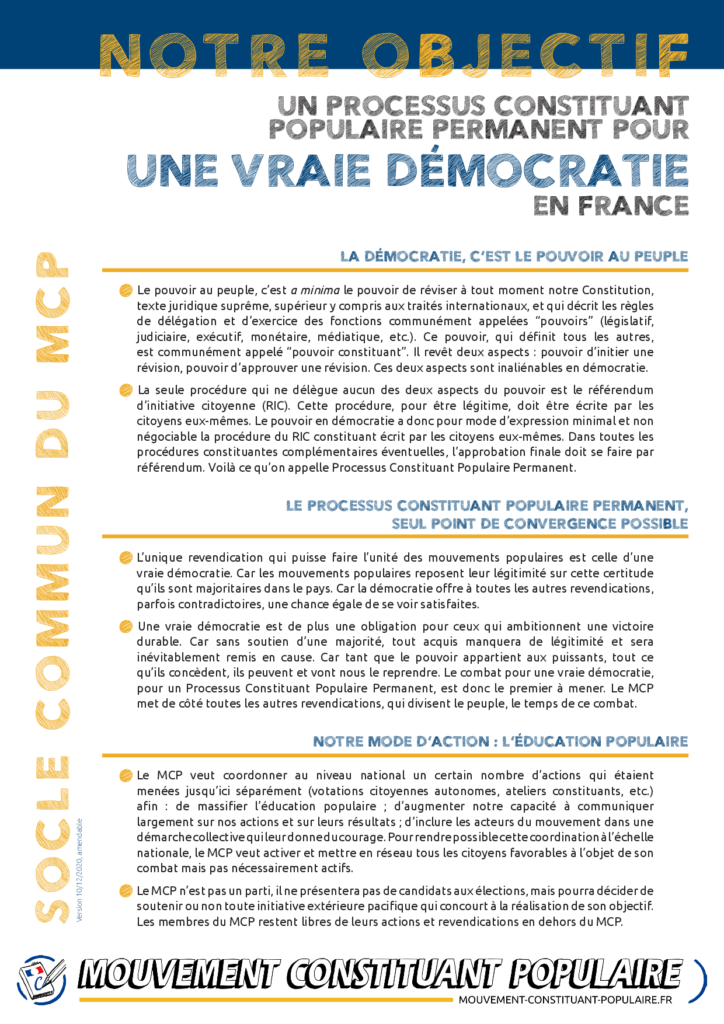Articles du blog
Les derniers articles du blog
Atelier constituant en direct avec Etienne Chouard #4 : procès du tirage au sort, sur Nexus, 15 oct 2025 à 17h
Chers amis, Comme vous le savez, depuis vingt ans, j’incrimine L’ÉLECTION, et premièrement l’élection de l’assemblée constituante, comme CAUSE PREMIÈRE DE L’IMPUISSANCE POLITIQUE des êtres humains, et de leur incapacité à défendre eux-mêmes la justice, la prospérité et la paix. Cette analyse m’a conduit plusieurs fois à exposer ce que j’ai appelé « le nécessaire procès citoyen de l’élection », au terme duquel l’élection parmi des candidats a été jugée COUPABLE, sans hésitation. Vous trouverez…
Entretien constituant chez « Les Incorrectibles » : RESPONSABILITÉ DES VRAIS JOURNALISTES (rôle des « médias alternatifs ») DANS LA PROGRESSION – OU PAS – DE LA CONSCIENCE POPULAIRE DE LA PRIORITÉ CONSTITUANTE – 12/10/2025
Vous allez voir, elles changent, mes interviews, ces temps-ci 🙂 (J’ai commencé à muter ce #10septembre pour interpeller Clémence.) Celle-là devrait vous intéresser 🙂 Merci à Éric Morillot d’avoir mis cet entretien intégral (1h55) en consultation libre et gratuite Il faut vraiment qu’on trouve un modèle économique qui permette aux vrais journalistes, ceux qu’on appelle les médias alternatifs, de gagner leur vie sans que le service public important qu’ils rendent à tous soit réservé à…
Atelier constituant mensuel (tout près de Bordeaux) – Samedi 11 octobre 2025 à Gradignan, à 14 h ‑Organisation du moment constituant, juste après le jour J
Rendez-vous demain à 14 h https://www.eventbrite.com/e/atelier-constituant-mensuel-samedi-11-octobre-a-gradignan-tickets-1786642318269 Description : « Inscription :Avec la participation exceptionnelle d’Etienne Chouard.Les places sont limitées à 30. Premiers inscrits, premiers servis ! Nous prévoyons d’être au complet pour cet évènement. Pour des questions de logistiques et de sécurité, nous n’accepterons à l’évènement que les personnes munies d’un billet eventbrite. Nous vous remercions pour…
Tous les articles du blog
Format grille – Format articles complets
Le passe sanitaire est un moyen extrajudiciaire de désactiver socialement les gens – nopass.fr (requête collective auprès de la CEDH, Guillaume Zambrano)
Chers amis,
Je vous signale ici le travail d’un jeune homme épatant, courageux et pertinent. Il s’appelle Guillaume Zambrano, il est professeur de droit à Montpellier, et il nous aide à formuler auprès de la CEDH une requête contre la dérive totalitaire du « régime » en France.
Le site Reporterre (à connaître absolument) vient de publier un court et dense entretien avec ce juriste.
La chaîne No Pass est un outil important.
Je pense que vous devriez, comme je l’ai fait moi-même, préparer et envoyer votre propre requête à la CEDH (c’est très simple et très rapide).
Bonne lecture.
Étienne.
« Le passe sanitaire est un moyen extrajudiciaire de désactiver socialement les gens »

Source : Reporterre, https://reporterre.net/Le–passe–sanitaire–est–un–moyen–extrajudiciaire–de–desactiver–socialement–les–gens
Selon le professeur de droit Guillaume Zambrano, le passe sanitaire est une atteinte aux droits fondamentaux ainsi qu’une sanction extrajudiciaire. Il a lancé une requête collective auprès de la Cour européenne des droits de l’Homme.
Guillaume Zambrano est maître de conférences en droit privé à l’université de Nîmes. Face à la loi imposant le passe sanitaire, il a lancé une requête collective auprès de la Cour européenne des droits de l’Homme.

Reporterre — En quoi le passe sanitaire porte-t-il atteinte aux droits fondamentaux ?
Guillaume Zambrano — Être exclu des transports publics, hôpitaux, cafés, restaurants, bibliothèques, associations sportives et culturelles et autres lieux de réunion est une privation de liberté extrêmement lourde : c’est une privation du droit de réunion, de la liberté d’aller et de venir, une véritable exclusion de la vie sociale. Le plus grave est qu’il s’agit d’une sanction extrajudiciaire. Depuis le XVIIᵉ siècle et le Bill of Rights anglais destiné à limiter l’arbitraire des souverains, notre tradition juridique est fondée sur le principe de l’habeas corpus : toute personne privée de liberté a le droit de passer devant un juge. De fait, quand une personne est assignée à résidence ou condamnée à porter un bracelet électronique, la mesure doit être approuvée par le juge des libertés et de la détention. Quand on condamne des personnes pour des dommages sociaux comme le vol, la fraude fiscale, les coups et blessures, elles ont eu droit à un procès. Et généralement, le but visé est la réinsertion sociale : même pour des délits graves, il y a du sursis, des aménagements de peine. Mais avec le passe sanitaire, toute une catégorie de personnes reçoivent une sanction pénale maximale sans qu’il y ait eu de jugement, sans même avoir pu se défendre.
Qu’est-ce qui justifie cette sanction ? Le fait de ne pas pouvoir (ou ne pas vouloir) présenter un QR code à l’entrée des lieux publics, de ne pas être vacciné ou testé. Ce qui est reproché aux gens, c’est d’être potentiellement contagieux. C’est d’autant plus grave qu’il est très rare en droit que l’on soit condamné pour une infraction par omission. La règle est d’être condamné pour avoir fait quelque chose, et non pour ne pas avoir fait quelque chose. Il existe le délit de non-assistance à personne en danger (article 223–6 du Code pénal), mais ses conditions sont très restrictives et les condamnations rares. Il existe aussi une jurisprudence pour des personnes ayant contaminé d’autres personnes avec le Sida en connaissance de cause, mais les juges ont retenu l’aspect intentionnel : non seulement elles se savaient malades et n’ont pas pris de précautions, mais elles ont déclaré vouloir contaminer d’autres personnes, c’est ce qui a motivé la condamnation [1].
« Ce ne sont plus les juges mais la population elle-même qui applique la sanction. »
Le passe sanitaire — sanction extrajudiciaire selon vous — représente-t-il un basculement ?
Le passe sanitaire sort du cadre ordinaire du droit pénal. Il donne lieu à des sanctions sociales inédites qui sont un mélange de privation de liberté, de stigmatisation et d’incitation à l’humiliation publique. C’est un moyen extrajudiciaire de désactiver socialement les gens, de les débrancher, en quelque sorte. Et ce ne sont plus les juges, mais la population elle-même — les cafetiers, les bibliothécaires, les gardiens de musée ou les employés des hôpitaux — qui applique la sanction. Cela indique que le gouvernement est passé dans une logique de répression massive : comme il ne peut pas mettre un juge derrière chaque citoyen, il se repose sur la population et sur des moyens automatisés pour le faire. C’est une révolution anti-libérale. La seule comparaison possible est celle du crédit social en Chine, une forme de rééducation à la carotte et au bâton : je t’interdis de prendre le train, d’accéder à tel emploi, d’aller au cinéma…
La pandémie de Covid-19 ne justifie-t-elle pas de déroger au droit de manière exceptionnelle ?
Depuis deux siècles, la France a érigé la liberté en tant que principe fondamental, naturel, inaliénable : les restrictions sont des exceptions qui doivent être strictement justifiées et proportionnelles. Dans le cadre d’un raisonnement sur la proportionnalité, les mesures portant atteinte aux libertés fondamentales doivent remplir trois conditions. D’abord, le test d’« aptitude » : la mesure est-elle apte à atteindre l’objectif affiché ? Le passe sanitaire et l’obligation vaccinale peuvent-ils lutter efficacement contre l’épidémie ? On peut en discuter, puisque les vaccins n’empêchent pas forcément la contagion. Ensuite, le test de « nécessité » : y aura-t-il un très grand nombre de morts si le gouvernement ne met pas en place cette mesure ? Vraisemblablement non, ce n’est pas le cas dans les pays qui n’ont pas recours au passe sanitaire comme la Suède ou l’Angleterre. Enfin, le test de « substitution » : existe-t-il des mesures alternatives et moins restrictives qui permettraient de lutter contre les effets de l’épidémie ? Oui : le gouvernement pourrait ouvrir des lits de réanimation, créer des hôpitaux de campagne, vacciner les personnes les plus à risque et les personnes volontaires, et tester fréquemment les soignants, ce qui serait dans ce cas plus efficace que l’obligation vaccinale. Le passe sanitaire et l’obligation vaccinale sont donc des mesures disproportionnées et excessives par rapport à la nature du danger et à leur capacité à y répondre.
L’obligation vaccinale des soignants, ou la quasi-obligation vaccinale imposée par le passe sanitaire, sont-elles contraires au droit ?
Le plus fondamental des droits fondamentaux est le respect de la dignité humaine dont le consentement libre et éclairé à l’acte médical est une manifestation. En principe, les atteintes à l’intégrité du corps humain ne sont jamais permises, sauf dans des circonstances particulières et si et seulement si elles sont justifiées par un intérêt médical pour vous [2]. En avril dernier, les juges européens ont rendu un arrêt justifiant la vaccination obligatoire des enfants contre le tétanos (arrêt Vavřička, 8/04/21) : on note que d’une part, la balance bénéfice/risque est positive pour les enfants, car le tétanos est dangereux pour eux, et que d’autre part, l’ancienneté des vaccins permet de connaître leur efficacité et la nature des risques à long terme. Dans le cas des vaccins contre le Sars-Cov2, c’est différent : non seulement leur intérêt médical pour les enfants et les adolescents fait débat [3], mais le fait qu’ils soient basés sur une technologie nouvelle ne permet raisonnablement pas d’en connaître les risques à long terme.
« Ce qui risque de se normaliser n’est plus seulement l’atteinte à la vie privée, mais l’atteinte à l’intégrité physique des individus. »
Ne risque-t-on pas de voir ces mesures d’exception se normaliser ?
Le risque est d’autant plus grand que la menace épidémique n’est pas de nature provisoire. Nous allons devoir vivre avec ce virus, ou avec d’autres virus. Si on est face à un risque permanent, alors il faut mettre en place des mesures permanentes, et celles-ci doivent bien sûr être compatibles avec les libertés. On peut constater que les mesures antiterroristes temporaires ont été dévoyées pour s’installer de manière permanente dans notre droit. Avec l’opération Sentinelle, le fait d’utiliser l’armée pour exercer des pouvoirs de police sur le peuple s’est normalisé. La surveillance de la population aussi : dans les années 1980, les écoutes de l’Élysée ont fait scandale ; en 2020, l’État peut écouter n’importe qui. Les mesures antiterroristes ont donc progressivement fait disparaître du droit la protection de la vie privée. Si on transpose cette situation aux mesures d’exception sanitaires, les conséquences sont vertigineuses : ce qui risque de se normaliser, ce n’est plus seulement l’atteinte à la vie privée, mais l’atteinte à l’intégrité physique des individus, la privation de sortie et de mouvement.
Quels espoirs placez-vous dans la requête que vous portez auprès de la Cour européenne des droits de l’Homme ?
Il faut rappeler une chose élémentaire : les droits de l’Homme sont au-dessus des lois. C’est la raison d’être de ces textes. Si les droits fondamentaux ont été inscrits dans les juridictions internationales et les constitutions, c’est précisément pour éviter que les gouvernements n’adoptent des lois contraires aux libertés et ne fassent basculer un pays dans la dictature. Il est donc nécessaire (quoique pas forcément suffisant) d’en appeler à la Cour européenne des droits de l’Homme dans la situation actuelle. En pratique, le but est d’éviter que l’obligation du passe sanitaire ne soit prolongée au-delà du 15 novembre 2021 par l’adoption d’une nouvelle loi. La Cour est légalement obligée de traiter toutes les requêtes, or ses moyens sont limités. Si elle est saisie par des dizaines de milliers de personnes, elle sera contrainte d’écouter nos arguments, pour éviter d’être complètement paralysée administrativement. En 2020, la CEDH a reçu un total de 40 000 requêtes de toutes natures. C’est ce chiffre qu’il faut dépasser. Nous sommes déjà à plus de 20 000. Toute personne de plus de 12 ans peut attaquer gratuitement et sans risques la loi sur le passe sanitaire.
Guillaume Zambrano, interrogé par Reporterre (source)
Ne ratez pas le site https://nopass.fr/
Un recours collectif contre le Passe Sanitaire
QUESTIONS (RÉPONSES à consulter sur https://nopass.fr/)
QUI ÊTES-VOUS ?
EN QUOI CONSISTE CETTE REQUÊTE ?
COMMENT PUIS-JE PARTICIPER ?
QUI PEUT ENVOYER LA REQUÊTE ?
LES MEMBRES D’UNE MÊME FAMILLE DOIVENT-ILS DUPLIQUER LES REQUÊTES ?
CE RECOURS EST-IL TOUJOURS D’ACTUALITÉ ?
ON M’A DIT QUE POUR SAISIR LA CEDH, IL FAUT ÉPUISER TOUTES LES VOIES DE RECOURS.
LA SAISIE DE LA CEDH EST-ELLE RISQUÉE ?
COMBIEN CELA COÛTE T‑IL ?
DES FRAIS SUPPLÉMENTAIRES SONT-ILS À PRÉVOIR ?
QUEL EST LE LIEN JURIDIQUE QUI NOUS UNIRA ?
PUIS-JE REMPLIR LE DOCUMENT NUMÉRIQUEMENT ?
COMMENT COMPLÉTER LA REQUÊTE ?
QUELLES ÉTAPES DOIS-JE SUIVRE ?
FAUT-IL JOINDRE DES DOCUMENTS AUX 13 PAGES DE LA REQUÊTE ?
JE N’AI PAS D’ADRESSE MAIL À RENSEIGNER DANS LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION
PUIS-JE METTRE DES RAISONS PERSONNELLES DANS L’ENCADRÉ DU RECOURS ?
JE N’ARRIVE PAS À VALIDER LE FORMULAIRE !
JE N’ARRIVE PAS À RÉCUPÉRER LE FORMULAIRE !
JE N’AI PAS REÇU LE MAIL DE CONFIRMATION DE MON INSCRIPTION, EST-CE NORMAL ?
JE N’AI PAS D’IMPRIMANTE, COMMENT FAIRE ?
PUIS-JE IMPRIMER RECTO-VERSO ?
LA REQUÊTE S’AFFICHE MAL (PAGES BLANCHES) OU L’IMPRESSION DE FONCTIONNE PAS.
DOIS-JE ENVOYER LA REQUÊTE PAR LETTRE RECOMMANDÉE (AVEC RAR) ?
DOIS-JE ENVOYER LE RECOURS À LA CEDH OU VOUS LE FAIRE PARVENIR ?
DOIS-JE REMPLIR CERTAINS CHAMPS ?
COMMENT M’INSCRIRE SUR LE SITE ?
OÙ EN EST MA REQUÊTE ?
JE CRAINS POUR MES DONNÉES, COMMENT ET COMBIEN DE TEMPS CELLES-CI SERONT CONSERVÉES ?
JE SOUHAITE SAVOIR S’IL EST POSSIBLE D’IMPRIMER VOTRE REQUÊTE ET LA FAIRE SIGNER PAR DES MANIFESTANTS.
JE SOUHAITE APPORTER MON AIDE ET MON SOUTIEN CONTRE LE « PASS SANITAIRE ». COMMENT DOIS-JE FAIRE ?
À QUELLE ÉCHÉANCE IMAGINEZ-VOUS UN RÉSULTAT (POSITIF OU NÉGATIF) ?
PORTER PLAINTE CONTRE LE PASSE SANITAIRE : SAISIR LA COUR EUROPENNE DES DROITS DE L’HOMME (GRATUIT)
Remplissez le formulaire, puis envoyez vous-même votre requête : https://nopass.fr/agir.php
Sur sa chaîne YouTube No Pass https://www.youtube.com/channel/UCC7hf9iTrnVwjoLmxY6qhkg (abonnez-vous)
Guillaume Zambrano expose ses analyses juridiques sur « le régime » et il nous donne de précieux conseils.
Exemples :
Les failles du passe sanitaire
Comment saboter le passe sanitaire : quelques pistes offertes par le Conseil Constitutionnel
FACT CHECKING FAKE NEWS : LE RETOUR DE LA PRAVDA
Un petit exemple d’arbitraire : le pass sanitaire pour les pique-niques
Le 3 septembre 2021, un tribunal administratif vient d’inventer une nouvelle notion : « le service de restauration non-facturé » … les gendarmes ont constaté que c’était gratuit, le préfet a constaté que c’était gratuit, les participants ont attesté de la gratuité .… OUPS problème, si c’est gratuit, il n’y avait pas d’infraction. Heureusement le gouvernement a pu compter sur un juge créatif pour confirmer la sanction de fermeture administrative. Voila pourquoi il faut massivement saisir les tribunaux, afin de paralyser le fonctionnement du rouleau compresseur judiciaire.
Devoir de désobéissance et passe sanitaire
Tous les agents publics, tous les salariés ont le devoir de désobéir aux ordres manifestement illégaux. Le passe sanitaire est manifestement illégal : la désobéissance est un devoir. Selon l’article 28 du statut des fonctionnaires (loi 83–643 du 13 juillet 1983), disposant : « tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas ou l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».
RÉSISTANCE CONCRÈTE : DEMANDER LE MAINTIEN DU SALAIRE EN RÉFÉRÉ AUX PRUD’HOMMES
Dans cette vidéo, les salariés trouveront les explications pour demander le maintien de leur salaire en justice. Facile, rapide, gratuit. Si vous avez des témoignages d’abus de la part des employeurs, n’hésitez pas à me contacter sur nopass.fr … vous n’êtes pas seuls, tenez bon !
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10159497710862317
Tweet correspondant à ce billet :
Le passe sanitaire est un moyen extrajudiciaire de désactiver socialement les gens
(requête collective auprès de la CEDH, Guillaume Zambrano, nopass . fr)https://t.co/c5SBfdSpZI
— Étienne Chouard (@Etienne_Chouard) September 28, 2021
Fil Telegram correspondant à ce billet :
https://t.me/chouard/167
Importante réflexion de René Chiche, au CSI (Conseil Scientifique Indépendant) n°23, sur la bascule totalitaire en France : interdiction de douter, soumission générale, gouvernance par les nombres, oppressions parallèles entre professeurs et médecins……
Chers amis,
Comme beaucoup d’entre vous, sans doute, je regarde chaque semaine, le jeudi soir, le très précieux Conseil Scientifique Indépendant (CSI), qui nous apporte chaque fois une bouffée d’air frais d’intelligence, d’honnêteté et de courage.
Je vous recommande la séance de jeudi dernier, particulièrement intéressante.
René Chiche (que je connais et apprécie depuis que nous participons tous les deux au Gouv) y est profond et décapant.
Son échange avec Louis (Fouché) est enrichissant et éclairant.

https://crowdbunker.com/v/0HvVTmUq
Bon courage à tous ceux qui sont martyrisés par l’oppression « sanitaire » des « Brutes en blanc » (© Martin Winckler).
Étienne.
PS : beaucoup des critiques formulées ici à propos de l’usage totalitaire des statistiques pour dépolitiser — et même déshumaniser — les décisions publiques s’articulent dans ma tête avec le formidable travail d’Alain Supiot sur la Gouvernance par les nombres (dont je vous ai beaucoup parlé ces dernières années).
Tweet correspondant à ce billet :
Importante réflexion de @rene_chiche, au CSI (Conseil Scientifique Indépendant) n°23, sur la bascule totalitaire en France : interdiction de douter, soumission générale, gouvernance par les nombres, oppressions parallèles entre professeurs et médecins…https://t.co/WfiA9xn5rH
— Étienne Chouard (@Etienne_Chouard) September 19, 2021
[Résistance à l’oppression] Analyse des CONTRATS PUBLIC SCANDALEUX signés en notre nom (mais contre l’intérêt général, en secret, sans contrôle et sans recours) par la Commission européenne avec (seulement certains) des industriels du vaccin
Dans la série « Bonnes raisons de ne plus jamais faire confiance à des criminels endurcis », je vous signale cet entretien passionnant, encore une fois publié par France Soir (on dirait qu’il n’y a presque plus qu’eux pour faire le boulot de journaliste dans ce pays, pourtant en plein effondrement des libertés et de l’État de droit), sur les contrats léonins (contrats profondément déséquilibrés, imposés par des lions à leurs victimes) signés en notre nom (mais contre nous et en secret et hors de tout contrôle possible, sans aucun recours) par la Commission européenne avec (certains) des industriels des vaccins.
Je trouve cet entretien très important et je m’étonne qu’aucun de ceux qui se disent « journalistes » dans ce pays n’accepte d’enquêter sur ce scandale, ni même de seulement relayer cet entretien publié par France Soir.
Les agressions dont France Soir fait l’objet sont à la hauteur des services qu’il rend à l’intérêt général en résistant courageusement aux abus de pouvoir.
Étienne.
« Un contrat aussi favorable à l’industriel, cela me paraît anormal » Olivier Frot
Source : https://www.francesoir.fr/videos–les–debriefings/olivier–frot, publié le 10/09/2021

Olivier Frot
Debriefing avec Olivier Frot, diplômé de Saint-Cyr et docteur en droit. Cet entretien porte sur l’analyse des contrats des vaccins passés par l’Union européenne avec les fabricants.
Fort de son expérience dans la haute administration, expert en marchés publics, après une carrière militaire comme officier dans l’Armée de Terre où il passait des marchés nationaux pour l’armée française et des marchés internationaux dans le cadre de l’OTAN, Olivier Frot est également auteur de plusieurs ouvrages sur les marchés publics.
Après avoir fait le constat d’une avalanche de mensonges et d’informations tronquées, il décide de ne pas se fier aux études rapportées sur les contrats et d’aller à la source. Sur un site officiel de la Commission européenne, il trouve les différents contrats passés par la commission et décide de les examiner.
Dénonçant des contrats « caviardés », il explique que sur sept contrats, seuls deux sont en clair : le Pfizer-BioNtech et le Moderna. Pour tous les autres, il manque des éléments très importants comme les quantités, les prix, la propriété intellectuelle, la responsabilité. Ce qui est occulté est masqué par des bandes noires afin qu’on ne puisse pas lire.
Puis il se livre à une analyse détaillée dans laquelle il pointe toutes les anomalies, notamment des contrats passés de gré à gré avec les industriels choisis selon des critères que l’on ne connaît pas.
Revenant sur le caractère expérimental du vaccin qui est en phase 3, il rappelle une communication du 15 octobre 2020 qui recommande aux États membres de mettre en place des études indépendantes pour évaluer l’efficacité et l’innocuité de ces vaccins pour la période 2020–2022, une obligation qu’il juge pertinente et qu’il souhaiterait voir appliquée dans les faits.
Après avoir constaté l’opacité qui règne autour de ces questions, il regrette que l’on ait noyé les citoyens dans des informations inutiles qui sont des affirmations péremptoires ou des leçons de morale permanentes alors qu’il n’y a rien de concret et de sourcé. Il souhaiterait également avoir des explications détaillées sur des contrats totalement à l’avantage des industriels qui n’ont aucun risque juridique puisque la responsabilité des effets dommageables est transférée aux Etats membres et s’interroge sur l’existence éventuelle de conflits d’intérêts.
Olivier Frot questionne l’intérêt qu’il y a eu de passer par la Commission européenne en laissant de côté les États membres pour agir dans la stratégie de santé et souhaiterait un rapport d’audit d’une autorité indépendante pour l’évaluation de ces contrats et de la bonne performance. Enfin, devant des situations qu’il juge anormales, le juriste estime que le droit est le dernier rempart de la démocratie pour les citoyens.
Retrouvez sa conclusion dans son debriefing proposé en partenariat avec BonSens.org.
Auteur(s): FranceSoir
Source : https://www.francesoir.fr/videos–les–debriefings/olivier–frot
Tweet correspondant à ce billet :
« Un contrat aussi favorable à l’industriel, cela me paraît anormal » Olivier Frothttps://t.co/Xr116veWpm
ITW passionnant et important (publié par @france_soir : je trouve incroyable que ceux qui se disent « journalistes » refusent d’enquêter là-dessus, et même de relayer cet ITW).
— Étienne Chouard (@Etienne_Chouard) September 16, 2021
Facebook indisponible pour cause de censure sur ce sujet (abonnez-vous à ce site pour contourner cette censure et rester informés quand tous les « réseaux sociaux » vous auront trahis.)
[Histoire des crimes commis par les CANAILLES à qui on nous impose de faire CONFIANCE aujourd’hui] Peter C. Gøtzsche : REMÈDES MORTELS ET CRIME ORGANISÉ : comment l’industrie pharmaceutique a corrompu les services de santé (2015, 2019)
Je suis en train de lire une bombe… un gros livre (600 p) qui rappelle en détail (et avec des milliers de preuves !) les crimes révoltants commis (en toute connaissance de cause !) par les gredins qu’on appelle gentiment « Bad pharma » :
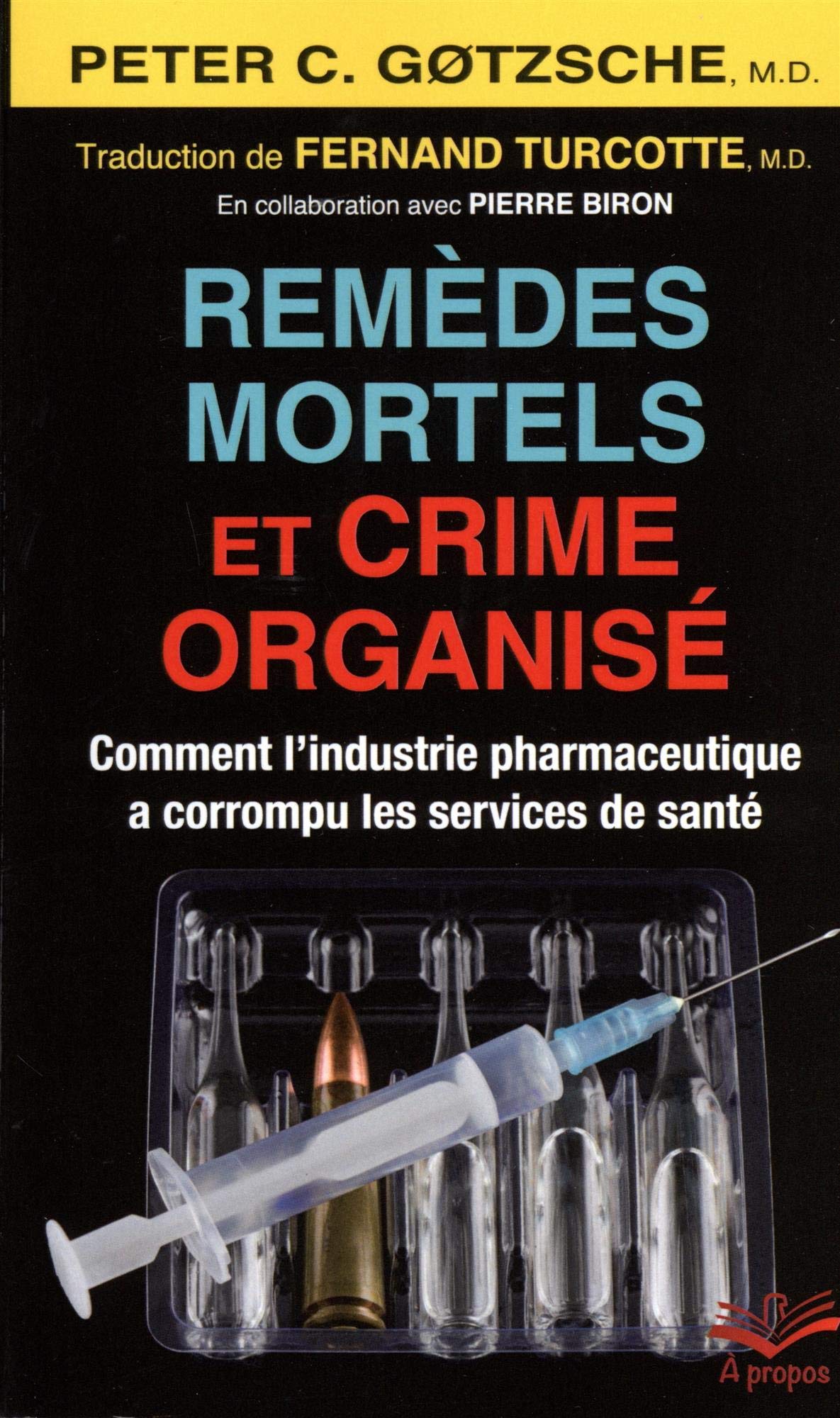
Site de l’éditeur (où vous pouvez consulter un extrait) : https://www.pulaval.com/produit/remedes–mortels–et–crime–organise–comment–l–industrie–pharmaceutique–a–corrompu–les–services–de–sante
Quand je pense que c’est à des bandits endurcis et multirécidivistes comme Pfizer, AstraZeneca ou Johnson&Johnson qu’on nous impose de faire une confiance aveugle à travers la vaccination obligatoire, je trouve ça révoltant : ces entreprises (leurs patrons, leurs actionnaires et leurs mercenaires) ont déjà maintes fois tué froidement leurs cobayes et leurs clients, tout en organisant leur totale impunité, leur scandaleuse irresponsabilité. Ces fripouilles ont corrompu à la fois la science médicale (le savoir publié) et les autorités de santé (les garants publics du savoir le plus fiable) en finançant la formation/information des médecins (les universités, les revues scientifiques, les médecins réputés, la formation continue des praticiens, les sociétés savantes…) et en plaçant leurs créatures corrompues dans toutes les institutions de contrôle (agences, ordres, conseils scientifiques…) ! Tant et si bien que les industriels font aujourd’hui quasiment ce qu’ils veulent pour gagner beaucoup d’argent sans aucun contrôle sérieux.
D’abord, AUCUN traitement ne devrait être obligatoire : le premier principe de l’éthique médicale universelle, partout sur terre, est la nécessité absolue du CONSENTEMENT du patient (voir ici).
Et si une autorité décidait malgré tout de rendre un médicament obligatoire (il faudrait que ce soit forcément validé par référendum), il faudrait absolument, bien sûr, au minimum :
1) que le médicament imposé soit rigoureusement SANS DANGER, conçu, fabriqué et longuement testé par des industriels digne de confiance, selon des protocoles robustes et sous le contrôle d’experts indépendants,
et 2) que, en cas de drame, celui qui a forcé les victimes assume pleinement et personnellement la RESPONSABILITÉ (financière et morale) des dommages (autant que c’est possible, car une indemnité financière même énorme ne compensera jamais une infirmité à vie, ni un décès).
Or c’est rigoureusement le contraire qui se passe !
1) Ceux qui ont conçu les « vaccins » sont des gredins multirécidivistes (ce livre le prouve mille fois) qui ont TOUS — sciemment, volontairement et en connaissance de cause — trompé le public et empoisonné des centaines de milliers de patients pour gagner beaucoup d’argent.
2) Tous les acteurs de l’obligation vaccinale se sont d’avance exonérés de toute responsabilité envers ceux qu’ils forcent aux injections :
. les industriels se sont fait voter des lois interdisant définitivement leur mise en cause en cas de dommage grave (infirmité ou mort),
. les médecins piqueurs font carrément signer aux injectés des décharges de responsabilité (!),
. les journalistes et leurs invités influenceurs ne sont, de toute façon, jamais responsables des conséquences de leurs propagandes, pas plus ici qu’ailleurs,
. les gouvernements ne prévoient quasiment rien pour dédommager les victimes (enfin, rien qui soit à la hauteur des risques réels)
et ils ne mettent en place qu’une pharmacovigilance largement factice (d’abord elle est passive (!), et ensuite, elle est activée par ceux-là mêmes qui ont pratiqué les injections (!) et qui ont donc mécaniquement, forcément, fatalement, un intérêt personnel vital à ce que rien de dramatique ne soit déclaré à la suite de leur geste), comme si personne ne voulait voir vraiment les dangers réels des médicaments,
. et les politiciens eux-mêmes ne sont jamais personnellement responsables de leurs fautes quand elles sont commises dans l’exercice de leurs fonctions (du fait de l’absence d’une vraie constitution)…
Bref, PERSONNE N’EST RESPONSABLE pour des injections expérimentales conçues et fabriquées par des crapules patentées qu’un gouvernement de forbans irresponsable rend OBLIGATOIRES !
Tout ça est absolument choquant.
L’obligation vaccinale est un abus de pouvoir incandescent.
Ce livre démontre une partie importante du raisonnement ci-dessus : les industriels qui conçoivent, produisent et contrôlent les produits qu’on nous injecte de force NE SONT PAS DU TOUT DIGNES DE CONFIANCE.
Comme je l’ai fait pour des milliers de mes livres depuis 2005, j’ai scanné ce livre, le l’ai OCRisé, j’ai relu et corrigé le résultat. J’ai donc un .doc dans lequel je peux chercher par mots-clefs.
Cette enquête de Peter Gøtzsche est un service public. Il faudrait à la fois la rendre disponible gratuitement (il est déjà indisponible — ou hors de prix — chez de nombreux vendeurs) et aider financièrement son auteur (et son éditeur) pour qu’il continue à nous informer avec cette puissance remarquable.
Je vais ici reproduire ses deux avant-propos, son introduction, son plan détaillé, et deux chapitres importants (mais c’est difficile de choisir, tout le livre est important) : un sur les monstrueux crimes de l’industrie pharmaceutique et un autre sur ses énormes bobards .
Je vous recommande chaleureusement ce livre important.
Je propose que nous signalions dans les commentaires de ce billet les éventuels AUTRES livres et documents allant dans le même sens (des preuves manifestes de l’activité criminelle des grands industriels du médicament). L’ensemble servira à documenter/légitimer notre refus solennel de leur faire confiance, et encore moins d’y être forcés.
Je vous fais remarquer que, si nous avions une constitution digne de ce nom — c’est-à-dire avec un vrai RIC en toutes matières, et avec des médias socialisés / non appropriables), nous pourrions intervenir nous-mêmes en politique et nous défendre efficacement contre tous les abus de pouvoir.
Bonne lecture.
Étienne.
Avant-propos par Richard Smith,
Rédacteur en chef du BMJ (British Medical Journal)
La seule mention du nom de Peter Gøtzsche comme orateur dans un congrès ou comme collaborateur cité dans la table des matières d’un périodique suffit à soulever l’enthousiasme d’innombrables personnes. En effet, on peut le comparer au jeune garçon qui voyait bien que l’empereur était nu et qui ne se gênait pas pour le dire. Or, la plupart d’entre nous ne voyons pas la nudité de l’empereur et, dans le cas contraire n’oserions pas en parler. Voilà pourquoi nous avons un si grand besoin de gens comme Peter. Avec lui, pas de compromis ni de dissimulation, mais un franc parler assorti de métaphores colorées. L’insistance de Peter à comparer l’industrie pharmaceutique au crime organisé peut certes en déranger plusieurs, mais renoncer à lire le présent ouvrage pour ce motif, ce serait rater l’occasion de comprendre une réalité importante et de s’en indigner.
Peter conclut son livre en racontant que la Société danoise de rhumatologie lui avait demandé de prononcer une conférence sur le thème La collaboration avec l’industrie pharmaceutique : est-ce si dommageable ? Le titre était à l’origine La collaboration avec l’industrie pharmaceutique. Est-ce dommageable ? Mais la société l’avait trouvé trop fort. Peter commença sa conférence en énumérant des crimes des commanditaires de la réunion. Roche avait grandi grâce à ses ventes illégales d’héroïne. Abbott avait empêché Peter d’avoir accès à des études non publiées qui montraient qu’une pilule pour maigrir était dangereuse. UCB avait elle aussi caché des données tandis que Pfizer avait menti à la FDA (Food and Drug Administration) puis avait été condamnée aux États-Unis à une amende de 2,3 milliards de dollars pour avoir fait la promotion de l’utilisation hors indications de quatre médicaments. Merck, le dernier commanditaire, avait, selon Peter, provoqué le décès de milliers de patients en raison de son comportement malhonnête relativement à un médicament contre l’arthrite. Une fois son introduction complétée, Peter se lança dans une condamnation de l’industrie.
On peut imaginer se trouver à cette rencontre dont les commanditaires bafouillent de colère et dont les organisateurs marinent dans l’embarras. Peter cite un collègue qui lui aurait dit que son approche aurait peut-être détourné des auditeurs dont l’opinion n’était pas encore faite. Mais la plus grande partie de l’auditoire a été captivée et a compris la légitimité des points soulevés par Peter.
De très nombreuses personnes qui ont soutenu avec enthousiasme la mammographie de routine pour prévenir les décès par cancer du sein, peuvent comprendre la grogne des commanditaires – parce qu’ils ont été eux aussi critiqués par Peter qui a fait paraître un livre décrivant ses expériences relatives à la mammographie. Ce qui me semble particulièrement important c’est que Peter faisait partie des quelques rares critiques de la mammographie de routine quand il a commencé ses recherches et qu’en dépit des attaques très intenses dont il a été l’objet, les faits ont fini par lui donner raison.
Il n’avait pas d’opinion arrêtée sur la mammographie quand les autorités du Danemark lui ont demandé de réviser les faits connus mais il a rapidement conclu que les preuves disponibles étaient de piètre qualité. Sa conclusion générale était que la mammographie de routine pourrait bien sauver des vies, cependant beaucoup moins que ne le prétendaient les promoteurs de cet examen, au prix de plusieurs faux positifs, imposant à des femmes des procédures invasives et inquiétantes sans aucun avantage et le surdiagnostic de cancers inoffensifs. Les discussions qui ont suivi à propos de la mammographie de routine ont été amères et pleines d’hostilité mais la perspective de Peter est maintenant devenue ce qu’on pourrait appeler la perspective orthodoxe quant à ce problème. Son livre montre d’une manière détaillée comment des scientifiques ont déformé les faits établis pour mieux soutenir leurs croyances.
Je sais depuis longtemps que la science est pratiquée par des êtres humains qui ne sont pas des robots, ce qui signifie qu’ils restent exposés aux défaillances humaines, mais j’ai été renversé par les propos du livre de Peter sur la mammographie.
Une grande partie du présent ouvrage est également renversante pour des motifs apparentés : on montre comment on peut corrompre la connaissance pour faire avancer certains arguments et comment l’argent, les profits, les emplois et les réputations sont les corrupteurs les plus puissants.
Peter concède que certains médicaments ont procuré de grands avantages. Il le fait dans une phrase : « Mon livre ne concerne pas les avantages bien connus de médicaments comme les succès rencontrés pour traiter les infections, les maladies cardiaques, certains cancers et les déficiences hormonales comme le diabète de type I. » Certains lecteurs trouveront que c’est insuffisant, mais Peter est très explicite pour dire que le présent ouvrage porte sur les échecs du système au complet de la découverte, de la production, du marketing et de la réglementation des médicaments. Ce n’est pas un livre qui porte sur leurs avantages.
Plusieurs lecteurs se demanderont si Peter n’exagère pas en suggérant que les activités de l’industrie pharmaceutique s’apparentent à celles du crime organisé. Les caractéristiques du crime organisé sont définies dans la loi des États-Unis comme le fait de commettre d’une manière répétée certaines transgressions comprenant l’extorsion, la fraude, le viol d’interdits fédéraux sur les drogues, la corruption, le détournement de fonds, l’obstruction de la justice, l’obstruction dans l’application des lois, l’intimidation des témoins et la corruption politique. Peter fournit des preuves, la plupart fort détaillées, pour soutenir son argument que les compagnies pharmaceutiques sont coupables de la plus grande partie de ces crimes.
Et il n’est pas le premier qui compare l’industrie à la mafia ou à la pègre. Il cite un ancien vice-président de Pfizer qui a déclaré :
Il est proprement effrayant de voir les ressemblances de cette industrie avec la pègre. La pègre gagne des quantités d’argent qui sont obscènes, tout comme l’industrie. Les effets secondaires du crime organisé sont des massacres et des assassinats alors que les effets secondaires de l’industrie sont de même nature. La pègre corrompt les politiciens et d’autres, tout comme le fait l’industrie.
L’industrie est certainement à couteaux tirés avec le ministère de la Justice des États-Unis en raison des compagnies qui ont payé des milliards en amendes. Peter décrit en détail les dix plus grandes sociétés, mais il en existe beaucoup d’autres. Il est aussi vrai que ces sociétés ont récidivé sans répit, calculant sans doute qu’il y avait toujours de plantureux profits à récolter en continuant à violer la loi et à payer des amendes. Les amendes peuvent être tenues pour des dépenses « d’affaires » tout comme les coûts du chauffage, de l’éclairage et du loyer.
Bien plus nombreux sont les gens tués par l’industrie que ne le sont ceux qui périssent aux mains de la pègre. En effet, des centaines de milliers de gens sont tués chaque année par les médicaments ordonnancés. D’aucuns pourront penser que c’est inévitable parce que les médicaments sont utilisés pour traiter des maladies qui sont elles-mêmes létales. D’autres objecteront que les avantages des médicaments sont exagérés, souvent en raison de distorsions sérieuses des preuves censées fonder les médicaments, un « crime » qu’on peut raisonnablement imputer à l’industrie.
Le grand médecin William Osier a déjà dit que ce serait bon pour l’humanité mais horrible pour les poissons qu’on jette à la mer tous les médicaments. Il parlait avant que ne survienne la révolution thérapeutique du milieu du XXe siècle ayant donné la pénicilline, d’autres antibiotiques et tant d’autres médicaments efficaces, mais Peter vient tout près de tomber d’accord avec lui en proposant qu’on serait beaucoup mieux sans la plupart des médicaments psychoactifs dont les avantages sont minuscules et les torts considérables, tandis que le volume de leur prescription est colossal.
La plus grande partie du livre de Peter est consacrée à la démonstration du fait que l’industrie pharmaceutique a systématiquement corrompu la connaissance pour exagérer les avantages et minimiser les torts causés par ses médicaments. Comme épidémiologiste doté d’une extraordinaire connaissance en mathématique et d’une passion infatigable pour les détails, Peter est devenu un chef international en critique des études cliniques et se trouve donc sur son terrain de prédilection. Il y retrouve plusieurs autres auteurs, y compris d’anciens chefs de la rédaction du New England Journal of Medicine, pour décrire cette corruption. Il montre aussi comment l’industrie a corrompu des médecins, des universitaires, des périodiques, des organismes de professionnels et de défense des patients, des départements d’universités, des journalistes, des régulateurs et des politiciens. Ce sont là des méthodes de la pègre.
Le livre ne permet ni aux médecins ni aux universitaires d’éviter le blâme. En fait, on pourrait soutenir que les sociétés pharmaceutiques font ce qu’on attend d’elles en maximisant le rendement de leurs actionnaires tandis que médecins et universitaires sont censés avoir une autre motivation. Des lois exigeant des sociétés qu’elles déclarent les paiements faits aux médecins montrent que de grandes proportions de médecins sont redevables à l’industrie pharmaceutique, plusieurs recevant des sommes dans les six chiffres, pour conseiller les sociétés ou prononcer des conférences en leur nom. Il est difficile de ne pas conclure que ces « meneurs d’opinion » sont corrompus. Ils sont les tueurs à gages de l’industrie.
Et, tout comme c’est le cas pour la pègre, malheur à quiconque lance une alerte ou accepte de témoigner contre l’industrie. Peter raconte plusieurs histoires de lanceurs d’alerte qu’on a harcelés alors que le roman de John Le Carré décrivant la brutalité d’une société pharmaceutique devenait un grand succès qu’on a porté à l’écran.
Il n’est pas fantaisiste de comparer l’industrie pharmaceutique à la pègre et la population, en dépit de son enthousiasme pour la consommation de pilules, entretient du scepticisme à l’encontre de l’industrie pharmaceutique. Dans une enquête d’opinion menée au Danemark, le public a placé l’industrie pharmaceutique à l’avant-dernier rang de celles à qui l’on fait confiance, tandis qu’une enquête d’opinion américaine plaçait l’industrie pharmaceutique au bas de l’échelle en compagnie de l’industrie du tabac et des pétrolières. Le médecin et auteur, Ben Goldacre, dans son livre Bad Pharma soulève l’observation que ce que les médecins ont fini par tenir pour « normal » dans leurs relations avec l’industrie pharmaceutique deviendra complètement inacceptable pour la population quand elle en comprendra le fin mot de la signification. En Grande-Bretagne, les médecins pourraient rejoindre les journalistes, les parlementaires et les banquiers dans le déshonneur, pour n’avoir pas su reconnaître la corruption dans laquelle ils se vautrent. Pour le moment, la population fait confiance aux médecins et se méfie des sociétés pharmaceutiques, mais cette confiance pourrait se perdre rapidement.
Le livre de Peter ne porte pas que sur des problèmes. Il propose des solutions dont certaines seront plus facilement appliquées. Il semble très improbable que les sociétés pharmaceutiques soient jamais nationalisées, mais il est probable que toutes les données utilisées pour obtenir l’autorisation de mise sur le marché deviennent disponibles. Il faut rehausser l’indépendance des autorités de réglementation. Certains pays pourraient être tentés d’encourager plus d’évaluation des médicaments par des organismes du secteur public, tandis qu’on assiste à un désir croissant de rendre publiques les relations financières liant les sociétés pharmaceutiques aux médecins, aux organismes de professionnels et de patients ainsi qu’aux périodiques médicaux. Il est certain qu’il faut améliorer la gestion des conflits d’intérêts. Il faudra sans doute restreindre encore plus la commercialisation, tandis que l’opposition à la publicité directe aux consommateurs se renforce.
Les critiques de l’industrie pharmaceutique sont plus nombreux, plus respectables et plus impétueux, mais Peter les dépasse tous en comparant l’industrie au crime organisé. J’espère que personne ne se laissera dissuader de lire le présent ouvrage à cause de l’audace de la comparaison et que la franchise de son message va susciter une réforme convenable.
Richard Smith, M. D. juin 2013
Avant-propos par Drummond Rennie,
Rédacteur en chef du JAMA (Journal of the American Medical Association)
INDIGNATION FONDÉE SUR LA PREUVE
Des centaines de rapports d’études scientifiques et plusieurs ouvrages décrivent déjà comment les sociétés pharmaceutiques pervertissent la méthode scientifique et utilisent leur richesse colossale pour travailler trop souvent à l’encontre de l’intérêt des patients qu’elles prétendent aider. J’ai moi-même participé à cette infamie. Alors qu’est-ce qu’apporte le présent ouvrage qui soit donc neuf et digne de votre attention ?
La réponse est simple : les aptitudes scientifiques exceptionnelles, la recherche, l’intégrité, la vérité et le courage de son auteur. L’expérience de Gøtzsche est sans pareille. Il a travaillé aux ventes pour des sociétés pharmaceutiques, soit comme visiteur bonimentant les médecins sur divers types de médicaments, soit comme gérant de produit. Il est médecin et chercheur doté d’une grande réputation acquise à la tête du centre Cochrane du nord. De sorte que, quand il parle, il fonde ses opinions sur des recherches méticuleuses réparties sur des décennies et publiées dans des périodiques soumis à la révision des manuscrits par les pairs. Il comprend très bien les statistiques du préjugé et les techniques utilisées pour analyser les rapports d’études cliniques. Il a été à l’avant-garde de l’élaboration des révisions systématiques et de la méta-analyse des rapports d’études cliniques, pour en extraire à l’aide de critères stricts, l’efficacité réelle des médicaments et des tests. Sa persistance est souvent irritante, mais elle est toujours mue par la preuve.
Donc, j’ai confiance en Gøtzsche. Ma confiance est fondée sur une preuve solide et ma propre expérience de plusieurs décennies à avoir dû me débattre avec ce qui résulte de l’influence de l’industrie pharmaceutique sur mes collègues en recherche clinique, et sur la population. De plus, je fais confiance à Gøtzsche parce que je sais qu’il a raison quand il commente des événements que je connais d’une manière indépendante.
Le dernier motif de la confiance que j’accorde au récit de Gøtzsche est lié à mon expérience de chef de la rédaction d’un très grand périodique médical. Les chefs de rédaction sont les premiers à prendre connaissance d’un rapport écrit provenant d’un établissement de recherche. Les chefs de rédaction et leurs réviseurs identifient les problèmes de préjugés dans les articles proposés à leur périodique et c’est aux chefs de rédaction qu’on achemine les plaintes et les allégations.
J’ai écrit, puis répété, des éditoriaux indignés décrivant les comportements incompatibles avec l’éthique de chercheurs soutenus par des intérêts commerciaux et leurs commanditaires. Au moins trois autres rédacteurs en chef que je connais bien, les Drs Jérôme Kassirer et Marcia Angell (New England Journal of Medicine) et Richard Smith (British Medical Journal) qui ont écrit des ouvrages dans lesquels ils ont fait état de leur consternation face à l’ampleur du problème. D’autres rédacteurs en chef, comme Fiona Godlee du British Medical Journal, ont écrit d’une manière éloquente au sujet de l’influence corruptrice de l’argent et de la manière avec laquelle il détourne le traitement des patients et augmente les coûts.
Je ne prétends pas endosser tous les faits décrits par Gøtzsche – ceci étant un avant-propos et non une vérification – mais le tableau général qu’il trace n’est que trop familier. Bien que Gøtzsche puisse paraître exagérer, mes propres expériences décevantes et celles d’autres rédacteurs en chef et de chercheurs que je connais personnellement me disent qu’il a raison.
Dans un cours que je donnais à un auditoire de juges, je remarquais que les chercheurs cliniciens et les membres de la profession juridique utilisaient le même mot, « essai », pour désigner deux procédés différents, l’un juridique et l’autre scientifique. Parlant au nom de ma profession, je me devais de reconnaître que les essais juridiques étaient réalisés d’une manière qui était plus juste et mieux fondée sur l’éthique que les essais scientifiques. (Gøtzsche cite cet exemple à la page 83.)
Gøtzsche fait des propositions et appelle une révolution. À mon avis, rien ne changera tant qu’on n’aura pas complètement isolé l’évaluation de la performance des études du financement des mêmes études. Nous fondons nos traitements sur les résultats d’études cliniques de sorte que ces résultats deviennent des questions de vie ou de mort. Les patients qui acceptent d’être intégrés dans les études s’attendent à ce que leur sacrifice bénéficie à l’humanité. Ce qu’ils ne peuvent deviner, c’est que leurs résultats soient cachés puis manipulés comme autant de secrets commerciaux. Ces résultats sont des biens collectifs et ils devraient être payés par l’État, utilisant les taxes payées par l’industrie, puis rendus disponibles pour tous. Dans le contexte actuel, on se trouve aux États-Unis dans la situation absurde où les sociétés pharmaceutiques paient l’agence de réglementation, la FDA, pour faire l’évaluation de leurs projets. Faut-il se surprendre que l’agence ait été investie puis piratée par l’industrie qu’elle est censée réglementer ?
Révolution ? Gøtzsche a raison. Nous nous retrouvons dans ce marasme en raison d’erreurs innombrables du passé et il en décrit plusieurs dans l’inventaire détaillé qu’il dresse. Lequel comprend le défaut des chercheurs cliniciens, de leurs institutions, des rédacteurs en chef des périodiques publiant leurs découvertes de comprendre à quel point ils ont été piégés par les praticiens du marketing qui les payaient. Je crois qu’il faudra une révolution pour se débarrasser des décennies pendant lesquelles l’industrie a protégé ses intérêts.
J’espère qu’on lira ce livre et qu’on tirera ses propres conclusions. Quelle est la mienne ? Quand Gøtzsche se scandalise du comportement de l’université et de l’industrie, il a raison d’être indigné. Ce qui est indispensable, c’est une indignation encore plus forte fondée sur les preuves à la manière de Gøtzsche.
Drummond Rennie, M. D. juin 2013
Chapitre 1 Introduction
par Peter C. Gøtzsche
Les grandes épidémies de maladies infectieuses et parasitaires qui ont fait tant de morts par le passé sont maintenant sous contrôle dans la plupart des pays. Nous avons appris comment prévenir et traiter le SIDA, le choléra, la malaria, la rougeole, la peste et la tuberculose et nous avons éradiqué la variole. La mortalité causée par le SIDA et la malaria est encore très élevée, mais ce n’est pas parce qu’on ne sait pas comment lui faire face. Il faut mettre en cause les inégalités de revenu et les coûts excessifs des médicaments capables de sauver la vie dans les pays à petits revenus.
Malheureusement, on se trouve maintenant confrontés à des épidémies provoquées par l’homme, soit le tabagisme et les médicaments ordonnancés, deux causes extrêmement mortelles. Aux Etats-Unis et en Europe, les médicaments constituent la troisième cause de mortalité après la maladie cardiaque et le cancer.
Je vais expliquer dans ce livre pourquoi il en est ainsi et ce qu’on peut faire pour enrayer cette tragédie. Si la mortalité provoquée par les médicaments avait été une maladie contagieuse, ou bien une maladie cardiaque ou un cancer provoqué par la pollution de l’environnement, il se serait trouvé d’inombrables groupes militants pour ramasser des fonds et susciter des interventions politiques de grande portée pour la combattre. J’ai du mal à comprendre pourquoi – quand il s’agit de médicaments, les gens ne font rien.
Les industries du tabac et du médicament ont beaucoup de traits communs. Un dédain moralement scandaleux au regard de la vie humaine, cela semble leur règle. Les compagnies de tabac sont très fières d’avoir augmenté leurs ventes dans les pays à faibles et moyens revenus. C’est sans un soupçon d’ironie ou de honte que la direction d’Impérial Tobacco a rapporté aux investisseurs en 2011 que la société britannique avait remporté une palme d’or selon un index de responsabilité corporative1. Les compagnies de tabac profitent « de nombreuses occasions pour faire croître leurs affaires » ce que le Lancet a décrit comme « la vente, l’asservissement à l’addiction et la mise à mort, très certainement le modèle d’affaires le plus cruel et corrompu que les humains étaient capables d’inventer1 ».
Les dirigeants de l’industrie du tabac savent qu’ils colportent la mort tout comme les dirigeants de l’industrie pharmaceutique. Il n’est plus possible de cacher le fait que le tabac est un tueur majeur alors que l’industrie pharmaceutique a réussi de manière surprenante à cacher que ses médicaments sont aussi des tueurs de premier ordre. Je me propose de décrire ici comment les sociétés pharmaceutiques ont caché, de manière délibérée, les torts mortels de leurs médicaments en recourant à des manœuvres frauduleuses tant en ce qui a trait à la recherche qu’à la mise en marché et à des dénis très énergiques quand elles se sont trouvées confrontées aux faits. Tout comme les dirigeants de l’industrie du tabac avaient tous affirmé, en 1994, au cours d’une audition du Congrès des États-Unis, que la nicotine ne provoquait pas d’addiction alors qu’ils savaient depuis des décennies que cela était un mensonge2. Philip Morris, le géant américain du tabac a mis sur pied une société de recherche qui a documenté les dangers de la fumée secondaire ; même si plus de 800 rapports scientifiques ont été produits, pas un seul n’a été publié2.
Les deux industries emploient des tueurs à gages. Quand une recherche rigoureuse a montré qu’un produit est dangereux, une foule d’études de piètre qualité sont produites pour affirmer le contraire, ce qui confond la population parce que – comme en attesteront les journalistes -«les chercheurs ne sont pas d’accord entre eux ». Cette industrie du doute est très efficace pour distraire les gens et entretenir l’ignorance des torts. L’industrie achète du temps pendant que les gens continuent de périr.
C’est de la corruption. La corruption a plusieurs significations et celle que je comprends est définie, dans mon dictionnaire, comme de la pourriture morale. Une autre signification est la subornation, qui peut signifier le paiement secret, habituellement en argent comptant, pour un service qui ne serait pas rendu autrement, ou du moins, pas aussi rapidement. Toutefois, comme on le verra, la corruption dans les services de santé a plusieurs visages, comprenant le paiement pour ce qui semble être une noble activité tout en n’étant rien d’autre qu’un prétexte pour donner de l’argent à une partie importante de la profession médicale.
Les personnages du roman d’Aldous Huxley, Brave New World, datant de 1932, peuvent consommer des pilules Soma chaque jour pour prendre le contrôle de leur vie et chasser les pensées inquiétantes. Aux États-Unis, les commerciaux télévisés ne font pas autre chose en incitant le public à faire exactement pareil. Ces commerciaux décrivent des personnages malheureux qui reprennent le dessus et redeviennent heureux dès qu’ils ont consommé une pilule3. Nous avons déjà surpassé les imaginations les plus délirantes d’Huxley et la consommation de médicaments continue d’augmenter. Au Danemark, par exemple, nous consommons tellement de médicaments, que chaque citoyen, qu’il soit malade ou bien portant, peut se trouver sous traitement avec 1,4 dose quotidienne pour adulte, du berceau jusqu’à son décès. Bien que plusieurs médicaments soient capables de sauver la vie, on pourrait penser qu’il est dommageable de médicamenter autant nos sociétés et j’apporterai des preuves démontrant que c’est bien ce qui se produit.
Le motif principal expliquant qu’on consomme autant de médicaments est que les sociétés pharmaceutiques ne vendent pas des médicaments mais bien des mensonges au sujet des médicaments. Des mensonges éhontés qui – dans tous les cas que j’ai étudiés – ont continué même après qu’on en eut fait la preuve. C’est ce qui rend les médicaments différents de toute autre expérience de la vie courante. Quand on souhaite acheter une voiture ou une maison, on peut juger par soi-même s’il s’agit d’un bon ou d’un mauvais achat. Mais quand on se fait offrir un médicament, on ne dispose pas de cette latitude. Presque tout ce qu’on sait d’un médicament se limite à ce que les sociétés ont bien voulu dire au public et à ses médecins. Peut-être devrais-je définir ce que j’entends par mensonge. Un mensonge est un énoncé qui n’est pas vrai, mais une personne qui raconte un mensonge n’est pas nécessairement un menteur. Les vendeurs de médicaments racontent bien des mensonges, mais ils ont souvent été trompés par leurs supérieurs dans la société pharmaceutique qui leur ont délibérément caché la vérité (ce qui en fait des menteurs au sens où je l’entends). Dans son magnifique petit livre intitulé On Bullshit, le moraliste Harry Frankfurt dit qu’une des caractéristiques saillantes de notre culture est qu’il y a un grand nombre de foutaises, ce qu’il tient pour se situer juste en deçà du mensonge.
Mon livre ne porte pas sur les avantages bien connus des médicaments, comme nos triomphes dans le traitement des infections, des maladies cardiaques, certains cancers et les insuffisances hormonales comme le diabète de type 1. Le livre traite de la faillite du système, provoquée par une criminalité généralisée, la corruption et une réglementation impuissante au sujet des médicaments, qui requiert des réformes radicales. Certains lecteurs trouveront mon livre partial et polémique, mais je ne vois pas l’intérêt de décrire ce qui fonctionne bien dans un système qui échappe complètement à tout contrôle social. Quand un criminologue entreprend une étude d’agresseurs, personne n’attend un rapport « équilibré » faisant grand état du fait que bien des agresseurs sont de bons pères de famille4.
Si on ne pense pas que le système est sans contrôle, qu’on m’envoie un courriel expliquant pourquoi les médicaments sont la troisième cause de décès dans la partie du monde qui consomme le plus de médicaments. Si une épidémie aussi colossalement létale avait été causée par une nouvelle bactérie ou un virus, ne fût-ce même qu’une amorce d’épidémie, on aurait fait tout ce qui est possible pour en prendre le contrôle. Ce qui est tragique, c’est qu’on pourrait facilement contrôler l’épidémie médicamenteuse qui est en cours, mais les politiciens qui détiennent présentement le pouvoir de faire les changements ne font pratiquement rien. Quand ils agissent, c’est habituellement pour empirer la situation, car ils font tellement l’objet de pressions par l’industrie pharmaceutique qu’ils en sont venus à en croire tous les mythes, que je vais démonter dans chaque chapitre de ce livre.
Le principal problème de notre système de soins de santé est que les incitatifs financiers qui le propulsent entravent sérieusement l’utilisation rationnelle, économique et sécuritaire des médicaments. L’industrie pharmaceutique tire sa prospérité de cet état de fait et pratique un contrôle très serré de l’information. La documentation scientifique sur les médicaments est systématiquement dénaturée par des études mal ficelées dont l’analyse des données est incorrecte, la publication des résultats et des données primaires est sélective, les résultats défavorables supprimés et la rédaction assurée par des rédacteurs anonymes. Ces derniers rédigent les manuscrits contre honoraires sans qu’on ne révèle leur identité dans les publications, lesquelles sont attribuées à des notables de la profession médicale, des « auteurs » qui n’ont pas, sinon peu, contribué au manuscrit. C’est cette inconduite scientifique qui fait vendre les médicaments.
Par comparaison avec les autres industries, l’industrie pharmaceutique est le plus grand fraudeur du gouvernement fédéral des Etats-Unis en vertu de la loi sur les fausses réclamations5. La population semble savoir ce que l’industrie pharmaceutique fait. Dans une enquête d’opinion demandant à 5 000 Danois de classer 51 industries selon la confiance qu’ils leur accordaient, l’industrie pharmaceutique s’est retrouvée à l’avant-dernier rang, immédiatement devant les entreprises de réparation des automobiles6. Une enquête américaine a aussi placé l’industrie au dernier rang avec l’industrie du tabac et celle du pétrole7. Dans une autre enquête, 79 % des citoyens américains estimaient que l’industrie pharmaceutique faisait du bon travail en 1997, proportion qui était tombée à 21 % en 20058, un déclin extraordinairement rapide de la confiance populaire.
Compte tenu de cet arrière-plan, il peut sembler contradictoire que les patients aient si grande confiance dans les médicaments que leur médecin leur prescrit. Mais je suis persuadé que le motif expliquant cette confiance dans leurs médicaments est lié à leur transfert de la confiance qu’ils ont en leur médecin aux médicaments qu’il leur prescrit. Les patients ne comprennent pas que, bien que leurs médecins en connaissent beaucoup au sujet des maladies, de la physiologie humaine et de la psychologie, ils ne savent pas grand-chose sur les médicaments autrement que ce qui a été soigneusement concocté et trafiqué par l’industrie pharmaceutique. De plus, ils ne savent pas que leurs médecins peuvent avoir intérêt à choisir certains médicaments ni que bien des crimes commis par l’industrie pharmaceutique ne pourraient survenir si les médecins ne s’en rendaient pas complices.
Il est difficile de changer un système et il n’est pas surprenant que des gens qui ont à vivre avec un système déréglé tentent d’en tirer le meilleur parti possible, même quand il arrive souvent qu’il en résulte que des gens bien intentionnés finissent par faire des choses condamnables. Toutefois, bien des cadres supérieurs de l’industrie pharmaceutique n’ont pas cette excuse puisqu’ils ont délibérément menti aux médecins, aux patients, aux régulateurs et aux magistrats.
Je dédie ce livre aux nombreuses personnes honnêtes qui travaillent dans l’industrie pharmaceutique et qui sont tout autant horrifiées que moi par les crimes commis à répétition par leurs supérieurs et par les conséquences désastreuses pour les patients et l’économie de la nation. Certains m’ont déjà dit qu’ils souhaiteraient que leurs patrons soient emprisonnés puisque seule cette menace pourrait les dissuader de continuer à commettre des crimes.
[Lire la suite dans le livre : chacune ses 600 pages est au vitriol ! ÉC]
Plan du livre :
Peter C. Gøtzsche : Remèdes mortels et crime organisé
Table des matières
Avant-propos par Richard Smith (Rédacteur en chef du BMJ, British Medical Journal)
Avant-propos par Drummond Rennie (Rédacteur en chef du JAMA, Journal of the American Medical Association)
1 – Introduction
2 – Confessions d’un initié
DÉCÈS CAUSÉS PAR L’ASTHME PROVOQUÉS PAR LES AÉROSOLS CONTRE L’ASTHME
MARKETING VÉREUX ET RECHERCHE
3 – Le crime organisé, modèle d’affaires des grosses compagnies pharmaceutiques
LE PLUS GROS REVENDEUR DE STUPÉFIANTS, HOFFMAN-LA ROCHE
LE TEMPLE DE LA HONTE POUR LES GRANDES PHARMACEUTIQUES
Pfizer accepte de payer 2,3 milliards de dollars en 2009
Novartis accepte de payer 423 millions de dollars en 2010
Sanofi-Aventis doit payer + de 95 millions de dollars pour régler une accusation de fraude en 2009
GlaxoSmithKline doit payer 3 milliards de dollars en 2011
AstraZeneca doit payer 520 millions de dollars en 2010 pour régler une affaire de fraude
Roche persuade des gouvernements de faire des réserves de Tamiflu
Johnson & Johnson contrainte de payer une amende de 1,1 milliard de dollars en 2012
Merck doit payer 670 millions de dollars pour avoir fraudé Medicaid en 2007
Eli Lilly doit payer plus de 1,4 milliard de dollars pour du marketing illégal en 2009
Abbott doit payer 1,5 milliard de dollars pour avoir fraudé Medicaid en 2012
LES CRIMES SONT RÉPÉTITIFS
C’EST DU CRIME ORGANISÉ
4 – Très peu de patients tirent avantage des médicaments qu’ils consomment
5 – Les essais cliniques, la rupture du contrat social avec les patients
6 – Les conflits d’intérêts dans les périodiques médicaux
7 – L’influence corruptrice de l’argent facile
8 – À quoi donc s’affairent les milliers de médecins à la solde de l’industrie ?
ÉTUDES DE FAMILIARISATION
LOUER UN MENEUR D’OPINION POUR « CONSEILLER »
LOUER UN MENEUR D’OPINION POUR « ÉDUQUER »
9 – Vendre sous pression
LES ÉTUDES CLINIQUES SONT DU MARKETING DÉGUISÉ
LA RÉDACTION PAR DES RÉDACTEURS ANONYMES (NÈGRES)
LA MACHINE DU MARKETING
VENDRE SOUS PRESSION AD NAUSEAM
LES MÉDICAMENTS TRÈS COÛTEUX
LES EXAGÉRATIONS AU REGARD DE L’HYPERTENSION
LES ORGANISMES DE PATIENTS
LE NOVOSEVEN POUR LES SOLDATS OUI SAIGNENT
10 – L’impuissance de la régulation des médicaments
LES CONFLITS D’INTÉRÊTS DANS LES AGENCES DU MÉDICAMENT (organismes gouvernementaux)
LA CORRUPTION DANS LES AGENCES DU MÉDICAMENT
L’INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DES POLITICIENS
LA RÉGULATION DES MÉDICAMENTS EST FONDÉE SUR LA CONFIANCE
L’ÉVALUATION INADÉQUATE DES NOUVEAUX MÉDICAMENTS
Deux seules études contrôlées avec placebo montrant un effet ne suffisent pas
Les études cliniques dans les pays largement corrompus
Un effet sur un résultat de substitution ne suffit pas
L’absence de données adéquates sur la sécurité n’est pas acceptable
TROP D’AVERTISSEMENTS ET TROP DE MÉDICAMENTS
Les statines
Les avertissements sont de fausses solutions
On en sait bien peu au sujet de la polypharmacie
11 – L’accès public aux données des agences du médicament
NOTRE PERCÉE À L’AGENCE EUROPÉENNE DU MÉDICAMENT (EMA) EN 2010
L’ACCÈS AUX DONNÉES DANS LES AUTRES AGENCES DU MÉDICAMENT
DES PILULES AMAIGRISSANTES MORTELLES
12 – Le Neurontin, un médicament pour l’épilepsie utile pour traiter n’importe quoi
13 – Merck, où les patients meurent en premier
14 – L’étude frauduleuse du celecoxib et autres mensonges
LE MARKETING FAIT DU TORT
15 – Substituer des médicaments coûteux aux remèdes moins chers chez les mêmes patients
NOVO NORDISK FAIT PASSER LES PATIENTS À L’INSULINE QUI COÛTE CHER
ASTRAZENECA FAIT PASSER DES PATIENTS À LA COÛTEUSE OMÉPRAZOLE
16 – Le glucose sanguin était correct, mais les patients sont morts
NOVO NORDISK TENTE D’INTIMIDER UN PÉRIODIQUE SCIENTIFIQUE
17 – La psychiatrie, paradis de l’industrie pharmaceutique
SOMMES-NOUS TOUS FOUS OU QUOI ?
LES PSYCHIATRES COMME COLPORTEURS DE MÉDICAMENTS
LE CANULAR DU DÉSÉQUILIBRE CHIMIQUE
LE DÉPISTAGE DES MALADIES PSYCHIATRIQUES
LES PILULES DU MALHEUR
PROZAC, UN ABOMINABLE MÉDICAMENT D’ELI LILLY TRANSFORMÉ EN VEDETTE
L’EXERCICE EST UNE BONNE INTERVENTION
D’AUTRES MENSONGES AU SUJET DES PILULES DU BONHEUR
18 – Inciter les enfants au suicide avec des pilules du bonheur
ÉTUDE 329 DE GLAXO
LE CAMOUFLAGE DES SUICIDES ET DES TENTATIVES DE SUICIDE DANS LES ÉTUDES CLINIQUES
LE RAJEUNISSEMENT DU CITALOPRAM PAR LUNDBECK
LES MÉDICAMENTS ANTIPSYCHOTIQUES
LE ZYPREXA, UN AUTRE MÉDICAMENT HORRIBLE D’ELI LILLY TRANSFORMÉ EN GRAND SUCCÈS
POUR EN FINIR AVEC LES MÉDICAMENTS PSYCHOTROPES
19 – Intimidation, menaces et violence pour protéger les ventes
Thalidomide
Autres cas
20 – Démolir les mythes de l’industrie
Mythe 1 : Les médicaments sont dispendieux en raison des coûts élevés de leur découverte et de leur mise au point
Mythe 2 : Si l’on n’utilise pas les médicaments coûteux, l’innovation va se tarir
Mythe 3 : Les économies sont plus élevées que les coûts des médicaments dispendieux
Mythe 4 : Les percées proviennent de la recherche financée par l’industrie
Mythe 5 : Les compagnies pharmaceutiques se font concurrence dans un marché libre
Mythe 6 : Les partenariats public-industrie sont avantageux pour les patients
Mythe 7 : Les études de médicaments ont pour but d’améliorer le traitement des patients
Mythe 8 : Nous avons besoin de plusieurs médicaments d’un même type parce la réponse des patients est variable
Mythe 9 : Ne pas utiliser les médicaments génériques parce que leur puissance varie
Mythe 10 : L’industrie paie la formation médicale continue parce que les fonds publics ne le font pas
21 – La faillite générale du système commande une révolution
NOS MÉDICAMENTS NOUS TUENT
DE QUEL MÉDICAMENT A‑T‑ON VRAIMENT BESOIN ET À QUEL PRIX ?
LE MODÈLE À BUTS LUCRATIFS EST LE MAUVAIS MODÈLE
LES ÉTUDES CLINIQUES
LES AGENCES DE RÉGULATION DES MÉDICAMENTS
Les résultats de substitution ne devraient jamais être acceptés
Des populations de patients, des comparateurs et des résultats pertinents
La sécurité
Toutes les données cliniques doivent être accessibles au public
Les conflits d’intérêts
L’étiquetage des médicaments
LES FORMULAIRES DE MÉDICAMENTS ET LES COMITÉS DE CONSIGNES DE PRATIQUE
LE MARKETING DES MÉDICAMENTS
LES MÉDECINS ET LEURS ORGANISMES
Les subventions non éducatives avec restrictions
LES PATIENTS ET LEURS ORGANISMES
LES PÉRIODIQUES MÉDICAUX
LES JOURNALISTES
22 – Un dernier éclat de rire aux dépens de Big Pharma
L’ARGENT N’EMPESTE PAS
L’INVENTION DES MALADIES
Notes (plus de 1 300 preuves sourcées)
À propos de l’auteur
Chapitre 3 Le crime organisé, modèle d’affaires des grosses compagnies pharmaceutiques
Les compagnies pharmaceutiques ne parlent jamais des bienfaits ni des dangers de leurs médicaments, mais plutôt de leur efficacité et de leur innocuité. Les mots créent ce qu’ils décrivent, et la sémantique privilégiée est séduisante. Cela porte à croire que ce ne peut être que bénéfique de prendre des médicaments, parce qu’ils sont à la fois efficaces et sans danger. Les patients et les médecins font aussi habituellement confiance à l’efficacité et à l’innocuité des médicaments pour une autre raison, en pensant qu’ils ont été soigneusement examinés par les agences de réglementation des médicaments, à l’aide des critères les plus exigeants, avant d’êtres autorisés à la mise en marché.
Cela se passe en fait à l’inverse. Si on les compare à l’eau et à la nourriture, qui sont non seulement inoffensives mais constituent des biens dont on a besoin pour survivre, les médicaments ne sont habituellement ni efficaces ni sécuritaires. Paracelse a déclaré il y a 500 ans que tous les médicaments sont des poisons et que seule la dose différencie un poison d’un remède. Les médicaments font toujours des dégâts. Si ce n’était pas le cas, ils seraient inertes et donc incapables d’apporter un bienfait quelconque. Il est donc essentiel de déterminer la dose qui cause plus de bien que de mal à la plupart des patients pour tous les médicaments. Même lorsqu’on y parvient, la plupart des patients ne tireront aucun avantage des médicaments qu’ils prennent (voir le chapitre 4).
Bien qu’il soit assez évident que les médicaments peuvent tuer, c’est une réalité souvent escamotée, aussi bien par les patients que les médecins. Les gens font tellement confiance à leurs médicaments que le médecin canadien Sir William Osier (1849−1919) a écrit que « le désir de prendre un médicament est peut-être ce qui distingue le plus les hommes des animaux1 ». La toxine botulinique, une neurotoxine sécrétée par la bactérie Clostridium botulinum, constitue un exemple particulièrement étonnant. C’est l’un des plus violents poisons du monde naturel, une dose aussi petite que 50 ng a tué la moitié des singes d’une étude de toxicité (ce qui signifie qu’on peut tuer 10 millions de singes avec 1 gramme de cette substance). Je me demande bien qui avait besoin de cette information au point de tuer nos proches parents du règne animal pour l’obtenir. A quoi sert cet incroyable médicament meurtrier ? À traiter les rides entre les sourcils ! Celles-ci apparaissent avec l’âge, mais il faut faire attention de ne pas être trop vieux ni d’avoir trop de tremblements au moment d’injecter la toxine, car elle peut être absorbée par les muqueuses des yeux, ce qui aurait pour effet de causer la mort. L’encart contenu dans l’emballage avertit d’ailleurs que des décès sont survenus. Est-ce que cela vaut vraiment la peine de courir le risque de mourir, aussi petit soit-il, seulement parce qu’on a des rides ? D’autres questions sont soulevées : « Le médicament peut-il être utilisé à des fins suicidaires ou meurtrières ? Pourquoi a‑t‑il été approuvé ? »
Le fait que les médicaments soient dangereux et devraient être utilisés avec précaution signifie que les normes d’éthique des ceux qui s’occupent de la recherche et de la commercialisation pharmaceutiques devraient être très élevées. Je me suis entretenu avec plusieurs acteurs de l’industrie pharmaceutique pour découvrir ce que les compagnies pensent d’elles-mêmes, et les réponses varient de très positives, en provenance de ceux qui étaient fiers des études cliniques qu’ils avaient effectuées, à très négatives. Il est peut-être plus intéressant d’observer l’impression que les compagnies pharmaceutiques veulent projeter sur le public, et de comparer cela avec ce qu’elles font réellement. La Pharmaceutical Research and Manufacturera of America (PhRMA) prétend que ses membres sont « engagés à obéir aux normes d’éthique les plus rigoureuses, ainsi qu’à toutes les exigences légales2 ». Son propre Code sur les interactions avec les professionnels de la santé (Code on Interactions with Healthcare Professionals) déclare3 :
Notre mission d’aider les patients repose essentiellement sur des relations éthiques avec les professionnels de la santé Une part importante du succès de cette mission consiste à s’assurer que les professionnels de la santé puissent compter sur les informations les plus récentes et les plus valides disponibles à propos des médicaments d’ordonnance.
Allons‑y d’une autre citation. On trouve le texte suivant sous la rubrique OBJECTIF ENGAGEMENT HONNÊTETÉ : « Notre objectif est d’être le producteur de biens de consommation le plus populaire, respecté et socialement responsable au monde4. » Comme on le verra sous peu, les actions de l’industrie pharmaceutique ont très peu à voir avec l’honnêteté, le respect, et la responsabilité sociale. Comment peuvent-ils donc écrire tout cela à propos d’eux-mêmes ? En fait, ce n’est pas eux qui ont dit cela. Ils auraient pu, mais la citation provient d’une publicité de Philip Morris dans un journal où l’on peut admirer le portrait d’une jeune femme souriante dont la beauté ne tardera certes pas à se faner si elle fume.
Je dis cela pour illustrer le fait que même l’industrie la plus meurtrière de la planète ne peut résister à la tentation de répandre des bobards tout en augmentant la consommation totale de tabac grâce à une commercialisation ciblée directement sur les adolescents des pays en développement qui n’ont pas encore commencé à fumer. Cette commercialisation fait plus que compenser le déclin du tabagisme dans les pays développés. En quoi est-ce socialement responsable de tuer délibérément tous les ans des millions de gens qui n’avaient pas besoin du produit au départ ? Ceux qui ont essayé de fumer une cigarette savent de quoi je parle. À 15 ans, j’ai réussi à fumer la moitié d’une cigarette avant de devenir tellement étourdi que j’ai vomi, pour ensuite quitter l’école et aller directement au lit, aussi pâle que mes draps. Ma mère s’est demandée quelle terrible maladie m’avait frappé aussi durement, et elle me confia plus tard avoir trouvé la moitié d’une cigarette dans ma poche de chemise.
L’écart entre ce que proclame l’industrie pharmaceutique sur « les normes d’éthique les plus rigoureuses », « le respect de toutes les exigences légales et « les informations les plus valides sur les médicaments d’ordonnance » et la réalité de la conduite des grandes pharmaceutiques est aussi très important. L’image que les principaux dirigeants ont d’eux-mêmes – ou encore l’impression qu’ils tentent de donner à propos de leurs activités – n’est même pas partagée par leurs propres employés. Un sondage interne de 2001 effectué auprès des employés de Pfizer, dont la consultation n’est pas accessible au public, montrait que 30 % environ n’étaient pas d’accord avec l’énoncé « « La haute direction fait preuve d’un comportement éthique et honnête5. »
En 2012, la compagnie Pfizer a accepté de payer 60 millions de dollars aux États-Unis pour régler à l’amiable une enquête fédérale sur une affaire de pots-de-vin à l’étranger. Pfizer était accusée d’avoir corrompu non seulement des médecins, mais aussi des administrateurs et des législateurs dans plusieurs pays d’Europe et d’Asie6. Les enquêteurs ont affirmé que des divisions de Pfizer avaient tenté de cacher les pots-de-vin en décrivant les paiements comme des dépenses légitimes dans la comptabilité ; de la formation, des frais de transport ou de divertissement, par exemple. D’après les documents du procès, la compagnie a effectué des virements mensuels pour ce qu’elle a décrit comme « des services de consultant » à un médecin en Croatie qui a contribué à décider quels médicaments le gouvernement autoriserait pour la vente et le remboursement. Pfizer n’a pas nié ni admis les allégations, ce qui est routinier lorsque les compagnies pharmaceutiques règlent à l’amiable des accusations de fraude.
LE PLUS GROS REVENDEUR DE STUPÉFIANTS, HOFFMAN-LA ROCHE
Les 10 plus grandes compagnies pharmaceutiques7 sont toutes signataires du code US PhRMA, à l’exception de Hoffman-La Roche, de Suisse3, qui était le plus important fraudeur corporatif au monde dans les années 1990 selon un classement de 1999 répertoriant toutes les industries, y compris les banques et l’industrie pétrolière8. Des hauts dirigeants de Roche (logo d’Hoffmann-La Roche) menaient un cartel qui, d’après la division antitrust du ministère de la Justice des États-Unis, était le complot criminel antitrust le plus envahissant et le plus néfaste jamais découvert9. Des membres de la haute direction de certaines des plus grandes compagnies pharmaceutiques du monde, d’Europe et d’Asie surtout, se rencontraient secrètement dans des suites de grands hôtels et lors de conférences. Travaillant de concert dans une coalition effrontément appelée Vitamins Inc., ils se sont partagé les marchés mondiaux en orchestrant soigneusement des augmentations de prix, escroquant du coup certaines des plus grandes compagnies d’alimentation au monde. À elle seule, Roche a eu des revenus de 3,3 milliards de dollars aux États-Unis pour la durée du complot et, pendant ce temps, les conspirateurs ont graduellement augmenté le prix des vitamines brutes de façon subtile pour ne pas attirer l’attention ; ils ont aussi truqué le processus des appels d’offres9.
Le ministère de la justice a accusé Kuno Sommer, ancien directeur du marketing mondial de la division vitamines et produits de chimie fine de Hoffman-La Roche, d’avoir participé au cartel des vitamines et d’avoir menti aux enquêteurs du ministère en 1997 pour tenter de cacher le complot10. Sommer a plaidé coupable et écopé d’une peine de quatre mois de prison. Suivant l’effondrement du complot, ceux qui étaient impliqués ont accepté de payer presque 1 milliard de dollars pour régler les accusations antitrust fédérales, et presque tous les gros fabricants de vitamines du monde étaient à un cheveu d’accepter de payer une somme additionnelle de 1 milliard de dollars. Roche accepta de payer 500 millions de dollars, l’équivalent d’un an environ du revenu de ses ventes de vitamines aux États-Unis, et deux directeurs ont reçu des sentences de prison de quelques mois. Du côté de l’Europe, la Commission européenne imposa des amendes à quelques-unes des plus grandes compagnies pharmaceutiques du monde, incluant Roche, pour la somme record de 523 millions de livres sterling en 200111. Il est surprenant que le cartel ait existé aussi longtemps étant donné qu’un initié de Roche avait déjà sonné l’alarme en 1973, ce dont avait pris acte la Commission européenne (voir le chapitre 19).
Entre les deux guerres mondiales, Roche a fourni de la morphine au monde interlope. D’autres compagnies pharmaceutiques du Royaume-Uni, d’Allemagne, du Japon, de la Suisse, et des États-Unis ont aussi participé au commerce de l’opium, de la morphine, et de l’héroïne12–14. Le PDG de Roche aux États-Unis, Elmer Bobst, a eu beaucoup de mal à persuader ses supérieurs de Baie de mettre un terme à leurs pratiques d’affaires contraires à l’éthique13. Roche a continué à envoyer des stupéfiants aux États-Unis à l’insu de Bobst, mais ce dernier mit la main sur un télégramme énigmatique au cours d’une visite au siège social, qui ne laissait aucun doute sur le fait que cela provenait de criminels américains. Il était question d’une cargaison de bicarbonate de soude, qu’on utilise pour faire des gâteaux !
Roche accepta d’interrompre le trafic quand Bobst a rapporté que le gouvernement des États-Unis avait menacé d’interdire à la société de faire des affaires aux États-Unis si elle ne cessait pas ces activités. Toutefois, Roche ne tarda pas à s’y remettre, encore une fois sans en aviser Bobst. Dans son livre13, Bobst mentionne que l’homme derrière tout cela n’était pas fondamentalement un homme immoral, mais complètement amoral en affaires. Bobst ne comprenait pas comment il était possible d’avoir deux normes d’éthique, une pour la vie privée et l’autre pour les affaires. Il a aussi décrit comment Roche esquivait les impôts suisses grâce à une compagnie établie dans un paradis fiscal, le Lichtenstein.
Vendre des médicaments dont les gens n’ont pas besoin constitue une pratique très lucrative, surtout quand les médicaments affectent des fonctions cérébrales. Roche a poussé le Valium (diazépam) jusqu’à ce qu’il devienne le médicament le plus vendu au monde, quoique plusieurs indications pour son utilisation eussent été très douteuses, et que son prix de gros était vingt-cinq fois plus élevé que le prix de l’or12. Au début des années 1970, Roche a été mise à l’amende par des officiels antitrust en Europe pour s’être adonnée à un comportement anticoncurrentiel dans la vente du Valium et d’un autre tranquillisant parmi les meilleurs vendeurs, le Librium (chlordiazépoxide)9.
Il aura fallu 27 ans après que le premier rapport à propos de la dépendance ait été publié avant que les autorités chargées de réglementer les médicaments reconnaissent catégoriquement que les tranquillisants créent une forte dépendance15, au même titre que l’héroïne et d’autres stupéfiants. Quand on tente de comprendre ce que l’industrie pharmaceutique fait à la population, je crois que le fait que certaines des drogues qui affectent le cerveau soient légales et d’autres illégales n’a aucune pertinence dans une perspective relevant de l’éthique. En outre, la distinction n’a aucune importance si l’on considère que l’industrie pharmaceutique ne se préoccupe pas vraiment de savoir si ses gestes sont légaux ou pas, comme l’illustre leur utilisation envahissante du marketing illégal. De plus, ce qui est légal ou pas peut varier en fonction des pays, des modes et des croyances de l’époque. Par exemple, les stupéfiants n’ont pas toujours été illégaux, et bien qu’il soit illégal de vendre du hachich dans la plupart des pays, il est légal d’en fumer aux Pays-Bas. Il est vendu dans des soi-disant cafés, un drôle de nom qui m’a déjà induit en erreur. Les petits-déjeuners servis dans les hôtels sont trop dispendieux quand on pense aux quelques aliments que la plupart d’entre nous mangeons le matin. J’ai alors décidé d’aller dans un café un beau matin à Amsterdam. Le propriétaire a bien rigolé quand je lui ai demandé un café, étant donné qu’il n’en avait pas. Peu de temps après, trois ravissantes filles du Moyen-Orient sont entrées dans le café et m’ont affirmé que le Libanais Noir était le meilleur et que c’était d’ailleurs cela qu’elles s’apprêtaient à fumer.
Un autre exemple d’incohérence légale en ce qui a trait aux substances qui affectent le cerveau : il est illégal de produire son propre brandy mais légal d’en acheter au magasin.
Peu importe le statut légal des substances psychoactives, il y a des médicaments à vendre dans les deux cas. Après avoir examiné l’industrie pharmaceutique en détail, John Braithwaite a publié ses observations dans un livre intitulé Corporate Crime in the Pharmaceutical Industry. Dans son ouvrage, on peut lire ceci12 :
Les gens qui ont une dépendance à des drogues illicites comme l’héroïne sont perçus comme faisant partie des parias les plus crapuleux de la civilisation moderne. Par comparaison, on a tendance à considérer les colporteurs de médicaments licites comme autant de fournisseurs d’un bien social, motivés par l’altruisme.
LE TEMPLE DE LA HONTE POUR LES GRANDES PHARMACEUTIQUES
Le BMJ paraît une fois par semaine, et la plupart des numéros décrivent un ou des scandales reliés à l’industrie pharmaceutique dans la section Nouvelles, ou ailleurs. Le New York Times publie aussi plusieurs articles à propos des incartades de l’industrie pharmaceutique, et la plupart des documents que j’ai amassés au cours des années proviennent de ces deux sources très respectées. Ces dernières années, plusieurs articles et livres ont décrit des cas de fautes professionnelles graves commises par les grandes sociétés pharmaceutiques sur le plan de la recherche, ainsi que des exemples de marketing frauduleux2,5,6,16, 22, mais bien que la preuve soit accablante, la réaction typique de l’industrie pharmaceutique quand une compagnie se fait prendre, c’est de dire qu’il s’agit de quelques pommes pourries comme on en trouve dans toutes les entreprises.
La question qui nous intéresse, c’est de savoir si l’on trouve une pomme pourrie isolée ici et là, ce qui pourrait être excusable, ou si c’est le panier entier qui est pourri, c’est-à-dire si la plupart des compagnies ont l’habitude d’enfreindre la loi.
Pour le savoir, j’ai effectué dix recherches sur Google en 2012, en combinant les noms des dix plus importantes compagnies pharmaceutiques7 avec le mot « fraude ». J’ai relevé entre 0,5 et 27 millions de mentions pour chacune des compagnies. J’ai choisi l’affaire la plus marquante décrite parmi les dix mentions de la première page soumise par Google et j’ai étoffé l’information à l’aide de sources additionnelles.
Les dix cas étaient tous récents (2007−2012) et tous impliquaient les États-Unis23,24. Les infractions criminelles les plus fréquentes concernaient le marketing illégal qui recommandait des médicaments pour des utilisations hors indications, des déclarations mensongères à propos des résultats expérimentaux, des dissimulations d’informations à propos des dangers des médicaments, et de la fraude aux dépens de Medicaid et de Medicare. Je décris les cas en ordre décroissant, selon la taille de la compagnie.
Pfizer accepte de payer 2,3 milliards de dollars en 2009
À l’époque, c’était le plus imposant règlement dans une affaire de fraude des soins de santé de toute l’histoire du ministère de la Justice des États-Unis35. Une filiale de la compagnie a plaidé coupable à des accusations de mauvais étiquetage de médicaments « dans le but de frauder ou de tromper » et la compagnie a été jugée coupable d’avoir fait la promotion illégale de quatre médicaments : Bextra (valde-coxib, un médicament contre l’arthrite, retiré du marché en 2005) ; Geodon (ziprasidone, un antipsychotique) ; Zyvox (linezolid, un antibiotique) et Lyrica (pregabaline, pour traiter l’épilepsie).
Une somme de 1 milliard de dollars a été prélevée pour régler à l’amiable les allégations stipulant que Pfizer avait offert des pots-de-vin et des séjours luxueux à des fournisseurs de services de santé pour les inciter à prescrire les quatre médicaments, et six lanceurs d’alerte reçurent 102 millions de dollars. Pfizer signa un engagement d’intégrité corporative avec le ministère de la Santé et des Services sociaux des États-Unis, ce qui implique l’obligation de bien se comporter pendant les cinq prochaines années. Pfizer avait ratifié trois ententes du même type auparavant26, et au moment même où Pfizer promettait aux procureurs fédéraux de ne plus jamais faire de marketing illégal en signant l’entente, elle faisait par ailleurs exactement cela27.
L’antibiotique de Pfizer, Zyvox, coûte huit fois plus cher que la vancomycine, un médicament supérieur selon les dires mêmes de Pfizer dans son propre manuel de référence, mais Pfizer a menti aux médecins, en leur disant que Zyvox était meilleur. Même après que la FDA ait dit à Pfizer d’arrêter ses prétentions non fondées car elles constituaient des risques sérieux étant donné que la vancomycine est utile pour des conditions qui mettent en danger la vie du malade, Pfizer a continué à dire aux hôpitaux et aux médecins que Zyvox sauverait plus de vies que la vancomycine27.
Novartis accepte de payer 423 millions de dollars en 2010
Le paiement concernait la responsabilité civile et criminelle qui découlait du marketing illégal du Trileptal (oxcarbaze-pine, un médicament pour traiter l’épilepsie et approuvé pour traiter les crises partielles, mais pas pour aucune douleur, aucun problème psychiatrique ni aucune autre utilisation)28. La compagnie a fait le marketing illicite du Trileptal et de cinq autres médicaments, et entraîné la soumission de requêtes frauduleuses de remboursement auprès des programmes de santé gouvernementaux. L’entente résolvait les allégations stipulant que la compagnie avait payé des pots-de-vin à des professionnels de la santé dans le but de les inciter à prescrire du Trileptal et cinq autres médicaments : le Diovan (valsartan, pour l’hypertension) ; le Zelnorm (tegaserod, un médicament pour le syndrome du côlon irritable et la constipation, retiré du marché par la FDA en 2007 en raison de sa toxicité cardio-vasculaire) ; le Sandostatin (octreotide, un médicament qui imite une hormone naturelle) ; l’Exforge (amlodipine + valsartan, pour l’hypertension) et le Tekturna (aliskiren, pour l’hypertension).
Les lanceurs d’alerte, tous d’anciens employés de Novartis, ont reçu des paiements de plus de 25 millions de dollars et Novartis a ratifié un engagement d’intégrité corporative.
Sanofi-Aventis doit payer plus de 95 millions de dollars pour régler une accusation de fraude en 2009
Selon l’arrangement à l’amiable, Aventis avait surfacturé des organismes de santé locaux et fédéraux pour des médicaments destinés à des patients nécessiteux29,30. Le ministère de la Justice assura qu’il ferait en sorte de garantir que les programmes destinés aux groupes les plus vulnérables dans la population ne paieraient pas plus cher pour des médicaments que ce que la loi permet. Aventis reconnut avoir communiqué des informations inexactes sur le prix des médicaments pour des patients du programme de rabais du prix des médicaments destinés aux patients pauvres par Medicaid. La compagnie a fait exprès pour fausser les prix, en sous-payant les rabais à Medicaid tout en surfacturant certains organismes de santé publique pour ces médicaments. La fraude a eu lieu entre 1995 et 2000 et concernait des pulvérisations nasales à base de stéroïdes contenant de la triamcinolone.
GlaxoSmithKline doit payer 3 milliards de dollars en 2011
Il s’agit du plus important règlement de toute l’histoire du ministère de la Justice des États-Unis dans une affaire de fraude des soins de santé31–33. GlaxoSmithKline a reconnu être coupable d’avoir fait le marketing d’un certain nombre de médicaments de manière illégale pour des utilisations hors indications, incluant le Wellbutrin (bupropion, un antidépresseur) ; le Paxil (paroxetine, un antidépresseur) ; l’Advair (fluticasone + salmeterol, un médicament pour l’asthme) ; l’Avandia (rosiglitazone, un médicament pour traiter le diabète) et le Lamictal (lamotrigine, un médicament pour l’épilepsie).
Un an auparavant, le ministère de la Justice avait accusé un ancien vice-président et un des principaux avocats de Glaxo d’avoir fait de fausses déclarations et d’avoir entravé une enquête fédérale sur le marketing illégal du Wellbutrin pour la perte de poids34. L’accusation incriminait le vice-président d’avoir menti à la FDA en niant que les médecins qui faisaient des présentations lors d’événements corporatifs avaient fait la promotion du Wellbutrin pour des utilisations qui n’avaient pas été approuvées par l’organisme, et d’avoir caché des documents incriminants.
La compagnie a versé des pots-de-vin à des médecins, négligé d’inclure certaines données sur la sécurité de la rosiglitazone dans des rapports soumis à la FDA, et même suggéré que l’Avandia comportait des bienfaits pour le système cardiovasculaire dans les programmes qu’elle commandite, malgré la présence d’avertissements à propos des risques cardiovasculaires sur l’étiquette approuvée par la FDA. Avandia a été retiré du marché européen en 2010 en raison d’une augmentation des décès cardiovasculaires.
Certaines allégations de fraude envers le programme Medicaid faisant état de fausses informations à propos des prix étaient aussi couvertes par l’entente. Les lanceurs d’alerte étaient quatre employés de GlaxoSmithKline, y compris un ancien directeur du développement marketing senior et un vice-président régional. La compagnie conclut un engagement d’intégrité corporative.
AstraZeneca doit payer 520 millions de dollars en 2010 pour régler une affaire de fraude
Les accusations stipulaient qu’AstraZeneca avait procédé au marketing illégal d’un de ses médicaments les plus populaires, l’antipsychotique Seroquel (quétiapine), aux enfants, aux personnes âgées, aux anciens combattants, et aux détenus, pour des utilisations non approuvées par la FDA, comprenant l’agressivité, la maladie d’Alzheimer, la maîtrise de la colère, l’anxiété, le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), la démence, la dépression, les troubles de l’humeur, le syndrome post-traumatique et l’insomnie35. De plus, la compagnie a ciblé son marketing illégal sur des médecins qui ne traitent habituellement pas de patients psychotiques, en versant des pots-de-vin à certains d’entre eux. D’autres médecins ont été envoyés dans des complexes touristiques somptueux pour les encourager à faire la promotion du médicament et à le prescrire pour des utilisations hors indications. Le lanceur d’alerte devait recevoir au-delà de 45 millions de dollars.
L’amende était minime, étant donné que les ventes du médicament avaient atteint 4,9 milliards en 200936. AstraZeneca a nié toute action fautive, bien que ses méfaits aient été évidents. Voici la déclaration du procureur général des Etats-Unis à ce propos35 :
Il n’est pas question de crimes sans victimes – les gestes illégaux des compagnies pharmaceutiques et les affirmations mensongères à l’encontre de Medicare et de Medicaid peuvent mettre en danger la santé du public, corrompre les décisions médicales des fournisseurs de services de santé, et soutirer des milliards de dollars directement des poches des contribuables.
Roche persuade des gouvernements de faire des réserves de Tamiflu
Roche a perpétré ce qui est à mes yeux le plus grand vol de l’histoire37–47, bien que personne n’ait encore traîné la compagnie devant un tribunal. Pour se préparer à l’épidémie modérée d’influenza de 2009, les gouvernements des États-Unis et de l’Europe ont dépensé des milliards d’euros et de dollars pour acheter du Tamiflu (oseltamivir).
Roche a omis de publier la plupart des données provenant des études cliniques et refusé de les partager avec des chercheurs indépendants de la Collaboration Cochrane. En se basant sur des essais non publiés, Roche prétendait que le Tamiflu réduisait les admissions à l’hôpital de 61%, les complications secondaires de 67%, et les infections des voies respiratoires inférieures nécessitant des antibiotiques de 55 %38. Curieusement, la compagnie a convaincu l’European Medianes Agency (EMA) d’approuver le médicament pour la prévention des complications dues à l’influenza, et le résumé des caractéristiques du produit publié par l’organisme déclarait que les complications des voies respiratoires inférieures avaient été réduites passant de 12,7% à 8,6% (P = 0,001)38.
En contrepartie, la FDA a envoyé une lettre d’avertissement intimant à Roche de cesser de prétendre que le Tamiflu réduit la gravité et l’incidence des infections secondaires, et en obligeant la compagnie à imprimer une mise en garde sur les étiquettes : « Les effets positifs du Tamiflu sur des conséquences potentielles de l’influenza saisonnière, aviaire, ou pandémique (comme les hospitalisations, la mortalité, ou l’impact économique) n’ont pas été démontrés37,47. »
Quand la FDA a examiné pour la première fois le zanamivir (Relenza), un médicament similaire produit par GlaxoSmithKline, le comité consultatif a recommandé que le médicament ne soit pas approuvé par un vote de 13 contre 439. D’une analyse à l’autre, le zanamivir n’était pas plus efficace qu’un placebo quand les patients prenaient un autre médicament comme du paracétamol39. Dans les jours qui ont suivi cette décision, Glaxo fit parvenir une missive enflammée à la FDA déclarant que la décision était « en complet désaccord avec la volonté du Congrès qui souhaite que le développement et l’approbation des médicaments s’effectuent rapidement et avec assurance40 ». Cette menace a eu pour effet d’ébranler la direction de la FDA qui renversa la décision du comité en critiquant l’évaluateur, le biostatisticien Michael Elashoff, pour avoir fait un témoignage négatif. À l’origine, Elashoff était aussi chargé d’examiner la demande concernant l’oseltamivir, mais on la lui retira39 et il quitta l’agence après que cette dernière eut fait la démonstration du processus faisant qu’un médicament inefficace soit approuvé. Quand le zanamivir a été approuvé, la FDA a été contrainte d’approuver aussi l’oseltamivir la même année41.
Il n’existe pas de preuve convaincante que le Tamiflu prévienne les complications dues à l’influenza ou qu’il réduise la transmission de l’influenza aux autres. Cependant, Roche a engagé des rédacteurs anonymes, et l’un d’eux a rappelé : « Les comptes reliés au Tamiflu donnaient une liste de messages-clés qu’on devait insérer. C’était supervisé par le département du marketing et c’est à ce département que nous rendions des comptes38. » Au mieux, le Tamiflu réduit la durée de l’influenza de 21 heures42, ce qui peut probablement se faire à l’aide de médicaments beaucoup moins chers comme l’aspirine et le paracétamol44. En outre, le Tamiflu comporte des dangers importants, mais ils ont été si bien dissimulés que les chercheurs de Cochrane n’ont pas pu en parler dans leur révision Cochrane. Les chercheurs de Cochrane ont quand même trouvé que des cas d’hallucinations et d’accidents bizarres ont été rapportés assez régulièrement dans la surveillance post-marketing de Roche41, dans le même sens qu’une série de cas au Japon, et des expériences sur des rats qui montraient plusieurs des mêmes symptômes. Un article de périodique signé par un groupe d’auteurs de chez Roche prétendait que les souris et les rats à qui l’on avait donné une dose très élevée de Tamiflu ne présentaient aucun effet secondaire, mais selon les documents soumis au ministère japonais de la Santé, du travail, et du bien-être, par Chugai, la filiale Japonaise de Roche, la même dose de Tamiflu tuait plus de la moitié des bêtes41 !
Si les données non publiées par Roche avaient réellement démontré ce que la compagnie prétend, Roche n’aurait pas hésité à les publier ou à les partager avec les chercheurs de Cochrane. Étonnamment, cependant, Roche a déclaré que des études additionnelles « fournissaient peu d’information nouvelle et seraient donc peu susceptibles d’être publiées par les périodiques les plus réputés38 ». Ces affirmations sont ridicules. Je ne peux m’empêcher ici de citer Drummond Rennie, le rédacteur en chef du JAMA qui a déclaré dans la publicité qu’il a faite pour le premier congrès sur la révision par les pairs43 :
Il semble qu’aucune étude ne soit trop fragmentée, aucune hypothèse trop insignifiante, aucune citation tirée de la documentation qui soit trop subjective ou trop égoïste, aucune conception trop tordue, aucune méthodologie trop bâclée, aucune présentation des résultats qui soit trop inexacte, trop obscure, et trop contradictoire, aucune analyse qui soit trop intéressée, aucun argument trop partial, aucune conclusion trop vaseuse ou trop injustifiée, et aucune syntaxe ni grammaire trop insultantes pour empêcher qu’un article finisse par être publié.
Après beaucoup d’attention médiatique, Roche a promis en 2009 de placer sur son site Web la totalité des rapports n’ayant pas encore été publiés, mais on les attend encore.
Un autre fait pour le moins étrange est l’envoi par Roche d’un protocole d’entente à un des chercheurs de Cochrane stipulant qu’une fois signée, il ne pouvait même pas mentionner l’existence même de cette entente38 ! De toute évidence, Roche avait non seulement l’intention de continuer à cacher ses données, mais aussi de faire taire les gens qui demandaient à les voir. Le chercheur de Cochrane a demandé une clarification le jour suivant sans jamais recevoir de réponse.
Le Conseil de l’Europe a critiqué certains gouvernements nationaux, l’OMS (Organisation mondiale de la santé) et les organismes de l’UE (Union européenne) pour s’être rendus coupables d’actions ayant entraîné le gaspillage de sommes d’argent importantes45. Plusieurs se sont demandé pourquoi l’OMS choisissait, pour rédiger des directives relatives aux médicaments contre la grippe, des gens payés par les compagnies qui commercialisent ces médicaments, et qui omettaient ce détail dans leurs rapports et pourquoi il y avait tellement de secret autour de tout cela qu’il n’était même pas possible, de l’extérieur, d’obtenir de l’information sur ceux qui siégeaient au comité de l’OMS39.
L’OMS a été le partenaire idéal des excès de Roche qui s’est vantée de travailler à titre de partenaire responsable des gouvernements pour les assister dans leurs planifications destinées à faire face à la pandémie39. Les actions de Roche démentent cette prétention, si bien que j’ai suggéré en 2012 que les gouvernements européens poursuivent Roche pour récupérer les milliards d’euros qu’ils avaient dépensés inutilement pour faire des réserves de Tamiflu, ce qui aurait aussi pu faire la lumière sur les résultats cliniques cachés46. De plus, j’ai proposé de boycotter les produits de Roche jusqu’à ce qu’ils publient les données manquantes sur le Tamiflu.
Johnson & Johnson contrainte de payer une amende de 1,1 milliard de dollars en 2012
Un jury a découvert que la compagnie et sa filiale Janssen ont minimisé et dissimulé certains risques associés à son médicament antipsychotique Risperdal (rispéridone)48. Le juge a découvert presque 240 000 infractions à la loi sur les fraudes de Medicaid en Arkansas. Les jurés ne tardèrent pas à rendre un verdict favorable à l’Etat, qui avait déclaré que Janssen avait menti au sujet des effets secondaires du Risperdal potentiellement dangereux pour la vie du malade ; comme ceux d’autres antipsychotiques, les effets incluaient des gains de poids, du diabète, des accidents vasculaires cérébraux, des convulsions, et même des décès. La FDA a ordonné à Janssen de publier un communiqué à l’intention des médecins pour corriger une lettre préalable qui disait que le médicament n’augmentait pas le risque de diabète. Après le verdict, Janssen a continué à insister sur le fait qu’elle n’enfreignait pas la loi. Parmi plusieurs verdicts rendus précédemment contre la compagnie quelques mois auparavant, on trouve une amende civile de 327 millions de dollars en Caroline du Sud et un règlement à l’amiable de 158 millions de dollars au Texas.
Le pire dans tout cela, c’est que les crimes ont aussi un lourd impact sur les enfants49. Plus d’un quart du Risperdal est consommé par des adolescents et des enfants, malgré des indications non autorisées ; un panel d’experts fédéraux spécialisés dans les médicaments a conclu que le médicament était beaucoup trop utilisé. Joseph Biederman, un pédopsychiatre de Harvard et de renommée internationale, s’est livré à une promotion agressive du médicament auprès des enfants, tout en extorquant la compagnie*.
* Biederman était un des papes de la psychiatrie de l’adolescent, ce qui lui donnait une influence assez grande pour que certaines pharmaceutiques lui versent un traitement annuel dans les 6 chiffres, ce qui était en contradiction avec les politiques de Harvard (étant professeur à temps plein, il avait caché ces revenus pendant des années). Le pot aux roses fut découvert, ce qui a mené à l’adoption par le Congrès des États-Unis du Sunshine Act, en vertu duquel les pharmaceutiques doivent déclarer à un registre national toute somme payée à un médecin. Ce registre national est accessible par Internet à tout citoyen, qui peut ainsi vérifier tout ce que touche de ces forbans son médecin traitant. L’extorsion réside dans le fait que Biderman était assez influent pour exiger de Johnson & Johnson qu’on augmente l’honoraire annuel que J&J lui versait sous peine de devenir une société fantôme en psychiatrie de l’enfance. Et J&J, qui sait reconnaître de quel côté son pain est beurré, a payé. D’où la notion d’extorsion.
La correspondance interne déposée en cour a révélé que Biederman était furieux après le rejet par Johnson & Johnson d’une demande qu’il avait faite pour recevoir une bourse de recherche de 280 000$. Un porte-parole de la compagnie écrivait alors : « Je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi contrarié. Depuis lors, notre compagnie est devenue inexistante [sic] au sein de sa zone d’influence. »
La fraude pourrait également prendre encore plus d’ampleur. En avril 2012, le gouvernement des États-Unis déclarait, dans une motion déposée dans le cadre d’une affaire de fraude des soins de santé d’une valeur potentielle de plusieurs milliards intentée contre Johnson & Johnson, qu’Alex Gorsky, vice-président du marketing pressenti pour devenir le prochain chef de la direction de Johnson & Johnson, était très au courant de la fraude présumée et y était activement impliqué50. Selon les allégations, Johnson & Johnson avait versé des pots-de-vin pour inciter Omnicare, la plus grosse pharmacie des centres d’hébergement et de soins de longue durée des Etats-Unis, à acheter et à recommander le Risperdal et d’autres médicaments de la compagnie. La compagnie négligea d’informer Omnicare ou les membres de l’équipe des ventes de Janssen que la FDA avait averti la compagnie qu’il serait erroné et trompeur de commercialiser le Risperdal comme médicament sécuritaire et efficace pour les personnes âgées. En effet, le médicament n’avait pas été étudié de façon adéquate pour cette population et en outre, la FDA avait rejeté la tentative de la compagnie d’obtenir l’autorisation de vendre du Risperdal pour le traitement des désordres psychotiques et comportementaux attribués à la démence (de loin l’utilisation de Risperdal la plus courante dans les installations de soins de santé desservies par Omnicare) en raison de données insuffisantes à propos de la sécurité du produit). Malgré le poids des enquêtes fédérales et celles de l’Etat sur les allégations relatives au Risperdal, le conseil de la direction de Johnson & Johnson a récompensé Gorsky en le choisissant comme prochain chef de la direction. Tout comme dans la pègre : plus gros est le crime, plus l’avancement est important.
Merck doit payer 670 millions de dollars pour avoir fraudé Medicaid en 2007
Merck avait omis de payer les rabais appropriés à Medicaid et à d’autres programmes de soins de santé gouvernementaux, en plus de verser des pots-de-vin à des médecins et à des hôpitaux pour les encourager à prescrire différents médicaments51 . Les allégations ont été soulevées dans deux poursuites intentées séparément par des lanceurs d’alerte, et l’un d’entre eux devait recevoir 68 millions de dollars. De 1997 à 2001, la force de vente de Merck a utilisé approximativement 15 programmes différents pour inciter des médecins à prescrire des médicaments. Ces programmes consistaient surtout en des paiements excédentaires versés à des médecins sous le couvert d’honoraires pour de la « formation », de la « consultation », ou de la « recherche de marché ». Le gouvernement a présumé que ces honoraires étaient des pots-de-vin illégaux destinés à mousser les ventes des médicaments de Merck. Merck consentit à une entente d’intégrité corporative.
Eli Lilly doit payer plus de 1,4 milliard de dollars pour du marketing illégal en 2009
Eli Lilly a conclu une entente avec le ministère de la Justice pour régler une affaire au sujet d’un vaste complot impliquant le marketing non conforme de son médicament vedette, l’antipsychotique Zyprexa (olanzapine), avec des ventes mondiales de près de 40 milliards de dollars entre 1996 et 200952. En vertu de la décision, Eli Lilly paierait 800 millions de dollars en amendes civiles et plaiderait coupable à des accusations criminelles, en acquittant une amende additionnelle de 600 millions de dollars. Les allégations ont été soulevées par six lanceurs d’alerte de Lilly qui se partageraient environ 18 % des sommes récupérées par le fédéral et les États en cause. Tous les lanceurs d’alerte ont été congédiés ou contraints de démissionner par la compagnie. D’après la plainte, un représentant des ventes avait communiqué avec le service d’assistance téléphonique de la compagnie au sujet des pratiques de ventes contraires à l’éthique, mais n’avait reçu aucune réponse.
Lilly eut beaucoup de succès en commercialisant le Zyprexa pour de nombreuses utilisations hors indications incluant la maladie d’Alzheimer, la dépression et la démence, en particulier chez les enfants et les personnes âgées, bien que les dangers du médicament soient sérieux et susceptibles d’induire des défaillances cardiaques, des pneumonies, des gains de poids considérables et du diabète. Des vendeurs de Lilly disséminés dans l’auditoire posaient en personnes intéressées par les utilisations étendues du Zyprexa, formulant des « questions convenues » pendant des conférences traitant des utilisations hors indication et pendant des séances audio portant sur le même sujet et destinées aux médecins. Bien qu’on ait connu le risque substantiel de gain de poids que pose le Zyprexa, une autre tactique consistait pour la compagnie à minimiser le lien entre le Zyprexa et le gain de poids dans une vidéo largement diffusée et intitulée Le mythe du diabète, qui utilisait des « études scientifiques » d’une intégrité douteuse ainsi que le signalement désordonné d’effets secondaires indésirables. Le règlement à l’amiable comprenait un engagement d’intégrité corporative.
Abbott doit payer 1,5 milliard de dollars pour avoir fraudé Medicaid en 2012
Abbott régla à l’amiable des allégations d’avoir fraudé Medicaid en se livrant à du marketing illégal faisant la promotion de son médicament pour l’épilepsie Depakote (valproate) ; 84 millions de dollars seraient payés aux lanceurs d’alerte53,54. Abbott paierait 800 millions de dollars en amendes et dommages civils pour indemniser Medicaid, Medicare et les différents programmes de soins de santé fédéraux pour les dommages entraînés par sa conduite. Abbott plaida aussi coupable à une infraction de la Food, Drug, and Cosmetic Act (la Loi sur l’innocuité des aliments, médicaments, et cosmétiques) et accepta de payer une amende criminelle et des confiscations d’une valeur de 700 millions de dollars.
Les États ont allégué qu’Abbott avait moussé les ventes et l’utilisation du Depakote pour des utilisations non approuvées par la FDA comme étant sécuritaires et efficaces. De plus, on a accusé Abbott Laboratories d’avoir fait des déclarations trompeuses et mensongères à propos de l’innocuité, de l’efficacité, du dosage, et de l’efficience du Depakote pour certaines utilisations non autorisées. En outre, la compagnie aurait commercialisé de façon inappropriée son produit dans des centres d’hébergement pour patients déments alors qu’elle avait interrompu une étude auprès de patients similairement atteints, étude qui avait montré une augmentation des effets indésirables. Enfin elle aurait payé des pots-de-vin pour inciter les médecins et d’autres à prescrire le médicament ou à en faire la promotion. Abbott conclut une entente d’intégrité corporative.
LES CRIMES SONT RÉPÉTITIFS
Mon enquête a montré que la criminalité des entreprises est répandue et que les crimes sont commis sans pitié, dans le mépris le plus total des décès et des autres conséquences néfastes qu’elles causent. Vous constaterez en poursuivant la lecture du présent ouvrage que la criminalité des sociétés tue pas mal de gens12 et qu’elle implique aussi des détournements gigantesques de sommes d’argent des contribuables.
Il a été facile de trouver d’autres crimes commis par les mêmes dix principales compagnies24, des crimes perpétrés à l’extérieur des États-Unis, et des crimes commis par d’autres compagnies. J’ai utilisé le terme « fraude » dans mes recherches, mais j’aurais tout aussi bien pu utiliser « criminel », « illégal », « FBI », « pot-de-vin », « inconduite », « règlement », « corruption », « coupable », ou « crime », ce qui aurait dévoilé de nombreux autres crimes, additionnels et plus récents. Je décrirai ici un certain nombre d’autres crimes et je donnerai d’autres exemples plus tard.
En 2007, la FDA a éreinté Sanofi-Aventis à propos de son défaut d’agir dans des cas connus de fraude pendant une étude pivot de son antibiotique Ketek (telithromycine)55. La FDA avait exigé cette étude après avoir examiné le médicament pour la première fois, et la compagnie recruta plus de 24 000 patients en 5 mois seulement, en embauchant plus de 1 800 médecins, dont plusieurs qui en étaient à leur première étude clinique56.
Sanofi-Aventis continua à nier les accusations, bien que selon les archives de la compagnie et le témoignage d’un ancien employé celle-ci ait eu pleinement conscience qu’il s’agissait de données frauduleuses et qu’elle n’ait rien fait.
Un des médecins chercheurs a été condamné pour fraude après avoir enrôlé des patients et fabriqué des formulaires de consentement, il reçut une peine de 57 mois de prison. Ce médecin avait recruté plus de 400 patients, à raison de 400 dollars par patient, et aucun de ces patients n’avait abandonné l’étude, ni été perdu de vue pendant le suivi, ce qui est manifestement trop beau pour être vrai.
Après avoir inspecté neuf autres sites qui recrutaient beaucoup de patients, la FDA en soumit trois à des enquêtes criminelles56. Toutefois, bien que la FDA ait été au courant de l’inconduite, elle ne fit état d’aucun problème relatif aux données lors de la réunion de son comité consultatif, en invoquant l’excuse d’une obligation légale lui imposant de s’en abstenir en raison de l’existence d’une enquête criminelle56. Ce n’est pas une excuse valable, étant donné qu’il aurait pu décider de ne présenter aucune donnée de cette étude, ou de retarder la réunion jusqu’à ce que les problèmes aient été résolus.
Ignorant tout des controverses, le comité vota pour recommander l’homologation à 11 contre 1. La FDA accepta en outre des rapports étrangers de pharmacovigilance post homologation, comme preuves d’innocuité, bien que des données non contrôlées de ce genre soient sujettes à caution, et quoique les enquêteurs criminels eurent recommandé à la FDA d’examiner la question de l’implication soupçonnée de Sanofi-Aventis dans une fraude systématique. La FDA ne donna pas suite à cette recommandation et exerça plutôt des pressions sur ses chercheurs à l’interne pour qu’ils modifient leurs conclusions en faveur du médicament, ce qui, comme on le verra plus tard, semble être pratique courante à la FDA.
Sanofi-Aventis s’est vantée que le lancement du Ketek avait été celui de l’antibiotique le plus réussi de l’histoire. Cependant, sept mois seulement après le lancement, on rapportait un premier décès dû à une insuffisance hépatique.
D’autres cas suivirent. La FDA organisa une réunion d’urgence de ses « haut dirigeants » – ce qui n’inclut pas les responsables de la sécurité – et annonça que le médicament était sans danger en se référant à une étude qu’elle savait être frauduleuse56 ! Un mois plus tard, un des examinateurs du Ketek alerta la direction générale de la FDA au sujet des irrégularités, mais aucune action corroborative ne fut menée, et quelques mois plus tard, après 23 cas de blessures hépatiques graves et quatre décès rapportés, le commissaire Andrew von Eschenbach, de la FDA, interdit aux chercheurs de parler du Ketek à l’extérieur de l’agence. La FDA ne changea les étiquettes de Ketek pour alerter au sujet de sa toxicité pour le foie que 16 mois après que le premier cas eut été rendu public. La défense publiée par l’agence pour tout cela cause un certain malaise et ressemble beaucoup aux propos de l’industrie pharmaceutique quand elle tente de défendre l’indéfendable57.
Il est étonnant de constater que le Ketek est toujours disponible aux États-Unis, accompagné, toutefois, d’une mise en garde ; par ailleurs, il n’est plus autorisé pour les maladies respiratoires bénignes comme la sinusite. L’information officielle de la FDA sur le Ketek est tellement accablante que j’ai du mal à comprendre qu’un médecin ose utiliser ce médicament, mais l’explication la plus probable, c’est que les médecins ne lisent pas les comptes-rendus de 26 pages sur les médicaments individuels et ne connaissent pas les antécédents du Ketek58.
AstraZeneca a payé 355 millions de dollars en 2003 après avoir plaidé coupable à des accusations d’avoir encouragé des médecins à demander des remboursements illégaux de Medicare pour son médicament contre le cancer de la prostate, le Zoladex (gosereline), et soudoyé des médecins pour qu’ils en achètent35.
Johnson&Johnson devait payer au-delà de 75 millions de dollars aux autorités du Royaume-Uni et des États-Unis en 2009 pour régler des inculpations de corruption dans trois pays européens et en Irak59. Les accusations étaient liées au paiement allégué de pots-de-vin à des médecins en Grèce, en Pologne et en Roumanie, pour les encourager à utiliser les produits de la compagnie, ainsi qu’à des administrateurs du secteur hospitalier en Pologne, pour qu’ils accordent des contrats à la compagnie.
En 2005, Eli Lilly accepta de payer 36 millions de dollars pour régler à l’amiable des accusations civiles et criminelles relatives à du marketing illégal du médicament contre l’ostéoporose Evista (raloxifène) pour la prévention des maladies cardiaques et du cancer du sein dans des lettres envoyées aux médecins par son secteur des ventes60. La compagnie a aussi dissimulé des données qui montraient une augmentation du risque de cancer des ovaires. Eli Lilly ratifia un engagement d’intégrité corporative.
En 2001, TAP Pharmaceuticals, une coentreprise d’Abbott et Takeda, a payé 875 millions de dollars, plaidant coupable à des accusations criminelles de fraude pour avoir incité des médecins à facturer au gouvernement des médicaments que la compagnie leur donnait gratuitement ou à prix réduit18,61,62.
En 2003, Abbott a payé 622 millions de dollars pour régler une enquête sur ses pratiques de vente concernant des liquides servant à nourrir les patients gravement malades61. Abbott donna des tubes et des pompes permettant d’introduire la nourriture liquide directement dans le tube digestif du patient en échange de grosses commandes de liquides.
Plusieurs crimes ont parfois été rapportés dans les 10 premiers résultats de mes recherches sur Google à propos de la même compagnie. GlaxoSmithKline, par exemple, a fermé une usine à Puerto Rico en 2009 pour le motif qu’elle produisait des médicaments défectueux63. La fabrique avait envoyé des lots de Paxil (paroxétine) qui contenaient deux doses différentes et mélangeaient deux médicaments différents, de l’Avendia (rosiglitazone) avec du Tagamet (cimétidine) et du Paxil, par exemple. Glaxo reconnut être coupable de fraude criminelle et reçut une amende de 750 millions de dollars, dont 96 millions étaient destinés à la donneuse d’alerte, la directrice générale du service de contrôle de la fiabilité de la compagnie, dont les inquiétudes documentées avaient été ignorées par la haute direction qui la congédia64. Glaxo mentit également aux enquêteurs fédéraux au sujet des problèmes, quoique des pharmaciens aient appelé l’usine directement quand des patients se sont présentés avec des comprimés de couleurs différentes dans leur médication. En plaidant sa culpabilité, Glaxo admit avoir distribué des médicaments frelatés, mais la compagnie a menti au public quand elle a indiqué qu’elle avait volontairement rapporté à la FDA, en 2002, ses préoccupations sur des questions d’innocuité, et quand elle a affirmé que « l’usine avait été fermée en 2009 en raison d’une diminution de la demande pour les médicaments fabriqués là-bas ». Or on ne peut pas vraiment dire que des gros vendeurs comme Avandia, Paxil et Tagamet sont en baisse de popularité.
En 2003, Glaxo a signé un engagement d’intégrité corporative et payé une amende civile de 88 millions de dollars pour avoir surfacturé Medicaid pour le Paxil et l’aérosol contre les allergies nasales Flonase (fluticasone)65. En 2003, la compagnie a fait face à une demande d’un montant de 7,8 milliards de dollars en impôts impayés et en intérêts, demande la plus élevée de l’histoire du fisc américain65. En 2004, la police financière de l’Italie accusait plus de 4 000 médecins et 73 employés de Glaxo de corruption, un complot de 228 millions d’euros qui impliquait de l’argent comptant et d’autres bénéfices pour inciter les médecins à utiliser les produits de la compagnie, plus particulièrement en relation avec des médicaments contre le cancer66. Enfin, en 2006, la compagnie a réglé une dispute concernant des taxes en acceptant de payer 3,1 milliards de dollars dans une affaire qui concernait des « frais de transport intra-entreprise65 ».
Certains crimes consistent à empêcher les fabricants de génériques de pénétrer sur le marché une fois qu’un brevet est échu, et GlaxoSmithKline a aussi trempé dans des activités du genre67. En 2004, la compagnie accepte de payer 175 millions de dollars pour régler une poursuite qui l’accusait d’avoir bloqué des formes génériques moins coûteuses du Relafen (nabumétone, un AINS), en contravention avec les lois antitrust, et la compagnie s’attendait à payer 406 millions de dollars pour couvrir les demandes réglées ou en attente d’un verdict au sujet du Relafen. En 2006, Glaxo paya 14 millions de dollars pour résoudre des allégations selon lesquelles les programmes gouvernementaux auraient payé des prix gonflés pour le Paxil parce que l’entreprise avait fraudé des brevets, enfreint des lois antitrust, et s’était adonnée à des poursuites peu consistantes dans le dessein de conserver un monopole et d’empêcher des versions génériques d’entrer sur le marché65.
Aux États-Unis, il peut arriver que des génériques soient maintenus hors du marché pendant des années, en toute légalité. Une compagnie peut intenter une poursuite contre un compétiteur qui fabrique un générique en accusant ce dernier d’avoir enfreint quelque autre brevet, et peu importe à quel point l’accusation est ridicule, l’approbation du générique par la FDA est automatiquement retardée pendant 30 mois. Voici comment on décrit un des éléments d’un plan de cours destiné à des avocats et à des cadres supérieurs de l’industrie : « Comment utiliser un sursis de 30 mois pour neutraliser chaque défi d’un générique68. » De cette manière, Glaxo a réussi à rallonger l’exclusivité de son antidépresseur vedette, le Paxil, pendant plus de 5 ans69 !
Les avocasseries constituent aussi un grave problème en Europe. En 2008, un rapport de la Commission européenne estimait que les tactiques légales des compagnies pour écarter les génériques du marché avaient coûté 3 milliards d’euros à l’UE en seulement 8 ans70. Une bonne illustration de l’état lamentable de notre droit des brevets nous est fournie par une affaire dans laquelle une compagnie a enregistré 1300 brevets pour le même médicament. Je mentionnerai aussi des exemples récents de compagnies fabriquant des appareils ou des médicaments qui ne figurent pas dans les 10 plus importantes. Bristol-Myers Squibb accepta en 2007 de payer plus de 515 millions de dollars pour régler une affaire de marketing illégal et de fixation frauduleuse des prix impliquant des paiements effectués à des médecins pour les encourager à utiliser aussi les médicaments de la compagnie hors indications71. En 2003, Bristol-Myers Squibb a payé 670 millions de dollars pour régler des accusations de contraventions à la loi antitrust qui avaient contraint des patients cancéreux et d’autres à surpayer pour des médications importantes et souvent vitales, le tout à l’échelle de centaines de millions de dollars72,73. La Federal Trade Commission a accusé la compagnie d’avoir systématiquement bloqué l’entrée de compétiteurs génériques sur le marché de manière illégale pendant une décennie, en ayant trompé le bureau des brevets par le dépôt de soumissions frauduleuses, et en ayant offert un pot-de-vin de 72 millions de dollars à un concurrent pour le dissuader de commercialiser son médicament générique73.
En 2013, la Commission européenne a imposé une amende de 94 millions d’euros à Lundbeck, et des amendes totalisant 52 millions d’euros à plusieurs producteurs de citalopram générique (Cipramil) qui, en échange d’argent comptant, s’étaient entendus avec Lundbeck en 2002 pour retarder l’entrée de l’antidépresseur sur le marché, au mépris des règlements antitrust de l’UE74. Lundbeck avait aussi acheté l’inventaire des génériques dans le seul but de les détruire.
En 2006, on rapporta dans une poursuite intentée par un lanceur d’alerte que Medtronic avait dépensé au moins 50 millions de dollars en paiements à d’éminents chirurgiens du dos au cours d’une période de 4 ans75. Selon le ministère de la Justice des Etats-Unis, Medtronic paya des médecins entre 1000 $ et 2 000 $ par patient à qui l’on implantait un des appareils de la compagnie76. Un chirurgien, qui a reçu presque 700 000 $ en frais de consultation de la part de Medtronic au cours d’une période de 9 mois, déclara que ses honoraires étaient un dédommagement pour le temps qu’il passait loin de sa famille et de sa pratique75. La poursuite a révélé que Medtronic organisait des conférences médicales dont l’objectif principal consistait à « faire en sorte que le médecin, par quelque moyen financier que ce soit », utilise ses appareils.
Medtronic a suivi de près l’utilisation de ses appareils par les médecins qui assistaient aux conférences, en choisissant à donner à certains d’entre eux une « attention spéciale ». Un ancien président de l’American Academy of Orthopédie Surgeons a remarqué que les sommes d’argent étaient astronomiques (le coût des composantes nécessaires dans le cas d’une chirurgie de fusion lombaire oscille habituellement autour de 13 000 $), et que les fabricants d’appareils connaissaient l’achalandage de ces chirurgiens. Le programme de pots-de-vin comportait des activités particulières, comme celle d’inviter les médecins au Platinum Plus, un club d’effeuilleuses de Memphis, au Tennessee, en camouflant les dépenses comme s’il s’agissait d’une soirée au ballet.
En 2007, après avoir admis le paiement de dizaines, voire de centaines de milliers de dollars en « frais de consultation » à des chirurgiens pour qu’ils utilisent leurs appareils, cinq manufacturiers de dispositifs de remplacement de la hanche et du genou, Zimmer, DePuy Orthopaedics, Biomet, Smith & Nephew et Stryker Orthopedics, ont accepté un règlement à l’amiable avec le gouvernement fédéral des États-Unis77.
En 2006, les laboratoires Serono ont plaidé coupable à deux accusations de complot et ils ont accepté de payer 704 millions de dollars pour régler à l’amiable des accusations criminelles pour avoir participé à un système de pots-de-vin élaboré pour encourager les ventes de son médicament pour traiter le SIDA, Serostim (somatropine de l’ADN recombiné)78.
En 2004, Schering-Plough a accepté un règlement de 346 millions de dollars pour avoir versé des pots-de-vin ; Bayer a payé 257 millions de dollars et GlaxoSmithKline 87 millions de dollars pour régler des allégations similaires79. Parmi d’autres compagnies impliquées, on trouve AstraZeneca, Dey, Pfizer et TAP Pharmaceuticals80.
En 2007, Purdue Pharma et son président, son principal avocat et son ancien directeur médical ont dû payer un total de 635 millions de dollars en amendes pour avoir affirmé que l’OxyContin (oxycodone, un médicament apparenté à la morphine) était moins toxicomanogène, moins susceptible d’entraîner des abus et moins susceptible de causer des symptômes de sevrage que les autres opiacés. La compagnie a admis avoir menti aux médecins et aux patients à propos des risques dans le dessein de stimuler les ventes81. Le médicament devint très populaire parmi les toxicomanes, en fait un stupéfiant de premier choix qu’ils désignaient comme « l’héroïne des péquenauds82 ». Il est responsable d’une quantité énorme de décès. En Australie, la plupart de ceux qui sont morts n’étaient pas des toxicomanes mais des gens qui faisaient des surdoses accidentelles83. Le directeur du US Center on Addiction and Substance Abuse a déclaré84 :
Je crois que ces gens sont des colporteurs de drogues, tout comme les colporteurs de stupéfiants qu’on trouve dans la rue. Il est scandaleux que ces gens fassent la promotion de ce médicament sur le marché en sachant qu’en raison de sa puissance toxicomanogène, ses effets nuiront à des millions de personnes innocentes.
On a interdit à trois chefs de la direction de faire des affaires avec le gouvernement pendant 12 ans83. Purdue forma sa force de vente pour affirmer aux médecins que le risque de pharmacodépendance était inférieur à 1 %, ce qui n’est pas vrai, étant donné que le risque est similaire à celui des autres opiacés82.
Purdue versa 3 millions de dollars au Massachusetts General Hospital de Boston pour que son centre sur la douleur soit rebaptisé « « MGH Purdue Pharma Pain Center »18. L’entente impliquait aussi que les spécialistes de la douleur de l’hôpital devaient utiliser « un curriculum conçu par Purdue, et rédigé en partie pour encourager les pharmaciens et les médecins méticuleux à prescrire des analgésiques comme l’OxyContin ». La corruption était totale.
L’OxyContin a aussi été le sujet d’une campagne de promotion extrêmement agressive au Danemark, au point de devenir un sujet de conversation même parmi les médecins qui utilisaient rarement des médicaments assimilables à la morphine. Les vendeurs étaient comme des mouches tsé-tsé qui bourdonnaient autour de tout ce qui bougeait dans un sarrau. Le médicament est très dispendieux et ne procure aucun avantage par rapport aux autres produits beaucoup moins chers. Or, malgré cela, le comité des médicaments de l’hôpital où je travaille s’est vu contraint d’interdire le médicament tout simplement, de sorte que les cliniciens ne pouvaient plus en commander de la pharmacie.
Les crimes sont tellement répandus, répétitifs, et variés, qu’il est impossible de ne pas conclure qu’ils sont commis délibérément, car le crime est payant. Les compagnies considèrent les amendes comme des coûts de marketing et poursuivent leurs activités illégales comme si de rien n’était.
Il est aussi important de souligner que plusieurs des crimes auraient été impossibles à commettre si des médecins n’avaient pas été disposés à collaborer. Les médecins sont complices des crimes quand ils acceptent des pots-de-vin et s’adonnent à d’autres types de corruption, souvent reliés au marketing illégal. Il est curieux de voir que des médecins puissent être payés par les compagnies pour faire exactement cela sans être punis. Quand les médicaments sont fabriqués pour des utilisations hors indications, on ignore s’ils sont efficaces ou s’ils sont trop dangereux pour être utilisés, par les enfants, par exemple. C’est pourquoi on tient cette façon de procéder comme analogue à l’utilisation de citoyens comme rats de laboratoire85 à grande échelle, et sans disposer de leur consentement éclairé.
Même quand les médecins utilisent des médicaments seulement pour des indications approuvées, les crimes ont des conséquences sur leurs patients. Les médecins n’ont accès qu’à de l’information manipulée et sélectionnée16,22,43 et croient donc les médicaments beaucoup plus efficaces et sécuritaires qu’ils ne le sont vraiment. Par conséquent, tant le marketing légal que le marketing illégal entraînent un surtraitement étendu de la population et beaucoup de dommages qui pourraient être évités.
Plusieurs crimes impliquent la corruption à grande échelle de médecins qui reçoivent de l’argent pour les encourager à prescrire des médicaments qui sont souvent 10 ou 20 fois plus dispendieux que des médicament existants qui sont tout aussi bons, et parfois même supérieurs. Le US Office of the Inspector General of the Department of Health and Human Services a émis un avertissement selon lequel les nombreuses pratiques existantes impliquant des cadeaux et des paiements à des médecins pour influencer leurs choix d’ordonnances auraient le potentiel de contrevenir aux lois fédérales contre la corruption69. Malheureusement, le seul organisme qui semble avoir pris au sérieux la gravité de la situation est l’American Médical Student Association, qui a voté une interdiction totale à tous les étudiants en médecine d’accepter des cadeaux ou des faveurs69.
C’EST DU CRIME ORGANISÉ
En 2004–2005, le comité sur la santé de la Chambre des communes du Royaume-Uni a examiné l’industrie pharmaceutique en détails17 et a conclu que son influence était énorme et hors de contrôle86. Les parlementaires ont découvert une industrie qui achète de l’influence auprès des médecins, des œuvres de bienfaisance, des groupes de patients, des journalistes et des politiciens, et dont la réglementation est parfois timide ou ambiguë87. En outre, le ministère de la Santé n’est pas seulement responsable du service de santé national, mais aussi de représenter les intérêts de l’industrie pharmaceutique. Le rapport du comité a clairement établi qu’il serait bon pour tout le monde de réduire l’influence de l’industrie, y compris pour l’industrie elle-même, qui pourrait se concentrer sur l’élaboration de nouveaux médicaments plutôt que de corrompre des médecins, des regroupements de patients, ou n’importe qui d’autre88. Le rapport a aussi affirmé qu’on a besoin d’une industrie qui soit guidée par les valeurs de ses scientifiques, non pas par celles de son département du marketing. De plus, le comité s’est montré particulièrement inquiet de l’augmentation de la médicalisation, c’est-à-dire de la croyance selon laquelle chaque problème nécessite un comprimé.
Néanmoins, le gouvernement britannique n’a rien fait à la suite du rapport accablant du comité sur la santé, probablement en raison du fait que l’industrie pharmaceutique britannique constitue la troisième activité la plus profitable, après le tourisme et la finance88. Après qu’on leur a présenté des preuves écrasantes et sans équivoque de l’influence malsaine de l’industrie sur la santé publique, les fonctionnaires du gouvernement ont déclaré qu’il n’existait aucune preuve de l’influence malsaine de l’industrie sur la santé publique89 !
Le ministère de la Santé se porta à la défense de l’industrie en invoquant son surplus commercial de 3 milliards de livres, et soutint que les représentants pharmaceutiques donnaient des bonnes informations aux médecins. Il défendit même le nombre croissant de prescriptions pour des antidépresseurs bien que cela soit pratiquement indéfendable, comme je l’expliquerai au chapitre 17. Les excès allégués de la promotion commerciale furent balayés du revers de la main en se fondant sur l’argument que des mécanismes appropriés étaient en place. C’est ce que Ben Goldacre appelle de « fausses corrections90 ». D’une fois à l’autre, le public se fait offrir des assurances mensongères affirmant que le problème a été corrigé.
Quand on a posé la question directement, c’est-à-dire si le Ministère comprenait l’existence d’un conflit fondamental entre l’intérêt de l’industrie pour le profit et la responsabilité du gouvernement de protéger la santé publique, la réponse a été que la « relation des parties prenantes » entre le gouvernement et l’industrie « entraîne de nombreux gains et plusieurs remèdes innovateurs dont les impacts sur la santé sont énormes ».
Les mots me manquent. En constatant l’attitude gouvernementale de déni total, il n’est guère surprenant que le crime prospère dans l’industrie pharmaceutique, en se propageant comme les mauvaises herbes.
La clé de voûte de la US Organized Crime Control Act de 1970 est la Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO)91. Le racketérisme consiste à commettre un certain type d’offense à plus d’une reprise. La liste des offenses qui constituent du racketérisme inclut l’extorsion, la fraude, les infractions fédérales liées à la drogue, la corruption, les détournements de fonds, l’obstruction de la justice, l’obstruction de l’application de la loi, la subornation de témoins, et la corruption politique. Les grosses pharmaceutiques s’adonnent si souvent à tout cela constamment qu’il ne peut y avoir aucun doute que son modèle d’affaires satisfait aux critères du crime organisé.
Un ancien vice-président du marketing international de Pfizer [Peter Rost] devenu lanceur d’alerte après que la compagnie eut ignoré ses plaintes à propos du marketing illégal a une opinion similaire92 :
Il est effrayant de constater toutes les similitudes qui existent entre cette industrie et la pègre. Le monde interlope génère des montants d’argent obscènes, tout comme cette industrie. Les effets secondaires du crime organisé sont des assassinats et des décès, et les effets secondaires sont identiques pour cette industrie. La mafia soudoie des politiciens et beaucoup d’autres, et il en va de même dans cette industrie. La différence est que, tous ces gens dans l’industrie pharmaceutique se considèrent eux-mêmes – eh bien, disons au moins dans 99 pourcent des cas – se voient comme des citoyens respectueux de la loi, non pas comme des citoyens qui oseraient voler une banque Cependant, quand ils se réunissent en groupe et dirigent ces sociétés, il semble qu’une chose se produise avec des citoyens autrement exemplaires quand ils font partie d’une corporation. Cela ressemble presque aux atrocités perpétrées pendant une guerre ; les gens font des choses qu’ils ne pensaient pas être capables de faire. Quand ils font partie d’un groupe, les gens peuvent faire des choses qu’ils ne feraient pas autrement, parce que le groupe peut valider la justesse de leurs actions.
Quand un crime a entraîné le décès de milliers de gens, on devrait le tenir pour un crime contre l’humanité. Notre perception du méfait ne devrait pas faire une différence entre les meurtres commis avec des armes et ceux qui sont commis avec des comprimés. Or, jusqu’à récemment, il régnait une complaisance remarquable même en présence de crimes mortels. Cela pourrait être sur le point de changer, du moins, aux États-Unis. En 2010, le ministère de la Justice a porté des accusations officielles contre un ancien vice-président de GlaxoSmithKline34.
Une des réactions typiques de l’industrie quand des scandales éclatent dans les médias consiste à dire que ses pratiques ont changé radicalement depuis que les crimes ont été commis. C’est faux. En réalité, le nombre de crimes augmente de manière vertigineuse. D’après le Public Citizen’s Health Research Group, trois quarts des 165 règlements totalisant des pénalités de 20 milliards de dollars sur une période de 20 ans entre 1991 et 2010 se sont produits dans les cinq dernières années de cette période93. Une mise à jour a démontré qu’en 21 mois seulement, soit jusqu’en juillet 2012, on était arrivé à des règlements totalisant 10 milliards de dollars additionnels94.
Comparés à l’industrie pharmaceutique, les médecins ne font pas délibérément du mal à leurs patients. Et quand ils en font, que ce soit par accident, par ignorance, ou par négligence, ils ne font du mal qu’à un patient à la fois. Comme les actions des directeurs de l’industrie pharmaceutique ont le potentiel de faire du tort à des milliers, voire à des millions de gens, leurs normes d’éthique devraient être beaucoup plus élevées que celles des médecins. Dès lors, l’information qu’ils donnent sur leurs médicaments devrait être aussi conforme à la réalité que possible après un examen méticuleux et honnête des données. Rien de tout cela n’est actuellement le cas, et quand des journalistes me demandent ce que je pense des normes d’éthique de l’industrie pharmaceutique, je fais souvent une blague en disant que je ne peux pas décrire ce qui n’existe pas. La seule norme de l’industrie, c’est l’argent, et votre talent est évalué en fonction de la quantité d’argent que vous rapportez à la compagnie. L’industrie pharmaceutique compte une foule de gens honnêtes et respectables, mais ceux qui se hissent au sommet ont été décrits comme autant de « salauds impitoyables » par le criminologue John Braithwaite, qui en a interviewé plusieurs17. Aux États-Unis, les grandes pharmaceutiques surpassent toutes les autres industries en termes de criminalité. Elles comptent plus du triple d’infractions sérieuses ou modérément sérieuses que les autres compagnies, et ce score se maintient même quand on ajuste en fonction de la taille de l’entreprise12, 61. Les grandes compagnies pharmaceutiques ont aussi la pire feuille de route parmi les autres compagnies en ce qui touche la corruption et les pots-de-vin internationaux, ainsi qu’en termes de négligence criminelle pour avoir fabriqué des médicaments de manière dangereuse12. Sur une période de cinq ans, de 1966 à 1971, la FDA a dû rappeler 1 935 produits médicamenteux, dont 806 pour adultération ou contamination, 752 à cause d’une activité thérapeutique inférieure ou supérieure, et 377 pour des erreurs d’étiquetage61.
La corruption est routinière et implique d’importantes sommes d’argent. Presque toutes les catégories de gens qui peuvent affecter les intérêts de l’industrie ont été corrompues : des médecins, des administrateurs hospitaliers, des ministres, des inspecteurs, des douaniers, des répartiteurs, des officiels responsables de l’homologation, des inspecteurs d’usine, des fonctionnaires chargés de l’établissement des prix, et des partis politiques. En Amérique latine, le poste de ministre de la Santé est très convoité, étant donné que ce ministre devient presque invariablement riche d’une fortune provenant de l’industrie pharmaceutique12.
Au début du chapitre, j’ai posé la question qui consiste à savoir si on est en présence d’une pomme pourrie isolée par-ci par-là, ou encore si le panier est pourri en entier. Ce qu’on peut observer, c’est du crime organisé au sein d’une industrie corrompue jusqu’au cœur.
Chapitre 20 Démolir les mythes de l’industrie
Les mythes de l’industrie pharmaceutique au sujet de ses activités et de ses motivations ont été si souvent répétés qu’ils sont largement crus par les médecins, les politiciens et la population générale. Puisqu’ils constituent un obstacle empêchant la création d’un système de soins de santé rationnel, libre de toute corruption, je vais démolir les plus pernicieux avant de suggérer des réformes dans le prochain chapitre.
Mythe 1 : Les médicaments sont dispendieux en raison des coûts élevés de leur découverte et de leur mise au point
L’ancien PDG de Merck, Raymond Gilmartin, a reconnu qu’il s’agit là d’un mythe : « Le prix des médicaments n’est pas déterminé par leurs coûts de recherche. Il est plutôt déterminé par leur valeur en prévention et en traitement de la maladie1. » Gilmartin a oublié de mentionner que les prix des médicaments reflètent non seulement ce que la société est prête à payer mais aussi l’excellence des compagnies à se protéger de la concurrence. Les activités pour combattre la concurrence sont largement répandues2,3 et la fixation des prix est habituelle4,6.
Nous entendons souvent dire qu’il en coûte 800 millions de dollars (en dollars de l’an 2000) pour introduire un nouveau médicament sur le marché, mais c’est un mensonge. Ce coût est fondé sur des méthodes défectueuses, une théorie comptable discutable et sur une foi aveugle en la validité d’informations confidentielles fournies par l’industrie à ses consultants en économie de deux universités à la solde de cette même industrie1,3,7. Le vrai coût est probablement inférieur à 100 millions de dollars3.
La zidovudine, le premier médicament du SIDA, a été synthétisée à la Fondation du cancer du Michigan en 19643. Il en a coûté très peu à Burroughs Wellcome pour la mettre au point, mais la compagnie a quand même exigé 10 000 $ par an pour traiter un patient en 19871. Il s’agissait d’un abus manifeste d’une situation de monopole à l’encontre des patients désespérément malades exigeant le médicament quel qu’en soit le coût. En 2003, quand Abbott augmenta subitement de 400 % le prix de son médicament contre le SIDA, dont l’invention avait été soutenue par des millions de dollars payés par les contribuables, elle provoqua un tumulte et des centaines de médecins ont décidé de boycotter tous les produits d’Abbott dans la mesure du possible8.
Un exemple de même nature est celui de l’imatinib (Glivec ou Gleevec) très efficace contre la leucémie lymphoïde chronique. Novartis l’avait synthétisé, mais n’était pas intéressée par ce produit jusqu’à ce qu’un hématologiste l’étudié et trouve qu’il était très efficace. Encore là, les coûts de la mise au point furent minimes, mais cela n’empêcha pas Novartis d’exiger 25 000 dollars pour le traitement d’une année, en 20023.
Le Taxol est l’un de nos médicaments les plus utiles contre le cancer. Il a été dérivé de l’écorce de l’if du Pacifique et plus tard synthétisé par des scientifiques financés par le NIH1. Le médicament fut donné à Bristol-Myers Squibb qui, en dépit des coûts minimes de sa mise au point, exigea de 10 000 à 20 000 dollars par année de traitement en 1993. Quand son brevet expira, la compagnie poursuivit toute personne qui se proposait de mettre en marché une version générique moins coûteuse9. Vingt-neuf États américains ont poursuivi Bristol-Meyers Squibb pour infraction à la loi contre les monopoles, mais pendant que les procédures se déroulaient et une fois que la poursuite fut réglée à l’amiable pour un coût de 135 millions de dollars pour la compagnie, elle en avait tiré un revenu excédant 5 milliards de dollars.
Une fois que plusieurs compagnies qui mettaient en marché des versions génériques du citalopram les eurent retirées du marché danois, en 2010, pour diverses raisons, le prix du médicament augmenta subitement par un facteur de 12. Les compagnies qui ont augmenté le prix ont refusé de commenter10.
Un autre exemple bizarre qui a été relevé : toutes les compagnies vendant de la simvastatine générique, utilisée par près de 6 % de tous les Danois, augmentèrent le prix de la dose de 40 mg par un facteur de 811. La dose de 40 mg était la plus couramment utilisée. Le médicament était aussi disponible en dose de 20 mg et se vendait le cinquième du prix mais en vertu de la loi, les pharmacies n’avaient pas le droit de distribuer la dose moins coûteuse ni de dire aux patients de prendre deux comprimés au lieu d’un. Bien que les cinq compagnies aient augmenté les prix exactement au même niveau, à la seconde décimale près, elles nièrent s’être entendues pour fixer les prix et les autorités ont lancé une enquête12. Cette manœuvre déloyale allait coûter aux contribuables danois une somme additionnelle de 63 millions de dollars chaque année, pour un médicament hors brevet.
Schering acheta une hormone d’une autre société pour l’utiliser chez les femmes souffrant de symptômes de la ménopause et vendit le médicament avec une majoration de 7 000 %4. Par ailleurs, quand le Librium et le Valium furent brevetés, Roche les vendit en Colombie à un prix 65 fois plus élevé que le prix en Europe6. En 2006, la Commission fédérale du commerce des Etats-Unis lança une poursuite judiciaire contre Lundbeck pour le motif que la compagnie aurait pris avantage d’une situation de monopole pour exploiter les nourrissons gravement malades13. Lundbeck avait acheté une entreprise américaine qui avait augmenté le prix d’un vieux médicament capable de sauver la vie, l’indométacine de 1300% après l’avoir acheté de Merck. Il n’existait aucun coût de mise au point pour expliquer ces explosions de prix.
Pendant des années, les obstétriciens avaient utilisé une hormone naturelle pour la prévention de la naissance prématurée, la progestérone, arrivée sur le marché, il y a plus de 50 ans14. Les pharmacies la préparaient pour les médecins et elle coûtait de 10 à 20 dollars par injection. Quand la société KV Pharmaceuticals obtint du gouvernement américain l’approbation de l’exclusivité de la vente du médicament sous le nom de Makena, le prix grimpa à 1 500 dollars la dose, une augmentation de 75 à 150 fois. La compagnie prétexta de façon grotesque que les « mamans » méritaient de profiter des avantages d’un Makena approuvé par la FDA alors que les médecins disaient que l’arrangement allait probablement susciter plus de naissances prématurées (et en conséquence plus d’enfants souffrant de lésions cérébrales) puisque de nombreuses femmes ne pourraient pas payer le médicament. Certains médecins étaient heureux de pouvoir obtenir la version moins coûteuse auprès des pharmacies qui la préparaient mais la compagnie réagit en envoyant des lettres de mise en demeure aux pharmacies les prévenant qu’elles pourraient être confrontées à des injonctions de la part de la FDA si elles persistaient à préparer le médicament.
Nous sommes tous responsables de la société compliquée que nous avons créée, dans laquelle nous dépendons tous les uns des autres tout en tirant avantage de la spécialisation. Mais quand les compagnies pharmaceutiques extorquent des prix exorbitants pour leurs médicaments, elles se moquent de leurs obligations envers les patients, les contribuables, nos sociétés et notre patrimoine collectif à un tel point qu’elles finissent par s’exclure elles-mêmes de la société, tout comme les criminels le font. C’est du vol.
Des chercheurs ont montré que le coût annuel par patient est inversement lié à la prévalence de la maladie. Des chercheurs italiens sont allés une étape plus loin et ont mis au point une formule simple qui s’ajuste très bien aux données qu’ils possédaient pour 17 remèdes contre le cancer :15
Calcul du coût annuel par patient = 2 millions d’€ x (e-0,004 nombre de patients + 10 000 €)
Le coût annuel par patient d’un médicament pour lequel il existe 900 patients en Italie sera d’environ 60 000 euros.
Dans la même veine, les médicaments pour les patients souffrant d’insuffisances enzymatiques rares sont épouvantablement dispendieux, par exemple 600 000 $ par année pour traiter la maladie de Gaucher16, bien que toute la recherche et la mise au point initiale aient été effectuées par des chercheurs financés par le NIH1.
Le dernier mot pour détruire le mythe selon lequel les prix des médicaments reflètent les coûts de la recherche et de la mise au point est : « Que peut-on dire des coûts beaucoup plus élevés encourus pour promouvoir les ventes3 ? Ceux qui paient les médicaments paient aussi pour ce marketing extravagant. Si les nouveaux médicaments étaient vraiment aussi bons que l’industrie veut nous le faire croire, il n’y aurait aucun besoin d’en faire la promotion ni de corrompre les médecins pour qu’ils les utilisent. »
Mythe 2 : Si l’on n’utilise pas les médicaments coûteux, l’innovation va se tarir
Les politiciens et les médecins adhèrent largement à ce mythe, bien qu’il soit complètement ridicule. Est-ce qu’ils seraient disposés à payer 20 fois plus cher leur nouvelle voiture pour le seul motif que, selon leur vendeur, les voitures seraient de bien meilleure qualité dans l’avenir ?
Selon Marcia Angell, ancienne rédactrice en chef du New England Journal of Medicine, l’industrie pharmaceutique insiste pour qu’on la laisse tranquille, sans aucun contrôle social et elle menace aussi nos sociétés. « Ne nous importunez pas. Ne touchez pas à nos profits outranciers. N’intervenez pas sur les augmentations insoutenables de prix sinon nous ne vous donnerons pas vos traitements miraculeux17. » Habituellement, les compagnies prétendent : « Si nous ne dépensons pas notre argent en recherche, nous disparaîtrons. » Les compagnies pharmaceutiques, elles, disent : « Si nous n’avons pas votre argent pour le dépenser en recherche, vous disparaîtrez7. »
Les dirigeants religieux ne sont pas les seuls à être malins. Ils promettent que nous serons récompensés après notre mort, ce qui rend impossible de se plaindre. Les promesses de l’industrie sont aussi fausses, en fait, tellement fausses que c’est la relation cause/effet qui est inversée. Depuis les années 1980, les profits de l’industrie pharmaceutique ont monté en flèche (voir le chapitre 5) mais pendant la même période de moins en moins de médicaments innovateurs ont été introduits sur le marché3. La revue Prescrire remet chaque année un prix à la percée la plus importante, la Pilule d’Or, mais elle ne parvint pas à trouver un candidat qui le mérite en 2012. Ni en 2011. Ni en 2010.
En 2011, les régions du Danemark ont suggéré de créer un organisme comme le NICE (National Institute for Health and Care Excellence) du Royaume-Uni puisque nous ne pouvons pas nous payer tout ce qui est offert. Toutefois, un orateur conservateur en santé du Parlement ne voulait pas qu’on établisse des priorités pour les médicaments, argumentant que cela ralentirait la mise au point de nouveaux médicaments si on introduisait un montant maximum à payer pour les médicaments18. Les régions suggéraient en outre que les nouveaux médicaments soient comparés aux médicaments existants, souvent moins coûteux avant qu’on autorise leur mise en marché. Cette proposition mit en colère le directeur de l’Association danoise de l’industrie pharmaceutique, Ida Sofie Jensen, qui dit qu’il était « regrettable sinon effronté que les régions du Danemark manifestent, une fois encore, leurs attitudes hostiles à l’industrie. Les régions blâment l’industrie pour leur économie médiocre19. » Le président des régions répliqua posément que l’industrie pharmaceutique est l’une des plus profitables de toutes les industries et qu’il espérait que la danse tribale rituelle de l’industrie s’achève bientôt. Le fait est que les coûts des médicaments des hôpitaux danois ont triplé en seulement 8 ans. L’année précédente, le gouvernement danois avait mis fin au remboursement de certains médicaments trop dispendieux et pas meilleurs que des médicaments moins coûteux du même type. En réponse, Ida Sofie Jensen entama une autre danse rituelle : « Les autorités refusent de payer pour les progrès des médicaments. Nous craignons que cela arrête la mise au point de nouveaux médicaments20. » En revanche, un économiste de la santé mentionna que ce geste pourrait inciter l’industrie à chercher de vraies percées plutôt que se confiner aux médicaments d’imitation. C’est l’argument fondamental. L’innovation s’est tarie parce qu’il est beaucoup plus lucratif pour l’industrie de mettre au point des médicaments d’imitation plutôt que de mener de la recherche d’innovation. Les patients profiteront du retrait de cet incitatif.
Partout dans le monde, à l’exception des Etats-Unis sous gouverne républicaine, les gouvernements s’emploient à contenir les coûts des médicaments. Un article de 2011 a rapporté que la République tchèque introduirait des prix maximums pour les médicaments remboursés et limiterait l’utilisation des médicaments très coûteux aux hôpitaux universitaires. En Allemagne, un prix plafond a été introduit dans l’objectif d’épargner 2 milliards d’euros chaque année. Au Royaume-Uni, le gouvernement a exigé que l’industrie réduise ses prix, visant à épargner 6 milliards de dollars chaque année. En Australie, le gouvernement a mis fin au remboursement de 162 médicaments et se propose de réduire les prix de 1600 médicaments de 27 %21. La Chine, la Hongrie, la Bulgarie et la Slovaquie avaient aussi des plans de réduction des coûts.
Le moyen auquel la Nouvelle-Zélande a eu recours pour restreindre ses dépenses en médicaments est impressionnant et simple22. En 1993, on a décidé de subventionner les médicaments d’une même classe (par exemple, les AINS ou les ISRS) qui avaient des effets similaires avec le même montant, peu importe le prix du médicament (prix de référence). En outre, les compagnies pharmaceutiques devaient négocier avec l’agence du médicament, le prix et les conditions d’accès. Cette politique a eu des effets spectaculaires. Les statines étaient fournies pour la moitié du coût en Australie, et le prix des médicaments génériques était moindre du quart du prix au Canada. Le budget communautaire des médicaments n’augmenta que de 2 % par an par comparaison à 15 % avant l’adoption de la politique sans compter qu’on améliorait entre-temps la protection de la population. Bien que le pays ne compte que 4,4 millions d’habitants, les économies annuelles atteignent presque 1 milliard d’euros.
Mythe 3 : Les économies sont plus élevées que les coûts des médicaments dispendieux
Lors d’une rencontre avec l’industrie pharmaceutique où cet argument fut proposé, le directeur du Conseil national danois de la santé affirma qu’il était curieux que peu importe le prix élevé d’un nouveau médicament, la compagnie était toujours en mesure de fournir une analyse pharmaco-économique montrant que les économies en termes de réductions des congés maladie, des départs prématurés à la retraite et ainsi de suite, excédaient les coûts du médicament. L’économique est une discipline très fluide et l’on peut obtenir à peu près n’importe quel résultat qu’on désire selon les postulats que l’on introduit dans le modèle. Il est difficile d’imaginer pire conflit d’intérêts que la situation dans laquelle une compagnie pharmaceutique procède à une analyse pharmaco-économique de son propre médicament, ou bien demande à un économiste de la réaliser moyennant rémunération. Le résultat n’est jamais défavorable à la compagnie.
Mythe 4 : Les percées proviennent de la recherche financée par l’industrie
Selon un argument largement répandu, aucun de nos médicaments n’a été inventé par les anciens pays socialistes de l’Est du Rideau de fer. Cela ne prouve rien. Tellement d’autres choses ne fonctionnaient pas dans ces pays sous la dictature. Ce malentendu est colossal. Presque toute la science fondamentale qui soutient le progrès de la médecine moderne se développe dans le secteur à but non lucratif, dans les universités, les instituts de recherche et les laboratoires gouvernementaux23. Un rapport du Congrès des États-Unis de l’an 2000 soulignait que « des 21 médicaments les plus importants lancés entre 1965 et 1992,15 avaient été mis au point à partir de connaissances et de techniques provenant de la recherche financée par le gouvernement fédéral ». D’autres études arrivent à des conclusions similaires, par exemple qu’au moins 80% de 35 médicaments majeurs étaient fondés sur des découvertes réalisées par la recherche d’organismes du secteur public24. L’Institut national du cancer a tenu un rôle de chef de file dans la mise au point de 50 des 58 nouveaux médicaments contre le cancer ayant été approuvés par la FDA entre 1955 et 20017.
Trois des découvertes les plus importantes du XXe siècle – la pénicilline, l’insuline et le vaccin contre la polio – proviennent toutes de laboratoires financés par les fonds publics. Le NIH réalisa une étude des cinq médicaments les plus vendus en 1995, le Zantac (ranitide pour les ulcères d’estomac), le Zovirax (acyclovir pour l’herpès), le Capoten (captopril pour l’hypertension artérielle), le Vasotec (énalapril pour l’hypertension artérielle) et le Prozac (fluoxétine pour la dépression) et trouva que 16 des 17 articles scientifiques primordiaux menant à la découverte et la mise au point de ces médicaments provenaient d’autres sources que l’industrie3.
Le tableau est très constant. Les premières percées pour le SIDA survinrent aussi dans la recherche publique et le gouvernement américain a dépensé deux fois plus en recherche que toutes les compagnies pharmaceutiques mises ensemble7. L’histoire typique est que les compagnies pharmaceutiques investissent relativement peu dans les vraies percées mais quand elles en dessaisissent la recherche publique, elles vendent le médicament à un prix exorbitant puisqu’elles disposent d’un monopole. De plus, elles mentent d’une manière routinière au sujet de la recherche et volent souvent le mérite de la découverte du médicament en prétendant qu’elles l’ont découvert elles-mêmes7. Les très racoleurs partenariats public-privé volent en éclats quand le partenaire privé se sauve constamment avec tout l’argent et tout le mérite, plaçant le reste de la société dans le rôle de l’imbécile qu’on a dépouillé.
Les compagnies pharmaceutiques ne dépensent que 1 % de leurs revenus en science fondamentale pour découvrir de nouvelles molécules, quand on défalque les subsides des contribuables et plus des quatre cinquièmes de tous les fonds pour la recherche fondamentale pour découvrir de nouveaux médicaments ou de nouveaux vaccins proviennent de sources publiques25.
Une raison importante expliquant pourquoi la plupart des percées proviennent de la recherche financée par le public est que le capitalisme et la curiosité cohabitent très mal. Cela prend du temps pour être curieux et les dirigeants des sociétés pharmaceutiques n’ont pas de patience. Ils veulent un retour rapide sur leurs investissements, retour qui les aidera à accéder à d’autres positions plus lucratives dans d’autres compagnies. Les administrateurs ont donc tendance à mettre fin à une orientation de recherche quand il n’y a pas eu de progrès après un couple d’années.
Les psychologues ont montré que l’argent est une piètre motivation par comparaison avec le fait de donner aux gens des tâches intéressantes à réaliser et les scientifiques sont radicalement différents des administrateurs. Le salaire importe peu. Ce qui importe c’est la résolution d’énigmes et la contribution de choses qui importent au monde. À titre d’exemple, il fallut plus de 20 ans à un scientifique infatigable, Eugene Goldwasser, pour produire et purifier le premier petit flacon d’érythropoïétine humaine7.
Mythe 5 : Les compagnies pharmaceutiques se font concurrence dans un marché libre
Ce mythe est utilisé avec succès pour réduire la réglementation sous la croyance erronée que les forces du marché vont résoudre tous les problèmes. Il ne peut exister de marché libre pour des produits qui sont lourdement subventionnés par l’argent des contribuables et quand la fraude et les crimes sont très répandus.
Quand j’ai travaillé dans l’industrie, j’ai été surpris de constater comment on établissait le prix d’un médicament. Les administrateurs des ventes produisaient ce qu’ils appelaient un budget des ventes pour les années à venir et je me demandais comment ils parvenaient à faire un budget pour de l’argent qu’ils ne possédaient pas mais qu’ils ne pouvaient qu’espérer obtenir. Pourtant, une fois accepté, il importait de vivre à la hauteur de ce budget, sinon les questions embarrassantes viendraient et les gens seraient malheureux. Il existe une solution simple pour les ventes qui stagnent : augmenter le prix du médicament et convenir avec les concurrents les plus importants d’augmenter leurs prix du même montant et tout le monde sera content. C’est illégal mais très difficile à prouver, donc c’est très commun. Même moi, j’ai observé cette pratique, bien que je n’aie jamais été responsable d’un budget des ventes.
Mythe 6 : Les partenariats public-industrie sont avantageux pour les patients
Ce mythe ne meurt jamais et l’on a en vu un des exemples les plus effrontés en 2012 quand l’Association britannique de l’industrie pharmaceutique (ABPI) a publié une nouvelle consigne pour promouvoir la collaboration avec les médecins26,27. Elle parlait des objectifs communs et exhortait les professionnels de la santé « à ne pas se laisser séduire par les mythes négatifs concernant la coopération avec l’industrie ». Elle fut endossée par plusieurs y compris l’Association médicale britannique, le Collège royal des généralistes, l’Académie des collèges royaux et le ministère de la Santé et sous le logo du Lancet furent publiées des prétentions scandaleuses comme « l’industrie tient un rôle valide et important dans la formation médicale » et « les représentants de produits médicaux peuvent être des ressources utiles aux professionnels de la santé ».
Sous un titre libellé « Les faits », la consigne présente en premier lieu deux énoncés mensongers : « Des occasions peuvent être ratées ou même rejetées en raison de méprises découlant de pratiques historiques qui ne sont plus acceptables ou d’actions de quelques individus qui ne sont pas des modèles de collaboration entre l’industrie et les professionnels des soins de santé. »
Ces pratiques ne sont pas historiques ni atypiques. En outre, la consigne prétend « refléter la détermination de l’industrie d’assurer que les relations avec les professionnels de la santé sont fondées sur l’intégrité, l’honnêteté, la connaissance, des comportements intègres, la transparence et la confiance ». On nous dit aussi que « toutes les études sont assujetties à une surveillance rigoureuse, les résultats des études cliniques contrôlées sont disponibles dans le domaine public, le code de pratique de l’ABPI requiert la divulgation des détails des études cliniques. » La réalité est qu’on ne voit jamais les détails des études cliniques, des quantités de résultats sont enterrés et scellés avec grande efficacité dans les archives des compagnies comme s’il s’agissait de déchets nucléaires et les études ne sont jamais soumises à une surveillance scrupuleuse puisque les comités d’éthique ne la font pas ni ne disposent de l’expertise pour la faire.
Les prétentions de la consigne stipulant que « lorsqu’on le fait correctement, travailler avec l’industrie ne nuira pas à l’objectivité de la prise de décision clinique » et que les règlements garantissent que les normes professionnelles et éthiques seront maintenues, sont contredites par tout ce que l’on connaît sur ce sujet. On nous dit aussi que : « L’investissement de l’industrie pharmaceutique est la source de la plupart des percées scientifiques et des innovations des médicaments et qu’il en coûte habituellement 550 millions de livres sterling pour faire tout le travail nécessaire pour qu’un médicament soit autorisé à être utilisé. »
Je n’ai jamais vu autant de foutaise et de mensonges rassemblés au même endroit en même temps. Les partenariats peuvent être occasionnellement avantageux pour les deux parties, mais dans l’ensemble, il est immensément nuisible pour les patients que les milieux dirigeants endossent les méthodes de l’industrie relativement à ses médicaments. L’idée que la santé publique et l’industrie pharmaceutique aient un agenda commun est une fiction de relations publiques et le système de santé du Royaume-Uni est déjà au dernier niveau de l’éthique. En 2012, le gouvernement du Royaume-Uni annonça qu’on attendait des praticiens généraux qu’ils travaillent avec l’industrie pharmaceutique pour identifier comment traiter leurs patients28. Selon le guide de l’ABPI, soutenu par le ministère de la Santé, des « aires populaires de travail conjoint que vous pourriez envisager comprennent l’identification des patients non diagnostiqués, la révision des patients non contrôlés, l’amélioration de l’adhésion des patients aux régimes thérapeutiques et le réaménagement des plans de traitement. » Cela suppose le fait d’inviter les vendeurs à parcourir la liste des patients des omnipraticiens pour identifier ceux qu’ils estiment devoir recevoir les médicaments de la compagnie.
Les Britanniques doivent vivre sur une autre planète que la nôtre. Ils devraient lire le chapitre 12 de mon ouvrage à propos du Neurotin pour tout ce qui provient des endroits où les visiteurs médicaux se sont concertés avec les médecins et leurs patients pour leur suggérer ce qu’ils devaient faire. Ce qu’il nous faut faire est exactement le contraire. Identifier les patients sur-diagnostiqués et sur-traités et les débarrasser de la plupart —sinon de tous— leurs médicaments, et leur enseigner qu’une vie sans médicaments est possible pour la plupart d’entre nous.
Dans son livre, Bad Pharma, Ben Goldacre écrit que les gros canons, le gratin de l’excellence de la médecine britannique savent fort bien quels sont les problèmes relatifs à tout cela mais ils ont décidé de ne pas s’en mêler. Ce faisant, tous comme les régulateurs, ils contribuent au secret entourant ce que les compagnies pharmaceutiques infligent à la santé publique28. Il est difficile d’imaginer pire trahison. Si j’étais un omnipraticien au Royaume-Uni, je changerais d’emploi ou je quitterais le pays.
En 2012, la Fédération internationale du diabète, l’organisme-parapluie de plus de 200 associations du diabète dans plus de 160 pays a amorcé un partenariat avec Nestlé qui met en marché d’une manière énergique les friandises denses en énergie et les breuvages sucrés29. Nestlé a provoqué bien des décès dans les pays en développement avec sa promotion contraire à l’éthique de formules de lait pour nourrissons, lesquelles exigeaient l’addition d’une eau propre qui souvent n’était pas disponible. Peut-être que nos associations pulmonaires devraient suivre la mode et devenir partenaires de l’industrie du tabac ? Pourquoi pas ? Les politiciens s’en réjouiraient.
Mythe 7 : Les études de médicaments ont pour but d’améliorer le traitement des patients
La documentation des relations publiques et les ententes de collaboration entre les associations de médecins et les associations de l’industrie propagent ce mythe30. Toutefois, peu importe ce que raconte l’industrie pharmaceutique à propos du travail pour le bien des patients, elle n’a pas plus de responsabilité pour surveiller la santé de la population que n’en dispose l’industrie de la restauration rapide pour surveiller la diète du public31. Et elle n’est pas vraiment intéressée non plus. Une étude est conçue ou bien pour maximiser les ventes ou bien elle est mise au point pour identifier la meilleure manière de prévenir ou de traiter une maladie précise.
Quand on recrute des patients pour une étude, un avantage de la participation est presque toujours décrit dans le document de consentement dans lequel on stipule que le participant à la recherche va contribuer à la connaissance scientifique, laquelle va contribuer favorablement à l’amélioration des soins des autres patients. Pourtant, comme je l’ai expliqué au chapitre 5, ce contrat social avec les patients est rompu. Les études sont faites pour des motifs propres au marketing, et les résultats déplaisants sont gardés secrets ou déformés avant qu’on les publie, même quand leur disponibilité aurait pu améliorer le traitement des patients.
Un autre mythe est que l’industrie n’a aucun intérêt à tricher puisque ce serait toujours découvert et que cela nuirait aux ventes. Une des personnes qui m’ont dit cela, a effectué des études cliniques pour une compagnie pharmaceutique danoise. Il était persuadé d’avoir raison et tirait grande fierté de son travail. Tant mieux pour lui, mais il n’était pas celui qui analysait les données ni ne prenait les décisions sur la manière de les analyser ni quand les résultats étaient tellement nuisibles pour les profits qu’ils ne verraient jamais la lumière du jour à l’extérieur de la compagnie. Comme je l’ai montré dans le présent ouvrage, la vérité est que les compagnies trichent beaucoup parce qu’il est rarement possible de les attraper sans avoir accès aux données brutes et parce que c’est payant.
Mythe 8 : Nous avons besoin de plusieurs médicaments d’un même type parce la réponse des patients est variable
J’ai entendu cet argument un nombre infini de fois de la part de médecins qui ont écouté le boniment des vendeurs de pilules sans se demander si cela était vrai ou pas. Dans de rares cas, cela pourrait être vrai, mais je n’ai pas vu de données convaincantes qui le confirment. Une des études qui proposaient de montrer que les patients réagissent différemment était une étude croisée dans laquelle des patients souffrant d’arthrite rhumatoïde ont expérimenté quatre médicaments et dit aux chercheurs la période qu’ils avaient préférée32. Cela ne prouve rien puisque l’intensité de la douleur varie. Pour être certain que les préférences ne sont pas qu’un bruit de fond, il faudrait exposer les mêmes patients aux mêmes médicaments plus d’une fois.
Mythe 9 : Ne pas utiliser les médicaments génériques parce que leur puissance varie
Pfizer a déjà prétendu que ses propres tests de produits génériques contenant la même substance active qu’un médicament de Pfizer contre l’étourdissement avaient montré que 10 de 17 produits génériques ne parvenaient pas à satisfaire aux normes de puissance6. Comparons cela avec le fait que les agences du médicament s’assurent que les produits génériques sont bio équivalents au médicament original en exigeant des études comparatives chez des volontaires humains, dans lesquelles on mesure les concentrations de substance active dans le sang des participants.
Plusieurs médecins croient ces balivernes rejetées à répétition par des scientifiques sans conflit d’intérêts qui ont mené les études de biodisponibilité.
Mythe 10 : L’industrie paie la formation médicale continue parce que les fonds publics ne le font pas
Si cela était vrai, ce serait un geste d’immense générosité parce c’est très coûteux et que cela influence la plupart des médecins. Comme je l’ai expliqué au chapitre 8, ce que cela signifie est tellement manifeste que même les organismes représentant l’industrie pharmaceutique ne le nient pas tout en reconnaissant que c’est leur manière de diriger leur commerce. Trois des plus grosses agences de publicité des Etats-Unis administrant des contrats publicitaires pharmaceutiques investissent dans des organismes de recherche contractuelle et préparent des ensembles « éducatifs » pour l’industrie pharmaceutique3.
Comme Marcia Angell l’a affirmé en entrevue, les compagnies élaborent une gigantesque fiction en tentant de faire croire qu’elles ne s’en tiennent pas qu’à vendre des médicaments mais qu’elles sont aussi engagées dans la formation médicale17. Les investisseurs attendent d’elles qu’elles fassent d’aussi gros profits que possible en vendant des médicaments. Mais elles sont aussi parvenues à convaincre une foule de gens qu’elles s’occupent aussi de les éduquer. Cela n’est pas possible. C’est comme si on demandait aux brasseurs de bière de faire de la formation sur l’alcoolisme. De plus un conflit d’intérêts ressort. Les compagnies pharmaceutiques pourraient « former » les médecins sur les médicaments aussi longtemps qu’elles ne discutent que des avantages mais iront-elles jusqu’à dire : « Notre médicament n’est pas vraiment très bon ; une autre compagnie en produit un bien meilleur ? » Non. Cela n’arrivera pas.
[…]
Lisez ce livre et faites-le connaître autour de vous : c’est renversant. ÉC.
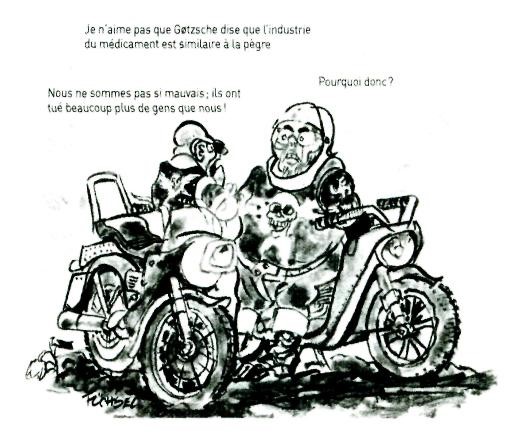

Peter C. Gøtzsche
[Abus de pouvoir, violence d’État, oppression] Intimider les gens avec des menaces et du chantage pour obtenir un « oui » de force, c’est la méthode criminelle de la MAFIA, et c’est très précisément de L’EXTORSION, punie par le code pénal, art. 312 et suivants (circonstances aggravantes)
Intimider les gens avec des menaces et du chantage pour obtenir un « oui » de force, c’est la méthode criminelle de la MAFIA, et c’est très précisément de L’EXTORSION, punie par le code pénal, art. 312 et suivants (circonstances aggravantes, à lire attentivement aussi) :
Formulez vous-même (à partir des articles du code pénal ci-dessous) la qualification juridique correcte de la politique du « Pass sanitaire », imposée par des tyrans pour nous forcer tous à la vaccination (sans le reconnaître et sans en assumer la responsabilité) :
Code pénal
Article 312–1
L’extorsion est le fait d’obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque.
L’extorsion est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.
Article 312–2
L’extorsion est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende :
1° Lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ;
2° Lorsqu’elle est commise au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3° (abrogé)
4° Lorsqu’elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;
5° Lorsqu’elle est commise dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements.
Article 312–3
L’extorsion est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
Article 312–4
L’extorsion est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
Article 312–5
L’extorsion est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.
Article 312–6
L’extorsion en bande organisée est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende.
Elle est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’elle est commise soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.
Article 312−6−1
Toute personne qui a tenté de commettre une extorsion en bande organisée prévue par l’article 312–6 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une extorsion en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
Article 312–7
L’extorsion est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d’actes de barbarie.
Article 312–8
Constitue, au sens des articles 312−2,312−3,312−4,312−6 et 312–7, une extorsion suivie de violences l’extorsion à la suite de laquelle des violences ont été commises pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité d’un auteur ou d’un complice.
Article 312–9
La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.
Rendre des injections expérimentales obligatoires, sans endosser la pleine responsabilité personnelle des drames causés par elles, c’est un crime aggravé : l’importance vitale du CONSENTEMENT DU PATIENT est le premier principe de L’ÉTHIQUE MÉDICALE du Code de Nuremberg :
Wikipédia : « Le « code de Nuremberg » est une liste de dix critères contenue dans le jugement du procès des médecins de Nuremberg (décembre 1946 – août 1947)[1]. Ces critères indiquent les conditions que doivent satisfaire les expérimentations pratiquées sur l’être humain pour être considérées comme « acceptables »[2]. C’est sur ces critères que le tribunal condamna 16 accusés sur 23 d’avoir pratiqué ou participé à l’organisation d’expériences médicales illicites dans des conditions atroces, notamment sur les prisonniers des camps de concentration. La liste des critères de licéité des expérimentations médicales, tirée de la section « Expériences acceptables » du jugement, circula rapidement en anglais sous le nom de « Nuremberg Code ».
Le code de Nuremberg n’est nullement le point de départ de la réflexion éthique et juridique sur l’expérimentation humaine : il récapitule des principes connus et acceptés très antérieurement au jugement, depuis au moins le début du xxe siècle[3]. Toutefois, il constitue bien le premier texte à prétention universelle (internationale) sur le sujet. Ainsi, le tribunal n’a pas jugé sur des règles qui auraient été inventées spécialement pour le procès (ce qui aurait été contraire à tous les principes du droit pénal), mais selon les règles coutumières communément acceptées « dans les nations civilisées »[4].
[…]
L’importance du Code de Nuremberg réside dans le fait qu’il constitue le point de départ de la prise de conscience des dangers du progrès médical scientifique et de la nécessité de l’encadrer par des règles. C’est un code légal de droits humains et pas seulement un code de déontologie médicale destinée uniquement à des médecins[24]. Le code de Nuremberg est clairement le premier code international d’éthique médicale[21].
Les expériences médicales acceptables
La traduction moderne de référence[25] du code de Nuremberg, faite depuis le texte du jugement, est la suivante pour les 10 articles :
- Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la personne concernée doit avoir la capacité légale de consentir ; qu’elle doit être placée en situation d’exercer un libre pouvoir de choix, sans intervention de quelque élément de force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d’autres formes sournoises de contrainte ou de coercition ; et qu’elle doit avoir une connaissance et une compréhension suffisantes de ce que cela implique, de façon à lui permettre de prendre une décision éclairée. Ce dernier point demande que, avant d’accepter une décision positive par le sujet d’expérience, il lui soit fait connaître : la nature, la durée, et le but de l’expérience ; les méthodes et moyens par lesquels elle sera conduite ; tous les désagréments et risques qui peuvent être raisonnablement envisagés ; et les conséquences pour sa santé ou sa personne, qui pourraient possiblement advenir du fait de sa participation à l’expérience. L’obligation et la responsabilité d’apprécier la qualité du consentement incombent à chaque personne qui prend l’initiative de, dirige ou travaille à l’expérience. Il s’agit d’une obligation et d’une responsabilité personnelles qui ne peuvent pas être déléguées impunément ;
- L’expérience doit être telle qu’elle produise des résultats avantageux pour le bien de la société, impossibles à obtenir par d’autres méthodes ou moyens d’étude, et pas aléatoires ou superflus par nature ;
- L’expérience doit être construite et fondée de façon telle sur les résultats de l’expérimentation animale et de la connaissance de l’histoire naturelle de la maladie ou autre problème à l’étude, que les résultats attendus justifient la réalisation de l’expérience ;
- L’expérience doit être conduite de façon telle que soient évitées toute souffrance et toute atteinte, physiques et mentales, non nécessaires ;
- Aucune expérience ne doit être conduite lorsqu’il y a une raison a priori de croire que la mort ou des blessures invalidantes surviendront ; sauf, peut-être, dans ces expériences où les médecins expérimentateurs servent aussi de sujets ;
- Le niveau des risques devant être pris ne doit jamais excéder celui de l’importance humanitaire du problème que doit résoudre l’expérience ;
- Les dispositions doivent être prises et les moyens fournis pour protéger le sujet d’expérience contre les éventualités, même ténues, de blessure, infirmité ou décès ;
- Les expériences ne doivent être pratiquées que par des personnes scientifiquement qualifiées. Le plus haut degré de compétence professionnelle doit être exigé tout au long de l’expérience, de tous ceux qui la dirigent ou y participent ;
- Dans le déroulement de l’expérience, le sujet humain doit être libre de mettre un terme à l’expérience s’il a atteint l’état physique ou mental dans lequel la continuation de l’expérience lui semble impossible ;
- Dans le déroulement de l’expérience, le scientifique qui en a la charge doit être prêt à l’interrompre à tout moment, s’il a été conduit à croire — dans l’exercice de la bonne foi, de la compétence du plus haut niveau et du jugement prudent qui sont requis de lui — qu’une continuation de l’expérience pourrait entraîner des blessures, l’invalidité ou la mort pour le sujet d’expérience. »
Source : Wikipédia, https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Code_de_Nuremberg
Un consentement forcé (extorqué)
n’est pas un consentement.
Le « Pass sanitaire«
et la vaccination obligatoire
violent le plus grand principe
de l’éthique médicale universelle :
le nécessaire consentement du patient.
Fil Facebook correspondant à ce billet :
Aucun puisque c’est interdit (censure automatique)
Tweet correspondant à ce billet :
https://twitter.com/Etienne_Chouard/status/1437312039945392130
[Abus de pouvoir médical] Le cas d’Israël étudié par Pierre Chaillot (statisticien remarquable)
Chers amis,
Je travaille très attentivement toutes les analyses de Pierre Chaillot depuis presque un an (sur sa formidable chaine Décoder l’éco), et il me semble que sa réflexion — avec ses puissantes démonstrations — est la plus importante de toutes pour résister au coup d’État en cours : la maladie COVID-19, qui sert de fondement unique à toutes les décisions liberticides et catastrophiques sur terre, n’est pas plus grave que d’habitude, elle n’a entraîné nulle part de surmortalité significative. Nous constatons certes plus de morts en valeur absolue parce que nous sommes plus nombreux et parce que nous sommes plus vieux. Mais pas d’hécatombe extraordinaire : en valeurs relatives et par tranches d’âge, presque partout, la mortalité diminue (!)… La panique dans les hôpitaux ne vient pas d’un virus x ou y mais de la dévastation (volontaire !) des services publics de santé depuis 60 ans, par les politique ultralibérales de ceux-là mêmes qui prétendent aujourd’hui « défendre le service public »…
Les démonstrations de Pierre n’ont jamais été correctement contredites par personne, alors qu’elles détruisent à elles seules tout le narratif terroriste gouvernemental et donc aussi le fondement pseudo-scientifique des décisions liberticides qui nous accablent. Nous devrions tous connaître ce travail de Pierre et l’intégrer dans nos propres analyses.
Ces recherches essentielles de presque un an se prolongent ici avec l’étude (hétérodoxe) du cas exemplaire d’Israël. Accrochez vos ceintures, ça remue.
Étienne.
Des chiffres et des faits : les leçons à tirer d’Israël
ANALYSE
Nous sommes en septembre 2021, cela fait plus de 18 mois que la France, comme beaucoup de pays, vit au rythme des nouvelles mesures dites sanitaires. Pour imposer ces mesures, différents chiffres sont utilisés. Nous en avons beaucoup parlé sur cette chaîne. Nous referons un bilan de la situation française et européenne dans une prochaine vidéo. Les médias français suivent avec beaucoup d’attention la situation en Israël, en particulier concernant les différentes injections et le fameux « passe sanitaire ». Israël fait partie des tout premiers pays à imposer ce passe et à injecter une troisième dose de Pfizer à toute sa population, malgré les réticences de l’OMS et l’absence totale d’étude sur le sujet.
Pour écrire cet article, j’ai téléchargé les données disponibles en ligne sur l’office statistique israélien. Vous trouverez les liens en fin de l’article, et tous mes calculs réalisés et graphiques sont consultables en ligne. Je vous invite évidemment à tout vérifier par vous-même. Il faut télécharger les données et ensuite quelques multiplications et graphiques sur un logiciel comme Excel suffisent à retrouver ces résultats.
Nous allons commencer par voir qu’il n’y a absolument pas de problème de mortalité globale décelable en Israël depuis 2020, c’est-à-dire depuis que l’Occident a commencé à médiatiser les personnes décédées ou malades d’une infection respiratoire et dont la cause est attribuée à la Covid-19. La mortalité a toujours augmenté en Israël en période hivernale et est restée en 2020 à des niveaux comparables aux années précédentes. Ainsi, toutes les mesures prises n’ont jamais pu être motivées par un impact mesurable sur la mortalité. Il n’y a pas plus d’Israéliens qui décèdent qu’avant. Il n’y a jamais eu d’hécatombe.
Dans un deuxième temps, nous verrons ce qu’il se passe au niveau de la mortalité en période vaccinale. Nous verrons qu’en Israël, comme pour tous les pays sur lesquels nous disposons de données (comme nous l’avons montré dans la vidéo ou l’article récapitulant toutes les données européennes), la mortalité augmente pendant les périodes où des injections de masse sont réalisées. Pour les plus âgés, le doute subsiste entre corrélation et causalité, car les injections ont lieu en période hivernale pendant laquelle la mortalité habituelle est élevée également. En revanche, il est très inhabituel d’observer une hausse de mortalité chez les jeunes. Nous verrons que cette mortalité supérieure à l’habitude correspond environ à 3,8 décès pour 100 000 injections complètes sur la période pour les 20–29 ans, 2,3 pour les 30–39 ans et 1,4 pour les 40–49 ans, alors que pour ces tranches d’âges, la mortalité en période Covid-19 est indétectable. Ces travaux ont été repris à la suite de l’analyse réalisée par le Dr A. Henrion-Caude et le Dr S. Ohana et retrouvent les mêmes résultats.
Nous verrons enfin s’il existe un lien entre les injections et le nombre de cas positifs remontés par les tests des laboratoires. D’abord, nous verrons que le nombre de tests varie énormément. Il est donc tout à fait normal d’avoir plus de cas positifs lorsque l’on augmente le nombre de tests. De la même manière, le type de tests a changé cet été avec la stratégie du criblage. En France, comme ailleurs, ce changement de mesure avec plus de variants considérés positifs induit nécessairement que la positivité augmente sans que cela signifie qu’une maladie se propage. Enfin, la mise en place du Green Pass en Israël implique, comme en France, que les personnes n’ayant pas reçu d’injection font bien plus de tests que celles qui ont reçu deux injections. Dès lors, on s’attend à avoir bien plus de cas positifs en proportion chez ceux qui n’ont pas de Green Pass. Nous verrons que si nous prenons en considération ces biais, les données israéliennes ne nous montrent pas de différence notable entre les personnes considérées vaccinées et celles n’ayant pas reçu d’injection. Pour Israël, la part des personnes considérées vaccinées et positives aux tests réalisés pour la Covid-19 est la même que la part des personnes considérées vaccinées dans la population générale.
La mortalité globale en Israël : une situation complètement normale
Israël, comme l’écrasante majorité des pays occidentaux voit sa population augmenter régulièrement et vieillir. Ainsi, début 2011 il y décédait en moyenne 3 300 personnes par mois. Ce nombre a augmenté régulièrement d’environ cinq par mois pour atteindre plus de 4 000 à la mi-2021. Plus de 85 % des décès constatés viennent de personnes de plus de 60 ans.
Pour précision, toute cette analyse a pour but de mesurer les impacts de la maladie Covid-19. Ainsi tous les décès du 30 avril 2021 sont retirés de l’analyse de façon à retirer ceux dus à la tragédie de Méron.
Figure 1 : Nombre de décès mensuels en Israël

Si l’on corrige de l’évolution de la population et de la pyramide des âges, on constate que la situation récente d’Israël, du point de vue de la mortalité est complètement normale.
Figure 2 : Décès en Israël standardisés par âge, en population du 1er janvier 2021

Note de lecture : sur ce graphique sont représentés les décès chaque mois, ramenés à 30 jours et standardisés en population de janvier 2021. Par exemple, sur 30 jours Israël a comptabilisé 5304 décès en janvier 2021. En ramenant la population de janvier 2017 à celle de janvier 2021, il y aurait eu 5374 décès.
Le détail du calcul d’une standardisation par âge est disponible dans cette vidéo.
Comme tous les autres pays de l’hémisphère nord, Israël constate plus de décès pendant l’hiver que pendant l’été. Pendant cette période froide, tous les pays de l’hémisphère nord voient la mortalité augmenter en même temps. Cette hausse de mortalité ne concerne que les plus de 50 ans. Les jeunes ne sont pas concernés par des hausses de mortalité l’hiver. La mortalité des jeunes n’est pas constante. Elle est tellement faible que le moindre évènement extérieur peut la faire varier. Sur ce graphique sont représentés en bleu pâle, la mortalité mensuelle pour 100 000, avec un lissage à trois mois en bleu foncé. Les pointillés représentent les bornes d’un intervalle de confiance à 99 %, représentant une mortalité considérée « normale ».
À l’inverse, pour les plus anciens, la mortalité est nettement plus importante, stabilisant les statistiques. La forte mortalité hivernale est donc nettement visible et bien supérieure à tout impact extérieur.
Dans toutes nos analyses par âge, nous nous limiterons aux plus de 19 ans. D’une part, les moins de 19 ans ont reçu peu d’injections, mais surtout la mortalité des 0–19 ans est avant tout conditionnée par la mortalité à zéro an. La mortalité à zéro an est de loin la plus élevée dans tous les pays développés jusqu’à arriver aux âges avancés de la vie. Ainsi, c’est le nombre de naissances qui influe sur la mortalité de cette tranche d’âge, bien plus que tout évènement extérieur. Nous n’avons pas de statistiques par âge distinguant les zéro an des autres âges avant 19 ans.
Figure 3 : Taux de mortalité mensuel par tranche d’âge


Nous rappelons comme nous l’avons montré dans l’article analysant tous les pays européens, qu’il n’y a pas de déplacement visible de la mortalité. La hausse des décès l’hiver ne vient en aucun cas de quelque chose qui se déplacerait ou se transmettrait à l’échelle de la planète. Les hausses de mortalité, suédoise, portugaise ou israélienne sont synchronisées.
Cette hausse de mortalité dans l’hémisphère nord peut être décalée de plusieurs semaines ou mois selon les années. Elle semble dépendre des conditions météorologiques, nous reviendrons sur cet aspect dans d’autres travaux. Ce décalage temporel rend inexploitable le découpage des années au 1er janvier car il coupe en deux la période de forte mortalité hivernale, laissant parfois plus de décès l’année précédente, comme en 2011–2012, ou l’année suivante comme en 2016–2017.
Il est alors plus pertinent de comparer les années entre juillet et juin pour englober la totalité de la période hivernale.

Note de lecture : En considérant que la population d’Israël entre juillet 2020 et juin 2021 est restée constante au niveau de janvier 2021, il y a alors 49 979 décès sur la période. En ramenant la population d’Israël entre juillet 2017 et juin 2018, il y a 50 195 décès sur la période.
Ce graphique permet de constater que, malgré l’hécatombe mondiale de Covid-19 annoncée en mars-avril 2020, la mortalité constatée en Israël entre juillet 2019 et juin 2020 correspond à un record absolu de sous-mortalité. La mortalité constatée entre juillet 2020 et juin 2021 n’est pas un record, mais reste basse pour la décennie, comme ce que nous avions constaté pour la totalité des pays d’Europe pour lesquels nous disposons de données.
Ainsi, à aucun moment n’est visible une augmentation significative des décès en Israël. Il n’y a pas d’hécatombe, ni même la moindre augmentation inhabituelle.
Si nous repassons en données brutes et que nous comparons les décès toutes causes aux décès attribués à la Covid-19, nous observons qu’une fraction des décès a été attribuée à la Covid-19, sans pour autant que l’augmentation des décès soit inhabituelle.

Auparavant, ces hausses de mortalité étaient attribuées aux virus grippaux, aujourd’hui, ils sont attribués aux coronavirus. En représentant cette fois-ci le nombre de décès hors Covid-19 et le nombre de décès Covid-19, on découvre que toute la surmortalité hivernale habituelle est dorénavant attribuée à la Covid-19. Nous avions déjà montré ce résultat pour tous les pays que nous avons pu étudier jusqu’à aujourd’hui.

En Israël, comme partout en Europe, on ne peut pas trouver de justification aux politiques restrictives mises en place sur la base d’une augmentation inhabituelle des décès uniquement due à un nouveau virus. Il n’y a pas d’hécatombe.
La mortalité en période vaccinale : une corrélation parfaite
Nous remarquons en Israël, deux périodes distinctes de hausse de mortalité l’hiver dernier.

Une première hausse de décès en octobre, et une deuxième en janvier. Nous avions déjà remarqué que la hausse des décès en octobre a eu lieu en même temps dans tous les pays pratiquant en masse les injections antigrippales. En France, pour laquelle nous avons accès aux données des délivrances de médicaments, nous avions pu voir une proportionnalité quasi parfaite entre le nombre d’injections et la hausse de mortalité.
En Israël, nous pouvons voir que le ministère de la Santé promeut également ces injections, en particulier pour les plus de 65 ans.
On note que cette augmentation n’est visible que pour les âges auxquels l’injection est recommandée : à partir de la tranche des 70–79 ans et toutes celles au-dessus.
Figure 6 : Taux de mortalité par tranche d’âge

Cette période d’octobre 2020 est d’ailleurs la seule pendant laquelle Israël a présenté une mortalité totale standardisée différente de l’habitude. Tout le reste de la période est comparable à la décennie. Nous ne pouvons malheureusement pas explorer plus loin ce sujet, n’ayant pas accès au nombre d’injections antigrippales réalisées sur la période. Nous ne pouvons conclure qu’une corrélation temporelle parfaite pour tous les pays réalisant en masse ces injections. Les pays plus rétifs à ces injections (comme la Finlande) n’ont pas cette hausse de mortalité d’octobre 2020.

Passons maintenant aux injections contre la Covid-19 [la deuxième période de hausse de mortalité].
Les graphiques ci-dessous représentent le nombre d’injections reçues pour chaque tranche d’âge ainsi que le nombre de décès constatés pour chaque mois.
Figure 8 : nombre d’injections et taux de mortalité pour 100 000 par tranche d’âge




Toutes les tranches d’âge, sans exception, ont présenté une hausse de mortalité les mois d’injections. Nous observons que les plus âgés ont reçu massivement des injections en janvier et présentent un pic de mortalité en janvier. Les plus jeunes ont reçu des injections plus tard, à partir du mois de février et présentent un pic de mortalité en février. Ce lien est un fort indice de causalité supplémentaire entre les injections et la hausse de la mortalité.
Pour les personnes âgées de plus de 60 ans, les injections de janvier ont lieu pendant la période de forte mortalité hivernale. Il est ainsi difficile de distinguer une mortalité causée par les injections.
Pour les amateurs de modélisation, si vous représentez le taux de mortalité en fonction du taux d’injection, vous obtenez une corrélation logarithmique quasiment parfaite, avec un R² de 0,95. Cette corrélation quasi parfaite est réalisée en regardant le nombre de décès chaque mois, cinq jours après les injections.
Figure 9 : taux de mortalité pour 100 000 en fonction du nombre d’injections

Il en a fallu bien moins à certains chercheurs peu scrupuleux pour publier un article encore en ligne sur le prestigieux journal Nature, qui vante les mérites du confinement en oubliant sciemment que la mortalité hivernale diminue au printemps avec ou sans confinement. Nous en avons réalisé une analyse dans cette vidéo. Ici c’est comme si nous nous servions de ces graphiques pour prouver qu’en hiver 2020–2021, il n’y avait eu qu’une mortalité post-vaccinale pour les plus de 60 ans.
En revanche, et à l’inverse, la surmortalité observée pour les 20–49 ans ne peut pas être du fait de la mortalité hivernale, car ces derniers n’y sont pas soumis. Les 20–49 ans sont la population permettant de mieux mesurer une potentielle mortalité post-vaccinale. Cela ne signifie pas qu’elle n’existe pas pour les autres tranches d’âge, mais pour les plus âgées elle se confond avec la surmortalité hivernale.
Pour les 20–49 ans, nous allons considérer uniquement la mortalité en dehors de l’intervalle de confiance à 99 %, soit la partie au-dessus ou en dessous des pointillés rouges.
Figure 3 : Taux de mortalité mensuel par tranche d’âge

Cette mortalité sera considérée comme rare ou anormale. Pour les 20–29 ans la mortalité est totalement exceptionnelle. Seule la guerre de 2014 présente une mortalité aussi élevée. Il ne semble pas cependant qu’une guerre ait éclaté en février 2021 en Israël.
Au total, cette surmortalité entre février et avril 2021 correspond au décès de 31 jeunes de 20 à 29 ans (3,8 pour 100 000 doublement injectés), 18 de 30 à 39 ans (2,3 pour 100 000 doublement injectés) et 13 de 40 à 49 ans (1,4 pour 100 000 doublement injectés). Soit 60 décès de personnes d’une population qui n’a jamais connu de surmortalité liée à la Coivd-19.
Cette surmortalité arrive également à une période où ont été relevés par un universitaire, un nombre d’appels aux urgences largement supérieur aux années précédentes pour des arrêts cardiaques et des syndromes coronariens aigus. Si nous considérons que les décès ne sont que la partie visible de problèmes de santé, nous avons un indice de la cause possible de cette surmortalité arrivant en pleine période d’injection de masse de ces mêmes jeunes. Nous constatons qu’enfin l’ANSM admet que les péricardites sont bien rapportées post-injection. L’agence annonce qu’ils sont très rares. Il serait intéressant que l’on nous explique comment le hasard fonctionne pour montrer une si forte élévation des problèmes cardiaques juste après les périodes vaccinales.
Nous rappelons ici que cette possible surmortalité liée aux injections est du même ordre que celle évaluée par Walach et al, utilisant la pharmacovigilance des Pays-Bas. Nous en avons réalisé une vidéo explicative en expliquant au passage les biais de l’étude israélienne vantant les mérites de l’injections Pfizer. Ainsi, quelle que soit la méthode utilisée, pharmacovigilance ou étude de la mortalité toutes causes en période d’injections, les résultats concordent autour de quelques décès pour 100 000 injections. Ce nombre pourrait être entre un et trois pour les plus jeunes et certainement au-dessus pour les plus âgés, ces derniers ayant toujours une mortalité plus élevée quelle que soit la cause.
Il faut enfin rappeler que les décès sont la plupart du temps le dernier stade de la dégradation de l’état de santé. Il est rare de constater qu’un évènement soit complètement binaire entre « bonne santé » et « décès ». Constater une hausse des décès n’est certainement que la seule partie visible d’une hausse beaucoup plus importante de situations intermédiaires. Les AVC, myocardites, embolies pulmonaires ou thromboses non mortelles sont invisibles dans cette étude. Elles sont rapportées en pharmacovigilance et la hausse de mortalité constatée ajoute un haut degré de certitude à la causalité pour les évènements non mortels également.
Efficacité des injections : l’absence de données probantes
Les médias et politiques commentent en permanence le nombre de tests positifs, appelant ces derniers des « cas de Covid-19 ». Nous avons détaillé dans une vidéo le fossé séparant un résultat de test RT-PCR positif et une personne malade de la Covid-19. De plus, ce nombre de « cas » est évidemment dépendant du nombre de tests effectués.
Ainsi, malgré l’absence totale de surmortalité cet été, Israël est passé à plus de 100 000 tests effectués par jour avec une montée en charge progressive. Cette montée en charge a naturellement augmenté le nombre de tests positifs cet été, sans que cela ne signifie la moindre augmentation de malades.

Le changement complet de la mesure avec la stratégie de criblage a également eu pour impact de faire remonter le taux de positivité qui était à moins de 2% au mois de juillet et à plus de 5% en août. Les journalistes et politiques en ont conclu à une explosion du nombre de malades, alors qu’il ne s’agit que d’un changement de stratégie de comptage.

Le dernier biais au sujet des tests concerne le public testé. Depuis le début des campagnes d’injections, l’efficacité de ces produits est présupposée. Il serait important de rappeler aux dirigeants et aux médecins, qu’accepter des résultats de l’efficacité de n’importe quel produit, venant de la part de la personne qui souhaite vous vendre le produit, cela s’appelle au mieux de la naïveté. De même qu’accélérer la distribution de ce produit en empêchant d’avoir le temps de revérifier par d’autres études indépendantes si cela fonctionne et que ce n’est pas dangereux.
Le fait de présupposer que ces injections fonctionnent, a lancé un certain nombre de règles et de certitudes chez les gens qui font que les personnes qui n’ont pas reçu les injections sont testées beaucoup plus souvent que les autres.
Vous avez certainement, comme moi, des collègues, des amis qui ont eu des symptômes de maladies post-injection, comme une fatigue intense, des maux de tête ou de la fièvre. Ces symptômes juste après l’injection sont considérés très fréquents par l’ANSM. Cependant, les personnes tout juste injectées et présentant ces symptômes n’ont évidemment pas ou peu fait de tests, puisque leurs maux étaient attribués aux suites de l’injection. Au contraire, sur la même période, les personnes avec les mêmes symptômes, mais qui n’avaient pas fait d’injections, ont beaucoup plus souvent fait des tests.
Pendant les périodes d’injections, parmi les personnes qui font des tests, nous avons donc beaucoup plus de personnes sans injections que de personnes déjà injectées. Par construction, le nombre de positifs va nécessairement être plus important chez les non-injectés puisqu’ils sont bien plus nombreux à faire des tests.
Pour Israël, cette période correspond à janvier-février 2021. Par exemple, pendant la semaine du 21 au 27 février 2021, 25% des 40–49 ans n’avaient pas reçu d’injection et 24% avaient reçu leur deuxième injection plus de 20 jours avant et étaient donc considérés pleinement protégés. Du côté des tests, 62 % des tests positifs venaient des personnes n’ayant pas reçu d’injection et 2% seulement de la part de celles étant considérées protégées. Ces chiffres ont fait couler beaucoup d’encre comme étant une preuve de l’efficacité des injections. Cependant, rien ne prouve qu’il ne s’agit pas juste d’un biais de sélection des personnes testées comme expliqué au-dessus. À savoir que quasiment aucune personne ayant reçu deux injections ne se fait tester et donc ne risque pas d’être considérée positive.
Cette situation a perduré avec la mise en place du Green Pass, le passe sanitaire israélien. Dès le 21 février 2021, des directives limitant la circulation des Israéliens n’ayant pas encore été injectés ont été mises en place. Le Pass vert a duré jusqu’au mois de juin 2021. Durant toute cette période, on constate bien que les cas positifs concernent beaucoup moins souvent ceux qui ont reçu deux injections puisqu’ils ne sont pas obligés de faire de tests pour accéder aux lieux publics. Par exemple, pendant la semaine du 23 au 29 mai 2021, 15% des 40–49 ans n’avaient pas reçu d’injection et 80% avaient reçu leur deuxième injection plus de 20 jours avant, et étaient donc considérés pleinement protégés. Du côté des tests, 39% des tests positifs venaient des personnes n’ayant pas reçu d’injection et 61% seulement de la part de celles étant considérées protégées. Le fait d’avoir autant de cas positifs chez celles normalement considérées comme totalement immunisées a commencé à faire parler. On a alors commencé à dire que les injections perdaient en efficacité devant les variants, mais que de voir moins de cas chez les doublements injectées que leur part dans la population était la preuve que ces injections fonctionnent. Cependant, nous avons vu à travers le Green Pass, que celles n’ayant pas reçu d’injection sont beaucoup plus testées que les autres.
Le Green Pass a cessé entre mi-juin et début août en Israël. Pendant cette période, celles n’ayant pas reçu d’injection n’avaient pas de raison spécifique de se faire tester. C’est la seule période pendant laquelle en Israël, il n’y a pas ou très peu de biais de sélection des personnes testées. Nous pouvons constater que pendant toute cette période, la part des personnes n’ayant pas reçu d’injection ou la part des personnes étant considérées protégées avec deux injections est la même dans les cas positifs et la population générale. Pour cette raison, les autorités ont conclu à une baisse de l’efficacité en quelques mois et ont donc conseillé une troisième dose, alors qu’il s’agit juste de la fin du biais de comptage. Quand il n’y a plus de biais, aucune efficacité des injections n’est mesurable.
On constate également ensuite, que dès le retour du Green Pass au mois d’août, la part des non-injectées a immédiatement réaugmenté. Cela n’est que le signe que le Green Pass oblige les non-injectées à se faire tester et non celles ayant reçu deux injections. Le gouvernement israélien, ayant déjà commandé les troisièmes doses et contraint sa population à se faire injecter, n’a mystérieusement pas réagi à ces chiffres, en imaginant un rebond d’efficacité vaccinale. Cette situation du mois d’août, identique au mois de mai, prouve qu’il n’y a jamais eu de baisse de l’efficacité des injections, elles bénéficiaient juste d’un biais statistique.
Conclusion
En résumé, nous avons vu qu’Israël est un pays qui n’a jamais connu de hausse de mortalité significative depuis le début de la panique mondiale autour de la Covid-19. Les Israéliens les plus âgés ont connu des hausses de mortalité l’hiver comme les autres années.
Nous avons vu que quelques hausses de mortalité inhabituelles ont été constatées chez les jeunes en période vaccinale. Ces hausses représentent environ 60 décès sur Israël. Ce n’est pas une hécatombe, mais suffisamment important pour être visible sur ces populations qui décèdent très peu. Ces décès sont survenus au moment où étaient enregistrés des records d’urgences cardiaques pour ces mêmes âges.
Enfin, nous avons vu que si l’on enlève les biais de comptage dus aux restrictions comme le Green Pass, les doubles injections ne présentent aucun impact sur les cas positifs. Il n’y a donc aucun bénéfice mesurable pour personne. Seul le fait de tester en énorme majorité des non-injectés permet de maintenir un écart statistique.
Nous avons donc de nombreux décès remontés en pharmacovigilance, des décès visibles même chez les populations jeunes et aucun impact positif mesurable. Pensez-vous réellement qu’il soit raisonnable de continuer à multiplier ces injections ? Pensez-vous réellement que nous allons vous laisser toucher à nos enfants ?
Pierre Chaillot (Décoder l’éco)
____________________
Sources
Données de population israélienne : https://www.cbs.gov.il/he/publications/LochutTlushim/2020/%D7%90%D7%95%D…
Données de décès par âge :
https://www.cbs.gov.il/he/publications/LochutTlushim/2020/p‑1.xlsx
Données de vaccination par âge :
https://data.gov.il/dataset/covid-19/resource/57410611–936c-49a6-ac3c-83…
Données de cas par âge :
https://data.gov.il/dataset/covid–19/resource/9b623a64–f7df–4d0c–9f57-09…
Données du nombre de tests :
ourworldindata.com
Remarque sur la source de ce texte : le seul journal en France capable de publier cette importante analyse de Pierre Chaillot est France Soir, le journal le plus détesté par les faux journalistes (tous vendus à 9 milliardaires et aux industries pharmaceutiques). On voit là que France Soir est, en fait, composé de vrais journalistes, dignes de ce nom, que c’est (à l’évidence) un des seuls remparts contre la bascule totalitaire scientiste en cours. Je considère la violence dont il fait l’objet (de la part des dominants, qui veulent manifestement asservir la population) comme une sorte de « légion d’honneur » (comme une médaille de bonne résistance aux abus de pouvoir).
Étienne.
PS : je glisse ci-dessous, en complément, la vidéo de la présentation de Pierre au CSI, Conseil Scientifique Indépendant (rendez-vous passionnant et important, tous les jeudi soir, pour bien s’informer sur « la crise sanitaire ») :

https://crowdbunker.com/v/cEageBup
Bonus : démonstration de l’erreur (et de l’escalade d’engagement) par le premier ministre israélien lui-même… :
Israël, le 1er Ministre appelle les doubles vaccinés à la 3ème dose de manière urgente car ce sont les personnes les plus en danger et celles qui remplissent les réanimations. Donc nouvelles doses à vie avec des tonnes d’effets secondaires et de morts !! #Manifs11septembre pic.twitter.com/p8gFfUeQS2
— Vivre Sainement (@VSainement) September 11, 2021
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10159467558012317
Tweet correspondant à ce billet :
[Abus de pouvoir médical] Le cas d’Israël étudié par Pierre Chaillot (statisticien remarquable)https://t.co/rofykPqaYO
Les démonstrations de Pierre n’ont jamais été correctement contredites par personne, alors qu’elles détruisent tout le narratif terroriste gouvernemental.
— Étienne Chouard (@Etienne_Chouard) September 11, 2021
Fil Télégramme correspondant à ce billet :
https://t.me/chouard/142
[Abus de pouvoir médical] Les VACCINS sont-ils TOXIQUES ? L’état de la science expliqué par le docteur Michel de Lorgeril
Chers amis,
Comme vous le savez, je vis la période actuelle comme une bascule totalitaire (sous prétexte sanitaire), une frénésie scientiste liberticide, un déluge d’abus de pouvoir plus graves et impardonnables les uns que les autres, abus impunis faute de constitution (digne de ce nom).
À propos des « vaccins » (que nos prétendus « représentants » nous imposent scandaleusement), je suis en train de lire plusieurs livres absolument passionnants, d’un cardiologue, épidémiologiste et scientifique de grande renommée, Michel de Lorgeril, dont je découvre le travail que je trouve très important : enfin ! des textes scientifiques rigoureux et indépendants des labos sur les vaccins !

Michel de Lorgeril, cardiologue et chercheur au CNRS
Pour commencer, je vous invite à écouter deux entretiens étonnants :
Dr Michel de Lorgeril déglingue #Pfizer invité chez @frederictaddei (📽 RT France) #JeNeMeVaccineraiPas pic.twitter.com/C7ML8Ei5R4
— LE GÉNÉRAL Officiel 💎 (@LE_GENERAL_OFF) June 26, 2021
Et surtout, je vous recommande la lecture de ces trois livres PA-SSIO-NNANTS
(deux petits et un gros, pour commencer – cliquez sur l’image pour voir un résumé et lire les premières pages) :
Ça décape ! et ça instruit beaucoup…
Pour approfondir le travail de cet homme captivant, je vous recommande son blog, https://michel.delorgeril.info, très actif et où il répond très vite à tous ses lecteurs (ce qui me rend encore plus admiratif 🙂).
Bonne lecture.
Étienne.
Fil Facebook correspondant à ce billet :
Aucun puisqu’il est interdit de s’y opposer au gouvernement.
Tweet correspondant à ce billet :
[Abus de pouvoir médical] Les VACCINS sont-ils TOXIQUES ?
L’état de la science expliqué par le docteur Michel de Lorgerilhttps://t.co/CKT5ywOX01Ce type est passionnant.
Et ce qu’il explique patiemment est très important.— Étienne Chouard (@Etienne_Chouard) September 10, 2021
[Abus de pouvoir] La dangerosité des nouveaux vaccins anti-covid est un fait historique (article collectif d’une équipe autour de Laurent Mucchielli)
Bonjour à tous.
Laurent Mucchielli est un sociologue spécialiste de la violence d’État qui publie sur son blog chez Médiapart, depuis le début de 2020, un travail absolument remarquable sur « la crise sanitaire ».
C’est peu dire que son analyse est hétérodoxe et contredit de plus en plus frontalement la propagande d’État qui nous accable. Hétérodoxe au point que Médiapart lui-même a censuré un de ses récents article, intitulé « La vaccination Covid à l’épreuve des faits « Une mortalité inédite ». Cet article important a été republié à plusieurs endroits (voir les liens dans le texte ci-dessous) et je le reproduirai moi aussi plus bas. Il répond ici à cette censure : il persiste et signe avec, donc, un 3e article sur cette très importante question.
Je veux remercier ici Laurent Mucchielli pour son travail et pour son courage ; il en faut pour affronter le monstre médiatico-médicalo-politique.
Je vous invite à faire connaître ici, dans les commentaires de ce billet, tout ce qui, à votre connaissance, pourrait compléter ces informations sur la DANGEROSITÉ des « vaccins » (avec des guillemets) que l’État veut nous injecter de force à tout prix.
Bon courage à tous.
Étienne.
PS : j’ai choisi de reprendre ci la republication proposée par L’Ardeur (l’équipe de Franck Lepage) avec qui je me sens proche.
La dangerosité des nouveaux vaccins anti-covid est un fait historique (article collectif d’une équipe autour de Laurent Mucchielli)
(épisode 61)
La dangerosité des nouveaux vaccins anti-covid est un fait historique
Par Laurent MUCCHIELLI, sociologue, directeur de recherche au CNRS ; Hélène BANOUN, pharmacien biologiste, PhD, ancienne chargée de recherches à l’INSERM ; Emmanuelle DARLES, maîtresse de conférences en informatique à Aix-Marseille Université ; Éric MENAT, docteur en médecine, médecin généraliste ; Vincent PAVAN, maître de conférences en mathématique à Aix-Marseille Université ; Amine ULMILE, pharmacien des hôpitaux, praticien hospitalier, unité de pharmacovigilance du Centre hospitalier de Cholet.
Pourquoi L’ardeur a décidé de publier cet article.
La vaccination anti-Covid, destinée à l’intégralité de la population, appliquée à marche forcée, ne fait l’objet d’aucun débat en France. Il s’agit en effet d’une idéologie politique (incarnée et promue activement par le président de la République en personne) et non d’une idée scientifique, ni d’une stratégie de santé publique. La science comme la santé publique sont des choses complexes, des séries de vérités partielles, adaptables et révisables en fonction des réalités de terrain ou d’expérience. Dans toutes les idéologies (politiques ou religieuses), le débat est au contraire posé en termes binaires et enfantins. On est pour ou contre, et le monde se divise entre amis (ici les pro-vax) et ennemis (ici les anti-vax). Que cette idéologie ait pris le pouvoir en France et qu’elle impose les termes mêmes du débat est une catastrophe à tous points de vue : intellectuel, démocratique et sanitaire.
Les influenceurs se déchaînent, certains journalistes les suivent
Dans un tel contexte, la mise en évidence d’une dangerosité vaccinale inédite associée aux quatre vaccins anti-covid anglo-saxons (Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Janssen) constitue une dissonance cognitive telle que beaucoup ne peuvent tout simplement pas l’entendre. La réalité est pourtant que l’un de ces quatre vaccins (celui d’AstraZeneca) a déjà été suspendu en février-mars 2021 dans de très nombreux pays et définitivement retiré voire interdit dans certains d’entre eux (le Danemark, la Norvège, la Suisse, l’Afrique du Sud, le Venezuela ainsi que les Etats-Unis). De fait, nous avons montré dans notre précédent article que ce vaccin était manifestement responsable du niveau de déclarations de décès particulièrement élevé au Royaume-Uni, qui l’a utilisé massivement (s’agissant du produit d’une firme suédo-britannique). Pourtant, à la fin du mois d’avril, Emmanuel Macron continuait à le recommander et cherchait à « casser la défiance » des Français à son égard, nous expliquait alors Le Monde. Position idéologique et non scientifique ou médicale, avons-nous déjà dit. Et la plupart des commentateurs s’exprimant dans le débat public s’y enferment derrière le président. Toutes ces personnes qui, pour une raison ou une autre, se sont impliquées dans la campagne gouvernementale de vaccination générale (élus, hauts fonctionnaires, médecins, journalistes, etc.), ne peuvent pas discuter tranquillement du problème posé. Ils y voient une remise en cause insupportable de l’idéologie qu’ils ont adoptée. Dès lors, au lieu de contribuer à réfléchir au problème et à l’étayer de données ou d’arguments, ils cherchent le moyen de l’évacuer purement et simplement. Et, comme l’on sait, le meilleur moyen de faire disparaître un message est de tuer le messager.
Le journal Mediapart, sur lequel l’un d’entre nous publie toute son enquête sur la gestion politico-sanitaire de cette crise depuis la fin du mois de mars 2020, a ainsi censuré notre dernier épisode (republié toutefois ici, là et ici) et ce malgré notre appel préalable au dialogue. Sa décision – cocasse pour un journal qui prétendait jusque-là défendre la liberté d’expression et les lanceurs d’alerte – a donné des ailes à la meute des influenceurs et lobbyistes qui nous dénigrent de toutes les façons possibles sur les réseaux sociaux depuis un an et demi. Cette fois-ci, non contents de voir notre travail censuré, ils ont ensuite harcelé sur Twitterl’institution (le CNRS) du premier signataire de cet article, espérant ainsi lui nuire de façon personnelle et directe. D’autres journalistes se sont empressés de le répercuter dans des articles, comme ici au Figaro, avec quelques copier-coller.
Il semble que notre lancement d’alerte du 30 juillet n’a pourtant pas été inutile. Ainsi, la Direction générale de la santé a envoyé un message d’alerte (« DGS-Urgent, n°2021–75 ») à tous les professionnels de santé le 3 août, pour leur demander de « maintenir un suivi des échecs vaccinaux ». Le lendemain (4 août), la revue Prescrirea mis à jour « de façon anticipée » sa fiche relative aux « effets indésirables connus mi-2021 des vaccins covid-19 à ARN messager », reconnaissant notamment des complications cardiaques graves jugées toutefois « très rares ». On va voir que cette « rareté » se discute (voir note 1).
Mais revenons aux arguments employés pour justifier la censure. À lire un peu l’ensemble des commentaires suscités ici et là par notre précédent article, il apparaît que toutes les personnes qui prétendent avoir de vrais arguments intellectuels n’en ont en fin de compte que deux. Ces deux arguments sont de type méthodologique. Ils visent à contester l’usage des déclarations d’effets indésirables remontés par la pharmacovigilance, et ils concluent invariablement que nous avons alarmé à tort et qu’en réalité tout va bien. Le premier argument est l’« imputabilité », le second la « mortalité attendue » (voir par exemple les verbatims de médecins collectés dans la dépêche de l’AFP écrite contre notre article). Les deux notions sont, en soi, tout à fait intéressantes et importantes à discuter. Mais leur détournement à des fins rhétoriques de protection de l’idéologie vaccinale est facile à montrer.
Imputabilité et mortalité attendue : les vrais-faux arguments du déni
Sur le papier (ou plutôt devant un écran d’ordinateur), les choses peuvent être discutées sans fin et dans un confort intellectuel rassurant. Cela s’appelle la ratiocination. Dans la vraie vie, les choses sont à la fois plus simples et plus brutales pour les personnes directement concernées par les effets indésirables des médicaments. Pour les victimes, il s’agit de savoir comment affronter ces effets parfois graves dans un contexte général de déni. Pour les soignants, il s’agit de savoir comment catégoriser et enregistrer ces effets apparus très rapidement (le plus souvent dans les 48h) après la vaccination.
Concernant l’imputabilité, notre précédent article posait déjà explicitement le problème : il est évident qu’il est très difficile de déterminer la cause exacte d’un effet indésirable grave lorsque le malade présente (ou présentait s’il est décédé) des comorbidités importantes, ou lorsque son dossier médical est insuffisamment connu. Le raisonnement vaut d’ailleurs aussi pour les morts réputés causées par la covid. Et c’est aussi pour cette même raison que, quel que soit le médicament concerné (vaccin ou autre), il ne faut jamais l’administrer uniformément mais bien au cas par cas en fonction de l’état de santé général de la personne et des éventuelles spécificités de son histoire médicale. De plus, en matière de mortalité, la preuve ultime de l’imputabilité qu’est la répétition du même symptôme à la suite de la même médication ne peut par définition pas être fournie (on ne meurt qu’une fois…). Il n’en reste pas moins qu’il existe des faits (des effets indésirables graves sont constatés dans les heures et les jours qui suivent un acte médical) et qu’il n’est pas possible de s’en débarrasser d’un revers de la main au prétexte que la causalité directe (a fortioriunique) n’est pas établie. C’est un peu comme si on voulait contester l’existence d’un homicide au motif que l’on n’a pas encore trouvé le coupable. Les déclarations de pharmacovigilance relatives aux effets indésirables graves de la vaccination sont là, il faut les interpréter et non tenter de les cacher sous le tapis.
Concernant la « mortalité attendue », l’argument utilisé par nos savants critiques nous paraît tout aussi rhétorique. Il consiste à dire au fond qu’il est normal que des gens meurent à tout âge, vaccinés ou pas, et donc qu’il n’y a pas lieu de s’interroger plus avant sur les décès. Mais aucun des utilisateurs de cet argument n’est allé vérifier réellement si cette mortalité était attendue ou pas. Par ailleurs, en quoi le fait que des gens meurent tous les jours d’un cancer invalide-t-il l’interrogation sur la responsabilité de la vaccination quand le malade en question meurt dans les heures qui suivent l’injection ? Il nous semble que l’argument sert encore une fois à évacuer la question au lieu de la problématiser.
En fin de compte, ces deux arguments sont incapables d’aider à comprendre le réel que nous avons sous les yeux et qui peut se résumer le plus souvent ainsi : un médecin constate l’apparition d’effets indésirables plus ou moins graves dans les heures qui suivent un acte vaccinal, il fait donc un signalement de ce qui lui apparaît logiquement comme étant lié d’une façon ou d’une autre à cet acte vaccinal qui vient juste d’être pratiqué. Qu’y a‑t‑il de compliqué à comprendre dans cette situation très concrète de la vie quotidienne ? Rien en réalité.
Enfin, et de manière très révélatrice, nos critiques semblent n’avoir lu que la première partie d’un article qui en comportait deux. La première était consacrée aux données françaises de pharmacovigilance. La seconde fournissait des comparaisons avec la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, les États-Unis et la communauté européenne. Et, dans le cas des États-Unis, nous avons montré que la preuve du caractère inédit de la mortalité liée aux nouveaux vaccins anti-covid est fournie par la comparaison temporelle. On va y revenir ici en détail. Puis on étudiera les données suisses, qui convergent elles aussi vers le constat d’une mortalité vaccinale inédite liée à ces nouveaux vaccins anti-covid.
La comparaison confirme que nous avons affaire à un événement historique
Que l’on pense que la comptabilité des effets indésirables par la pharmacovigilance les exagère ou au contraire les minimise (ce qui est communément admis en pharmacovigilance), le problème ne varie guère d’une année sur l’autre. Et les mêmes problèmes d’interprétation des déclarations se posent pour d’autres vaccins, ceux contre la grippe saisonnière par exemple. Or la mortalité associée en Occident à la vaccination anti-covid du fait des 4 vaccins ADN ou ARN fabriqués par des firmes anglo-saxonnes constitue un fait historique inédit. Mis en graphique, à partir ici des années américaines de pharmacovigilance (VAERS) qui recense les effets indésirables associés aux vaccins depuis 1990, cela donne ceci (Figure 1) :
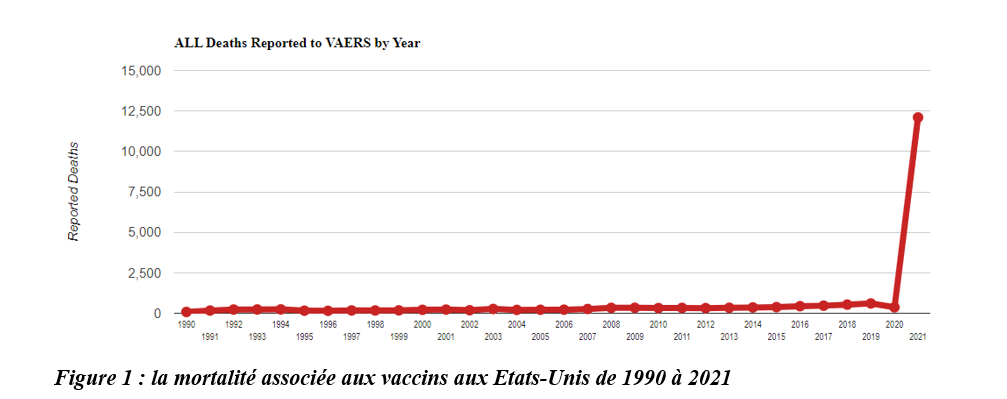
Que cela plaise ou non, nous avons bien affaire à un événement historique qu’il faut essayer de comprendre et non de cacher sous le tapis. Précisons qu’il ne s’agit pas là de vagues imputations déclarées des semaines voire des mois après la vaccination. Ce sont des effets qui ont été constatés principalement dans les 48h suivant immédiatement l’injection (Figure 2). Nous sommes donc bien dans la situation concrète résumée ci-dessus.
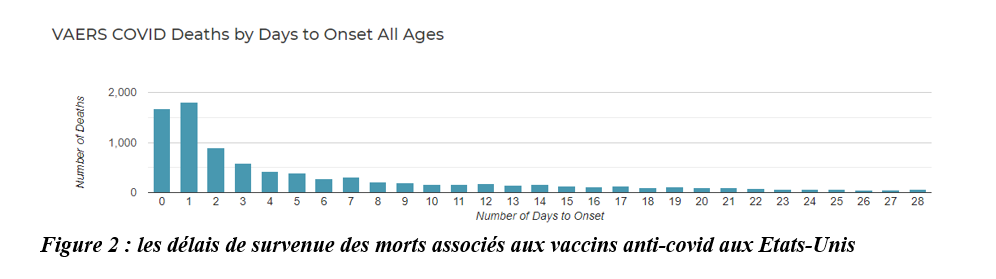
Source : https://openvaers.com/covid–data/mortality
Comme nous l’avions indiqué dans notre précédent article, la base de données américaine recense les effets indésirables des médicaments depuis 1990. Il est donc possible de comparer cette mortalité des nouveaux vaccins anti-covid à celle de tous les autres vaccins administrés depuis 31 ans dans ce pays. La première analyse que nous en avions faite comporte une erreur de calcul qui nous avait amené à estimer que la campagne vaccinale anti-covid était responsable d’environ 36% du total des décès associés à la vaccination depuis 1990. Nous n’avions pas vu en effet qu’il existait des doubles comptages dans les résultats affichés. Nous avons donc refait le calcul et le résultat est plus impressionnant encore. Aux États-Unis, après l’actualisation du 30 juillet 2021, ce sont 10 672 décès qui sont remontés en pharmacovigilance comme associés à la vaccination depuis 1990, sur la totalité des vaccins utilisés. Parmi eux, 2 842 sont associés au vaccin anti-covid de Moderna, 2 768 à celui de Pfizer, 545 à celui de Janssen et 28 dont la marque de vaccin n’est pas connue. Le total des quatre donne un total de 6 183 décès, ce qui équivaut à près de 58% du total de la mortalité associée à un vaccin quel qu’il soit depuis 31 ans. Ceci est bien un événement historique inédit. L’interprétation est ouverte au débat. Mais le fait, lui, ne peut pas être évacué.
Le détail des décès, hospitalisations et incapacités permanentes aux Etats-Unis
Les décès associés à la nouvelle vaccination anti-covid sont évidemment les effets indésirables les plus graves. Mais, comme on le résume dans le tableau 1 ci-dessous, les données américaines donnent aussi à voir des invalidités graves (près de 7 000 fin juillet), des morts fœtales (près de 300) et des hospitalisations (près de 28 000).
Tableau 1 : effets indésirables les plus graves des vaccins anti-covid aux USA
| Morts | Hospitalisations | Invalidités permanentes | Anomalies congénitales / morts fœtales | |
| Pfizer | 2 768 | 13 790 | 3 453 | 140 |
| Moderna | 2 842 | 11 182 | 2 725 | 133 |
| Janssen | 545 | 2 639 | 632 | 16 |
| Inconnu | 28 | 112 | 23 | 1 |
| Total | 6 183 | 27 723 | 6 833 | 290 |
| Total vaccins depuis 1990 | 10 672 | 63 050 | 18 443 | 325 |
| % vaccins covid | 57,9 % | 44 % | 37 % | 89,2 % |
Source : VAERS
Il est par ailleurs possible d’observer la répartition par tranches d’âges de ces effets indésirables graves associés à la vaccination anti-covid. Le tableau 2 ci-dessous en donne la répartition pour tous les cas où l’âge est connu. On y observe sans surprise que les effets les plus graves (décès et invalidités permanentes) sont logiquement concentrés aux âges les plus avancés, c’est-à-dire sur les personnes les plus fragiles. 63% des cas concernent ainsi les personnes âgées de plus de 60 ans. Toutefois, on note qu’un quart des cas concernent les personnes âgées de 40 à 59 ans, et que près de 12% des cas concernent même les jeunes adultes (18−39 ans).
Tableau 2 : répartition par classes d’âge des effets indésirables les plus graves des vaccins anti-covid aux USA
| Morts (1) | Hospitalisations | Invalidités permanentes (2) | Total en % de 1 + 2 | |
| Moins de 18 ans | 20 | 937 | 49 | 0,6 |
| 18–29 ans | 76 | 1 894 | 405 | 3,9 |
| 30–39 ans | 139 | 2 305 | 793 | 7,5 |
| 40–49 ans | 228 | 2 746 | 1 074 | 10,4 |
| 50–59 ans | 472 | 3 749 | 1 351 | 14,6 |
| 60–79 ans | 2 485 | 10 426 | 2 480 | 39,8 |
| Plus de 80 ans | 2 335 | 4 229 | 550 | 23,1 |
| Total | 5 755 | 26 286 | 6 702 | 12 477 (100%) |
Source : VAERS
Mortalité, létalité : la comparaison prouve la dangerosité inédite de ces vaccins à ARN messager
Dans notre précédent article, nous indiquions que les données de la VAERS permettent de comparer la mortalité associée aux vaccins anti-covid à la mortalité vaccinale globale aux États-Unis depuis 30 ans. Nous venons de confirmer et même d’amplifier le constat : à elle seule et en seulement 6 mois, la vaccination anti-covid représente donc 58% de la totalité de la mortalité vaccinale depuis 31 ans. Nous avions également fait la comparaison avec les vaccins contre la grippe saisonnière (influenza seasonal) et constaté que, sur la même période, ces vaccins sont associés à 1 106 décès (soit 6,66% du total de la mortalité vaccinale globale). Il faut donc conclure que, aux États-Unis, en 6 mois, la vaccination anti-covid a contribué à tuer 9 fois plus de personnes que la vaccination anti-grippe en 31 ans.
Certains commentateurs honnêtes nous ont reproché à juste titre d’avoir discuté la mortalité mais pas la létalité, faute de fournir des données sur l’ampleur des vaccinations autres que covid ces dernières années. Nous avons donc cherché cette information qui est publiée sur le site du Center for Disease Control and Prevention. On y constate (sans surprise) que les États-Unis sont un pays qui vaccine énormément contre la grippe saisonnière ces dernières années. De 23,3 millions de doses injectées en 1990–1991, l’on est passé à 193,8 millions en 2020–2021. Au cours des 4 dernières années (2017−2020), près de 650 millions de vaccins contre la grippe ont été réalisés. Et 194 déclarations de décès ont été enregistrées dans la base. Cela donne donc une létalité potentielle extrêmement faible de 1 décès pour 3,3 millions d’injections. La vaccination anti-grippe saisonnière n’est donc pas dangereuse pour les populations.
Mais voici la comparaison avec les vaccins anti-covid : en 2021, en six mois, environ 165 millions de personnes ont été entièrement vaccinées aux Etats-Unis. Et nous avons vu que 6 183 décès ont été déclarés. Cela donne donc une létalité potentielle extrêmement forte de 1 décès pour 27 000 injections. En d’autres termes, la létalité potentielle des nouveaux vaccins anti-covid est environ 120 fois supérieure à celle des vaccins anti-grippe saisonnière.
Les données de la pharmacovigilance suisse confirment l’alerte
Alertés par un article publié par le pasteur Martin Hoegger sur le blog de l’économiste Liliane Held-Khawam, nous avons également exploré le site de l’agence suisse de pharmacovigilance (Swissmedic). Les données mises à disposition permettent de faire des calculs équivalents à ceux que nous avons fait pour les États-Unis. En voici les principaux résultats.
Du 1erjanvier au 21 juillet 2021, plus de 4,5 millions de personnes ont reçu ces nouveaux vaccins en Suisse. Et la pharmacovigilance fait remonter 2 782 effets non graves (soit environ 1 cas sur 1 600), 1 537 effets graves (soit environ 1 cas sur 3 000) et 128 morts (soit environ 1 cas sur 35 000, ce qui est cohérent avec ce que nous avons constaté pour d’autres pays européens).
Hoegger a ensuite fait avec les données suisses le même raisonnement et le même type de calcul que nous. Il a comparé cette mortalité associée aux nouveaux vaccins anti-covid à celle des précédents vaccins contre la grippe saisonnière. Il a ainsi constaté que, en 9 ans (de 2011 à 2019), 99 événements indésirables graves ont été déclarés, ainsi que 2 décès. Partant du constat officiel qu’environ 14% de la population suisse a été vaccinée contre la grippe en 2018–2019, et en appliquant ce taux à toute la période, il estime donc qu’environ 10,5 millions de vaccinations anti-grippe ont été effectuées en Suisse en 9 ans. Cela donnerait donc un taux infime de 1 décès pour plus de 5 millions de vaccinations anti-grippe.
Par comparaison, la vaccination anti-covid a concerné environ 4,5 millions de personnes en Suisse au 21 juillet, pour 128 décès associés, ce qui donne un taux de 1 décès pour 35 000 vaccinations, soit une létalité potentielle environ 140 fois supérieure à celle des vaccins contre la grippe saisonnière. Voici à nouveau un constat, qu’il faut interpréter et non dissimuler.
Conclusions
Comme écrit à la toute fin de notre précédent article, la mortalité associée aux vaccins anti-covid est manifestement inédite dans l’histoire de la médecine moderne. Et toutes les ratiocinations autour de la question de l’imputabilité ou de la mortalité attendue ne sont que des diversions servant à masquer une réalité qui dérange l’ordre établi. Ceci n’est pas sans rappeler la controverse sur l’hydroxychloroquine où la discussion méthodologique des doctus cum libro(« Comment, vous n’avez pas randomisé en double aveugle ? mais ça ne vaut rien alors ! ») servait à éviter d’avoir à aller voir sur le terrain (médical) si ce traitement précoce permettait ou non de réduire le nombre et/ou la sévérité des maladies. La réalité de terrain est que ces nouveaux vaccins provoquent incroyablement plus d’effets indésirables plus ou moins graves que les autres vaccins destinés à la population générale, et qu’il faut une forte dose d’aveuglement idéologique ou d’hypocrisie pour ne pas le reconnaître. En Allemagne, le débat a au moins le mérite d’exister entre médecins et scientifiques (un exemple ici). En France, l’idéologie l’interdit et le pouvoir exécutif veille à ce qu’elle s’impose sans partage. Comme le disait déjà Roland Gori en 2019, dans le contexte du mouvement des Gilets jaunes, le président de la République ne gouverne pas les Français, il les soumet.
Voir et entendre tellement de journalistes et d’« experts » (ou supposés tels) disserter sur la méthodologie de la pharmacovigilance a quelque chose que l’on imagine difficilement supportable pour les personnes qui subissent ces effets indésirables. Cette population qui obéit au terrible chantage qui lui est fait (vaccine-toi sinon tu ne pourras plus travailler, tu ne pourras plus aller au restaurant, au cinéma, au musée, au concert ou au parc d’attractions, tu ne pourras plus voyager, etcetera), qui s’en soucie ? Qui la protège ? Personne. Elle doit s’auto-organiser. C’est ainsi que, parallèlement au Réseau des victimes d’accidents vaccinaux constitué en 2018 par des victimes du vaccin contre l’hépatite B, un groupe baptisé « Recensement effets indésirables vaccin Covid Officiel » s’est créé sur Facebook mi-juillet et a rassemblé 200 000 abonnés en à peine trois semaines. Mais qui sait s’il ne sera pas censuré par Facebook cette fois-ci ? Comme les innombrables témoignages qui se multiplient sur les réseaux sociaux. Rappelons aussi à tous que le portail officiel de signalement des « événements sanitaires indésirables », destiné aussi bien aux soignants aux malades, se trouve ici.
Concluons. L’examen des données disponibles suggère clairement qu’une mortalité vaccinale inédite est en train de se développer partout en Occident, en lien avec l’usage des nouveaux vaccins anti-covid. Le débat est ouvert sur l’interprétation, mais le fait est là, sous nos yeux. Et cette mortalité vaccinale n’est que la pointe émergée de l’iceberg des effets indésirables graves. Même réduite à ses plus élémentaires principes de déontologie (primum non nocere), l’approche de cette question en termes de santé publique devrait donc conduire à suspendre d’urgence la campagne vaccinale, à étudier beaucoup plus en détail les données de cette pharmacovigilance (en particulier selon les classes d’âge et en fonction des différents facteurs de risque) et, au terme d’une analyse bénéfices/risques méticuleuse, à déterminer à quelles catégories bien précises de la population il est possible de proposer la vaccination sans risque que les effets secondaires graves soient plus nombreux que les formes graves de la Covid dont elle est censée les protéger. Par cet article, comme par le précédent, nous appelons donc solennellement les gouvernements des pays occidentaux à suspendre immédiatement cette campagne vaccinale afin que, dans le cadre d’enquêtes parlementaires, des comités scientifiques et médicaux indépendants du pouvoir exécutif puissent analyser les données de pharmacovigilance dont nous disposons à l’échelle mondiale et les exposer à l’ensemble des citoyens en toute transparence.
Note :
(1) La « rareté » est une notion bien vague. Est-ce 1 pour 1 000 ? Un pour 10 000 ? S’agissant de la plus grande opération de vaccination de toute l’histoire, la question est importante aussi bien sur le plan scientifique que sur celui de la santé publique (et de son éthique). De ce dernier point de vue, nous avons vu (cet article et le précédent) que, dans les pays occidentaux, la mortalité vaccinale présumée des nouveaux vaccins anti-covid est probablement de l’ordre de 1 décès pour 30 000 vaccinations intégrales. Pour 30 millions de vaccinations, cela fait donc 1 000 décès. Pour 300 millions, 10 000 décès. Etcetera. Est-ce assumable éthiquement ? Par ailleurs, sur le plan scientifique, la question est également importante. En effet, indépendamment même de toute autre question méthodologique (transparence des protocoles, représentativité de l’échantillon, sincérité des analyses, etc.), les essais cliniques des industriels ont porté sur des populations de 30 000 (Moderna) à 44 000 personnes (Pfizer), ce qui peut paraître important vu de loin. En réalité, divisé en deux groupes (un groupe vacciné, un groupe placebo), cela donne des populations vaccinées d’environ 15 000 à 22 000 personnes. De sorte que des effets indésirables très graves (a fortiori mortels) survenant dans 1 cas sur 30 000 peuvent ne jamais y avoir été constatés.
Étienne : je vous propose maintenant de publier ici l’article de Laurent Mucchielli (assez important pour avoir été) censuré par Médiapart :
La vaccination à l’épreuve des faits : une mortalité inédite Volet 2

par Laurent Mucchielli, initialement sur Médiapart.
La pharmacovigilance des vaccins anti-covid est déniée car elle menace l’idéologie de la vaccination intégrale portée par les industries pharmaceutiques, les gouvernements et les principaux médias. Cette vaccination de masse conduit pourtant à une mortalité inédite dans l’histoire de la médecine moderne. Il y a urgence à la suspendre pour évaluer la balance bénéfice/risque au cas par cas.
Épisode 59 (actualisé au 01/08/2021)
Dans le précédent épisode de notre mini-série sur la vaccination, nous avions montré que les données épidémiologiques les plus facilement disponibles à l’échelle mondiale suffisent à prouver que la vaccination ne protège pas de la contamination et de la transmission du Sars-Cov‑2, en particulier de l’actuel variant Delta (ou indien), ce qui contredit massivement les déclarations répétées des représentants du pouvoir exécutif français relatives à la « protection vaccinale ». Aux États-Unis, le directeur du NIAID, Antony Fauci, vient du reste de le reconnaître publiquement, recommandant même le port du masque en intérieur par les personnes vaccinées. Autre exemple : en Angleterre, les touristes français doivent subir une quarantaine même s’ils sont vaccinés. Il est donc déjà clair que la vaccination n’est pas la solution miracle annoncée pour endiguer l’épidémie et que le chantage formulé par l’exécutif français (vaccination générale ou reconfinement) est fondé sur un mensonge. Un second mensonge répété à plusieurs reprises tant par le président de la République, le premier Ministre que le ministre de la Santé (et d’autres élus adoptant des postures sanitaires autoritaires, à l’image du maire de Nice M. Estrosi) est probablement la prétendue quasi-disparition (« à 96% ») des formes sévères de la Covid grâce à la vaccination. En Israël, un des pays où la population est la plus vaccinée au monde, les autorités viennent ainsi de décider de fermer les frontières du pays aux touristes vaccinés, indiquant non seulement que la vaccination ne protège pas de la contamination et de la transmission, mais également que la majorité des personnes hospitalisées pour des formes graves sont désormais des personnes vaccinées. Tout ceci suggère clairement qu’un gouffre sépare le marketing des industriels (repris par la propagande politique) des réalités de santé publique. Et c’est également au fond de ce gouffre qu’est pour le moment oubliée la question des effets indésirables les plus graves de la vaccination anti-covid, sujet de ce nouvel épisode.
Sortir du déni, observer froidement les données de la pharmacovigilance
Dans un autre précédent épisode de notre enquête, nous avons montré comment et pourquoi la plupart des journalistes français travaillant dans les médias mainstream ont trahi certains principes déontologiques de base de leur profession, n’exerçant plus leur rôle de contre-pouvoir pour devenir au contraire de simples relais de la communication gouvernementale. En cause notamment, la fin du journalisme d’investigation, remplacé par un fact-checking de bureau qui n’est plus qu’un simulacre de journalisme. S’agissant de la sécurité des vaccins anti-covid, le pseudo-journalisme va ainsi chercher à dénier la réalité des effets indésirables, dans la droite ligne du discours gouvernemental. Un exemple parmi de nombreux autres est fourni par les fact-checkers du groupe de télévision TFI-LCI qui, depuis janvier 2021, s’évertuent à dénier toutes conséquences médicales négatives de la vaccination (le dernier article en ce sens est à lire ici). L’argument est toujours le même, et il est bien connu. Sur tous les sites de pharmacovigilance du monde, on trouve en effet les mêmes précautions d’interprétation indiquant que les déclarations d’effets indésirables imputées à tel ou tel médicament ne sont qu’une présomption de causalité (imputabilité). Cette présomption est cependant considérablement renforcée lorsque les décès surviennent très rapidement après la vaccination, ce qui est le cas comme on le verra avec les données américaines (la très grande majorité des décès déclarés sont survenus dans les 48h).
Par ailleurs, ces réserves d’interprétation sont à appliquer à la pharmacovigilance de manière générale, et on verra que la comparaison avec d’autre médicaments montre qu’il se passe bel et bien quelque chose d’inédit pour ces vaccins génétiques anti-covid. Comme d’habitude, les journalistes sont aveuglés par leur dépendance au pouvoir politique et aux sources institutionnelles directement liées au ministère de la Santé, et ils font preuve d’un esprit critique à géométrie extrêmement variable. Les mêmes précautions valent en effet, par exemple, pour le comptage des morts imputables à la Covid (morts de la Covid ou avec la Covid ?), sujet sur lequel on n’a pourtant quasiment jamais lu d’article critique dans la presse. Autre exemple saisissant de parti-pris : à la fin du mois de mars 2020, il avait suffit de 3 cas de décès (liés en réalité à des auto-médications surdosées) remontés par la pharmacovigilance pour déclencher en France une tempête politico-médiatique sur le thème de la dangerosité de l’hydroxychloroquine. En d’autres termes, pour la plupart des journalistes, les statistiques sanitaires sont indiscutables quand elles vont dans le sens de la narration officielle, mais elles deviennent soudainement discutables lorsqu’elles contredisent cette même narration. Cette malhonnêteté intellectuelle devrait sauter aux yeux.
En outre, nous allons voir que, dans certains pays (comme la France mais également les États-Unis), les remontées d’informations de pharmacovigilance sur la sécurité des vaccins anti-covid sont principalement le fait de médecins et non de malades. Et nous verrons également qu’elles corroborent largement celles des pays (comme les Pays-Bas) où la déclaration est principalement le fait des malades. Nous verrons même qu’il existe des recherches qui ont testé rétrospectivement la fiabilité de ces déclarations, et qui indiquent un haut niveau de fiabilité.
À distance de ces jeux de représentations et de ces arguments d’autorité, nous allons donc ici observer froidement les données de la pharmacovigilance concernant la sécurité des vaccins anti-covid. Et nous allons le faire dans plusieurs pays afin d’échapper au tropisme français. On verra alors que, en réalité, les mêmes constats peuvent être faits un peu partout dans les pays occidentaux.
Dernière précision avant d’entamer l’examen des chiffres : loin d’exagérer les problèmes, ces chiffres sont au contraire à considérer comme des minima sous-évaluant la réalité. En effet, la pharmacovigilance fonctionne presque partout de façon passive (et non pro-active) : les centres dédiés à la collecte des effets indésirables des médicaments attendent que les professionnels de santé et les particuliers leur signalent les problèmes. Si pour une raison ou une autre (oubli, incertitude, auto-censure, manque de temps ou négligence des médecins généralistes ou hospitaliers, isolement du malade qui meurt seul à domicile, ignorance du dossier médical de la personne décédée par le médecin établissant le certificat de décès, problèmes informatiques divers et variés, etc.) les médecins ou les malades ne remplissent pas le formulaire de déclaration d’incident, ce dernier ne sera jamais connu. Dès lors, la sous-estimation de l’état réel des problèmes est à la fois permanente et massive. Les premières études françaises, au début des années 2000, estimaient qu’environ 95% des effets indésirables des médicaments n’étaient pas rapportés. Même si on peut éventuellement faire l’hypothèse que la sous-déclaration concerne surtout les effets indésirables les moins graves, tout ce qui suit doit donc non seulement être pris très au sérieux, mais de surcroît regardé comme constituant très probablement une euphémisation de la réalité des problèmes de sécurité posés par les vaccins anti-covid (comme pour tout autre médicament).
En France, les rapports de l’agence du médicament
En France, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) publie un « suivi hebdomadaire des effets indésirables des vaccins » dont nous avons épluché les rapports détaillés sur chacun des quatre vaccins utilisés en France. On va systématiquement y observer ce qui est dit sur les effets « graves » (par opposition aux effets non-graves qui sont les petites réactions locales immédiates à l’injection).
Concernant le vaccin d’AstraZeneca, l’ANSM indique que 7,2 millions de doses avaient été administrées au 08 juillet 2021, majoritairement dans la population ciblée par les recommandations vaccinales des plus de 55 ans, mais « on note néanmoins 623 doses tracées comme administrées chez des patients de moins de 16 ans ». À la même date, plus de 22 071 évènements indésirables ont été déclarés, exclusivement par des professionnels de santé (on se souvient qu’il leur était réservé en priorité au début, conformément à la Recommandation de la Haute Autorité de Santé du 2 février 2021), dont 5 191 événements « graves » (soit près d’un quart du total). Comme l’indique le tableau ci-dessous, ces cas graves concernent toutes les tranches d’âge mais sont concentrés entre 30 et 74 ans. Parmi ces 5 191 événements graves, un quart a nécessité une hospitalisation, 247 ont engagé le pronostic vital, 121 ont entraîné des invalidités ou incapacités et 170 ont conduit à la mort.
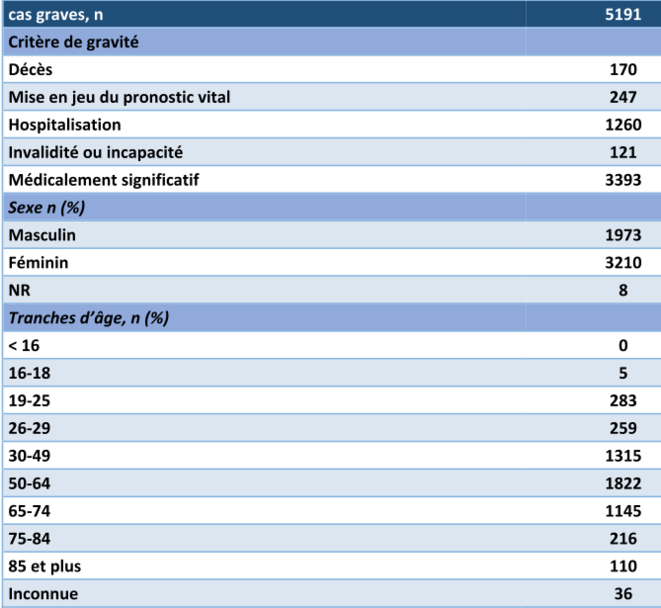
Source : CRPV d’Amiens – CRPV de Rouen, Enquête de pharmacovigilance du vaccin VAXZEVRIA®
Concernant le vaccin de Pfizer, plus de 42,5 millions de doses avaient été administrées au 1er juillet 2021 (dont 700 000 à des jeunes de 16 à 18 ans) et 31 389 cas effets/évènements indésirables déclarés, principalement par les professionnels de santé. Parmi eux, 8 689 événements « graves » survenus à partir de l’âge de 30 ans (27,7% du total des événements indésirables), dont 2 551 mises en jeu du pronostic vital, 460 invalidités ou incapacités et 761 décès.
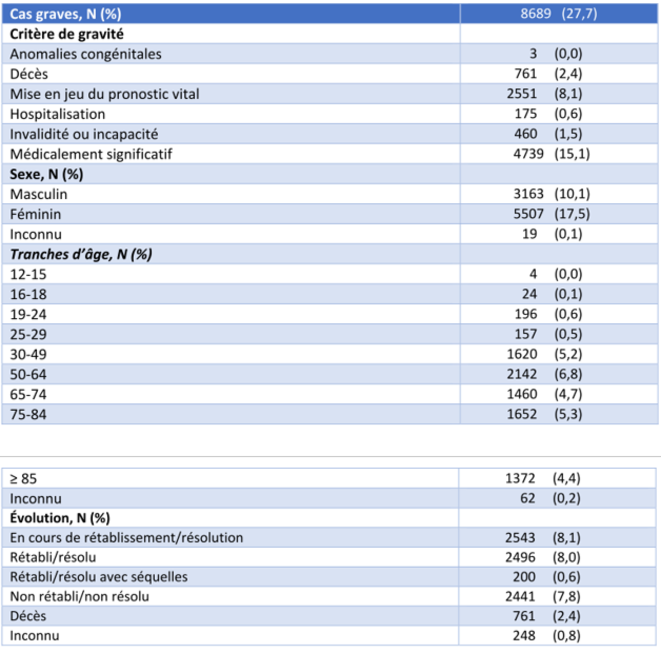
Concernant le vaccin de Janssen, l’ANSM indique que 608 489 injections ont eu lieu au 08 juillet 2021, dont 7% de personnes âgées de 16 à 49 ans et même 407 enfants âgés de 0 à 15 ans, « contrairement aux recommandations nationales de réserver ce vaccin aux plus de 55 ans » ! À la même date, 243 évènements indésirables ont été déclarés, principalement par des professionnels de santé. Parmi ces événements, on note 39 hospitalisations, 4 pronostics vitaux engagés, 1 invalidité ou incapacité et 7 décès.
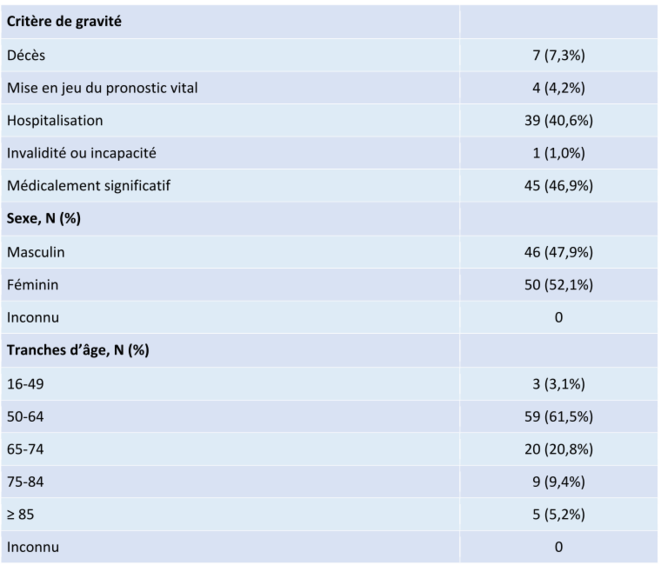
Source : CRPV de Grenoble et CRPV de Lyon, Enquête de pharmacovigilance du vaccin JANSSEN®
Concernant le vaccin de Moderna, l’ANSM indique que 5,2 millions de doses avaient été administrées au 08 juillet 2021, dont près de 53 000 à des mineurs. À la même date, environ 6 000 évènements indésirables avaient été déclarés, dont 14,4% de cas graves et autant de « cas inattendus » (on ignore hélas ce que recouvre cette catégorie), signalés ici presque autant par les particuliers que par les professionnels de santé. Sur les 1 050 événements graves, on note 312 hospitalisations, 50 mises en jeu du pronostic vital, 25 incapacités ou invalidités et 44 décès (dont quelques cas de morts fœtales). Les principaux problèmes constatés parmi ces cas graves sont de type hématologiques/vasculaires (thromboses, AVC, embolies pulmonaires), neurologiques (paralysies faciales, convulsions généralisées), cardiaques (troubles du rythme, myocardites), à quoi s’ajoutent « 28 morts subites inexpliquées ».
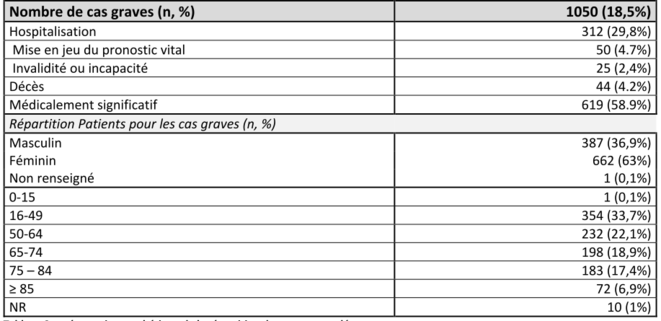
Source : CRPV de Lille, CRPV de Besançon, Enquête de pharmacovigilance du VACCINE MODERNA
De quels effets indésirables s’agit-il précisément ?
Au 8 juillet 2021, au terme d’environ 6 mois de campagne vaccinale, la pharmacovigilance française du vaccin AstraZeneca rapporte un total de près de 43 000 effets/évènements indésirables, dont 9 637 (22,5%) classés comme « graves ». Ces derniers sont des réactions immédiates à la vaccination, des affections du système nerveux (paralysies notamment), des problèmes vasculaires (thromboses, AVC notamment), des problèmes respiratoires graves et cardiaques graves, enfin des problèmes cutanés très importants, des affections hématologiques et des troubles graves de la vision et/ou de l’audition.
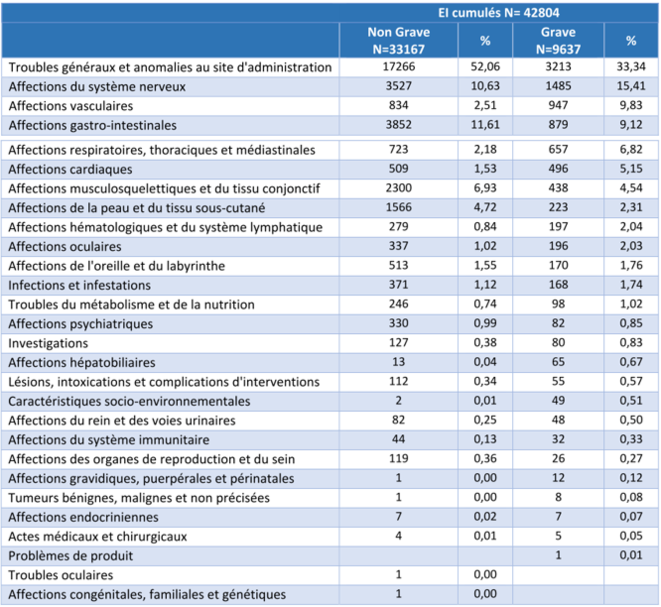
CRPV d’Amiens ‐ CRPV de Rouen, Enquête de pharmacovigilance du vaccin VAXZEVRIA®
La même analyse peut être faite sur les 4 vaccins qui ont des effets indésirables graves en partie différents (surtout neurologiques et nerveux pour le Moderna et le Janssen, davantage cardiaques pour le Pfizer).
Enfin, si l’on additionne les conséquences les plus graves, mentionnés précédemment pour chacun des 4 vaccins, l’on parvient au tableau ci-dessous qui livre le constat de plus de 15 000 événements indésirables graves, parmi lesquels près de 1 800 hospitalisations, plus de 2 800 mises en jeu du pronostic vital et près de 1 000 morts potentiellement liés à la vaccination anti-covid. Le tout en seulement 6 mois.
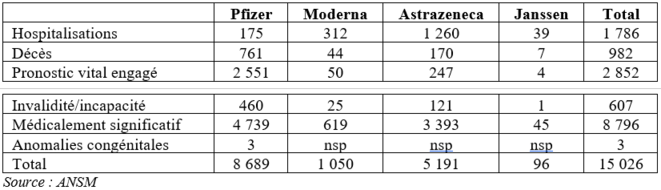
comparaison-des-4-vaccins-en-france
Ce que dit la pharmacovigilance dans d’autres pays occidentaux
Au Royaume Uni, le ministère de la santé indique que, le 14 juillet 2021, ont été administrées environ 20 millions de premières doses et 12 millions de deuxièmes doses du vaccin Pfizer/BioNTech, 25 millions de premières doses et 23 millions de deuxièmes doses du vaccin AstraZeneca (cette firme pharmaceutique étant domiciliée à Londres), et environ 1,3 million de premières doses du vaccin Moderna. Au total, plus de 46 millions de personnes ont reçu au moins une dose et plus de 35 millions deux doses. Le rapport de pharmacovigilance du 22 juillet commence par indiquer que les vaccins sont sûrs et fait tout pour appeler à la vaccination générale. Le début du rapport officiel signale que les vaccins ont des effets indésirables de court terme qui sont très peu graves. Par exemple, pour la Pfizer, « les effets indésirables les plus fréquents dans les essais étaient la douleur au site d’injection, la fatigue, les maux de tête, les douleurs musculaires, les frissons, les douleurs articulaires et la fièvre ; ceux-ci ont été signalés chacun chez plus de 1 personne sur 10. Ces réactions étaient généralement d’intensité légère ou modérée et se sont résorbées en quelques jours après la vaccination ». Certes, le ministère précise aussi avoir enregistré quelques 325 000 signalements d’effets indésirables (dont les deux tiers pour l’AstraZeneca). Mais dans le détail, il précise que « l’écrasante majorité des rapports concernent des réactions au site d’injection (douleur au bras par exemple) et des symptômes généralisés tels que syndrome « grippal », maux de tête, frissons, fatigue (fatigue), nausées (envie de vomir), fièvre, étourdissements, faiblesse, douleurs musculaires et rythme cardiaque rapide. Généralement, ceux-ci surviennent peu de temps après la vaccination et ne sont pas associés à une maladie plus grave ou plus durable ». En un mot : tout va bien. Comme en France, le gouvernement anglais martèle du reste dans son rapport que « les vaccins sont le meilleur moyen de protéger les gens contre le COVID-19 et ont déjà sauvé des milliers de vies. Tout le monde doit continuer à se faire vacciner lorsqu’on lui demande de le faire, sauf indication contraire ». Et pourtant. Une fois passée l’introduction à la gloire de la vaccination, la seconde partie du rapport détaille les effets indésirables : chocs anaphylactiques, paralysie de Bell (paralysie faciale), thromboses (71 décès de ce type avec l’AstraZeneca), troubles menstruels et saignements vaginaux, myocardites et péricardites (surtout avec le Pfizer), réactions cutanées sévères (surtout avec le Moderna), syndromes de Guillain Barré (surtout avec l’AstraZeneca) et enfin des « événements à l’issue fatale », c’est-à-dire des morts. Dans le détail, à la date donc du 14 juillet 2021, l’agence britannique reconnaît 999 morts que les déclarations lient à l’injection du vaccin AstraZeneca, 460 à celle du Pfizer et 31 autres, ce qui porte le total à près de 1 500 morts.
Aux Pays-Bas, le centre de pharmacovigilance (bijwerkinden centrum – LAREB) fait un point mensuel sur la vaccination et ses effets indésirables, ces derniers étant principalement signalés par les citoyens. Dans sa dernière actualisation du 4 juillet 2021, il faisait état de 16,5 millions de doses administrées, principalement le Pfizer (11,8 millions de doses, contre 2,8 millions pour AstraZeneca, 1,3 million pour Moderna et 600 000 pour Janssen). À cette date, 93 453 déclarations d’effets indésirables avaient été remontées concernant les conséquences de la vaccination anti-covid, parmi lesquels les thromboses dans le cas des vaccins AstraZeneca et Janssen. Enfin, le centre comptait 448 décès rapportés comme liés à la vaccination, concernant principalement des personnes âgées et principalement le vaccin Pfizer.
En Europe, le site de pharmacovigilance de l’Agence européenne du médicament est particulièrement difficile à manier informatiquement, le chargement des données concernant les vaccins anti-Covid est compliqué à trouver et extrêmement long à réaliser, quand il fonctionne. Deux chercheurs français les ont cependant étudiées patiemment à la fin du mois de juin et présenté dans cette vidéo. À la fin du mois de juin, la pharmacovigilance européenne avait déjà enregistré environ 9 000 décès liés à la vaccination uniquement pour le vaccin de Pfizer, notamment du fait de complications cardiaques, pulmonaires ou cérébro-vasculaires, inclues des morts par Covid (un comble pour les vaccins anti-covid…). Par ailleurs, ces données livrent également un deuxième constat très préoccupant, qui est le fait que ces risques d’effets indésirables graves concernent non seulement les personnes âgées de plus de 65 ans, mais aussi les nourrissons et les adolescents (12−17 ans). En d’autres termes, les vaccins génétiques anti-covid utilisés en Europe présentent des risques d’effets indésirables graves (pouvant aller jusqu’à la mort) dans des catégories de la population qui ne sont nullement menacées par la Covid. Les professionnels de santé du collectif ReinfoCovid et de la Coordination Santé Libre ont ainsi montré que, en dessous de l’âge de 45 ans, la balance bénéfice/risque est très défavorable à la vaccination génétique anti-covid. Concernant les enfants et les adolescents, elle relève même d’une forme de violence sur mineurs qu’il serait par conséquent criminel de généraliser. C’est du reste l’occasion de rappeler que l’OMS elle-même déconseille la vaccination des jeunes, n’en déplaise au gouvernement français et à ses serviteurs (parmi lesquels l’Académie de médecine dont on se souvient du communiqué du 25 mai 2021).
Enfin, aux États-Unis, où la pharmacovigilance (comme la transparence des données d’administration publique de manière générale) est beaucoup mieux organisée et plus contraignante que dans beaucoup de pays européens, des données très précises peuvent être exploitées sur le site de la Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Et, contrairement à l’argument des industriels, répétés en boucle par les journalistes français (à l’image des fact-checkers déjà cités), ces données sont très largement fiables. Six chercheurs anglais viennent ainsi d’analyser un échantillon de 250 déclarations de décès attribués aux vaccins anti-covid dans la VAERS. Il en résulte que les deux tiers des déclarations ont été faites par des médecins et qu’elles sont fiables à 86%. Or le constat qui ressort des données américaines est plus saisissant encore. En recherchant dans ces données les décès liés à la vaccination, il est possible non seulement d’avoir un comptage détaillé pour chaque vaccin anti-covid, mais de surcroît de pouvoir comparer ces résultats avec ceux de tous les autres vaccins administrés depuis plus de 30 ans dans ce pays. Au 16 juillet 2021, date à laquelle 160 millions d’Américains avaient été intégralement vaccinés, les vaccins anti-covid sont liés à plus de 6 000 décès, 91% d’entre eux étant attribuables aux seuls vaccins de Moderna et Pfizer (deux entreprises pharmaceutiques/biotechnologiques américaines, Janssen étant la filiale belge d’une autre entreprise pharmaceutique américaine, Johnson & Johnson). Nous avons reconstitué le tableau ci-dessous qui donne le détail de ces chiffres.
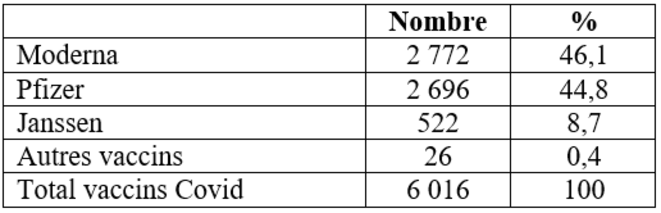
Source : VAERS, calcul réalisé sur les données datant du 16 juillet 2021
Ces décès sont en outre survenus principalement dans les 48h qui ont suivi la vaccination, ce qui renforce considérablement la présomption de causalité. Par ailleurs, ces fichiers permettent donc de comparer cette mortalité des vaccins anti-covid à la mortalité vaccinale globale dans ce pays depuis 30 ans (concernant des centaines de vaccins). Ce fichier donne un total de 16 605 décès pour l’ensemble des vaccins sur toute la période. À elle seule et en seulement 6 mois, la vaccination anti-covid représente donc 36% de la totalité de la mortalité vaccinale dans ce pays depuis 30 ans. Par comparaison, dans la même base de données, nous avons compté le nombre de morts occasionnés par l’administration des différents vaccins contre la grippe saisonnière (influenza seasonal). En 30 ans (1990−2020), ces vaccins ont occasionné 1 106 décès, ce qui représente 6,66% du total de la mortalité vaccinale depuis 30 ans. Une autre façon d’exprimer ces résultats est donc de dire que, aux États-Unis, en 6 mois, la vaccination anti-covid a contribué à tuer 5 fois plus de personnes que la vaccination anti-grippe en 30 ans. Ceci confirme d’une autre façon encore que nous sommes bien en présence de vaccins d’un nouveau genre, dont la dangerosité est inédite. Ajoutons enfin que cette dangerosité doit tout particulièrement interroger lorsqu’elle concerne des personnes jeunes et qui ne sont donc pas sérieusement menacées par la Covid. Or, 23,2% du total des morts américains imputés aux vaccins anti-covid et dont l’âge est connu avaient moins de 65 ans.
Conclusion
La question des effets indésirables graves des vaccins anti-covid fait l’objet d’un déni et d’un silence de la part du gouvernement et des principales agences sanitaires (Agence nationale de sécurité du médicament, Haute autorité de santé, Haut conseil de santé publique, etc.). Tout se passe comme s’il s’agissait d’un véritable tabou, en France comme dans la plupart des autres pays occidentaux. L’importance de ces effets apporte en effet une contradiction trop flagrante et dévastatrice pour l’idéologie de la vaccination intégrale qui guide des gouvernements ayant choisi de s’abandonner dans les bras de l’industrie pharmaceutique. Cette dernière est ainsi au cœur de toute la gestion d’une épidémie qui constitue pour elle une aubaine inédite dans l’histoire : quel produit commercial breveté a pour marché potentiel la totalité de l’humanité, renouvelable chaque année qui plus est ? Patrons et actionnaires de ces firmes pharmaceutiques et biotechnologiques sont en train de devenir immensément riches. Au vu de la façon dont ces industries ont travaillé (dans l’urgence, pour générer un maximum de profits, sans tester les personnes les plus à risque — âge et comorbidités —, à grand renfort de formules de type publicitaire), notamment aux États-Unis et en Angleterre, pour mettre au point ces nouveaux vaccins génétiques (ADN ou ARN), on pouvait ainsi dès le départ redouter que ces produits ne soient pas de très bonne qualité. Mais la réalité dépasse ces craintes et montre que ces vaccins ont davantage d’effets indésirables plus ou moins graves qu’aucun autre avant eux. Nous avons vu ainsi qu’aux Pays-Bas l’on parvient à un taux de 2,7 morts pour 100 000 vaccinés (16,5 millions de vaccinés, 448 morts). En France et aux États-Unis, ce taux monte à environ 3,7 morts pour 100 000 vaccinés. Et en Grande-Bretagne, ce taux grimpe même à 4,3 morts pour 100 000 vaccinés, très probablement en raison de la prépondérance du vaccin AstraZeneca que l’on sait depuis le mois de mars 2021 être le plus dangereux des quatre vaccins couramment utilisés en Occident (en particulier du fait des nombreuses thromboses qu’il provoque et qui commencent à être documentées dans la littérature scientifique médicale, voir par exemple ici et là), ce qui n’est guère surprenant lorsque l’on connaît les conditions dans lesquelles il a été fabriqué en Chine. Au passage, nous avons également signalé que ce fut le premier vaccin administré en France, dès février 2021, aux professionnels de santé. De là une des raisons rationnelles probables de la grande réticence à la vaccination anti-covid que manifestent une partie d’entre eux.
Cette mortalité vaccinale (qui n’est que la pointe émergée de l’iceberg des effets indésirables graves) est donc inédite, elle est particulièrement grave et sa dissimulation l’est plus encore. Soyons clair : dissimuler d’une façon ou d’une autre un tel danger est tout simplement criminel vis-à-vis de la population. Même réduite à ses plus élémentaires principes de déontologie (primum non nocere), l’approche de cette question en termes de santé publique devrait conduire à suspendre d’urgence la campagne vaccinale, à étudier beaucoup plus en détail les données de cette pharmacovigilance (en particulier selon les classes d’âge et en fonction des différents facteurs de risque) et, au terme d’une analyse bénéfices/risques méticuleuse, à déterminer à quelles catégories bien précises de la population il est possible de proposer la vaccination sans risque que les effets indésirables graves soient plus nombreux que les formes graves de la Covid dont elle est censée les protéger. Tout autre approche ne relève pas de la santé publique mais de postures idéologiques ou d’un marketing commercial. Et l’histoire a déjà montré (sur le tabac, sur les pesticides, sur la pollution aux hydrocarbures, etc.) que ces postures et ce marketing étaient responsables de véritables crimes contre les populations civiles. Qu’ils soient commis au nom du Bien ne devrait en aucun cas aveugler sur leur réalité et leur nature. Toutes celles et ceux qui s’y adonnent pourraient être désormais considérés comme complices de cette nouvelle mortalité vaccinale qui semble inédite dans l’histoire de la médecine moderne.
Laurent Mucchielli
À propos des auteurs : Laurent MUCCHIELLI (sociologue, directeur de recherche au CNRS), Hélène BANOUN (pharmacien biologiste, PhD, ancienne chargée de recherches à l’INSERM), Emmanuelle DARLES (maîtresse de conférences en informatique à Aix-Marseille Université), Éric MENAT (docteur en médecine, médecin généraliste), Vincent PAVAN (maître de conférences en mathématique à Aix-Marseille Université) & Amine UMLIL (pharmacien des hôpitaux, praticien hospitalier, unité de « pharmacovigilance/CTIAP (centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutiques)/Coordination des vigilances sanitaires » du Centre hospitalier de Cholet). Contact : [email protected]
Étienne : un autre article a été publié en défense de Laurent Mucchielli et je le trouve vraiment important, ce qui me conduit à le reproduire aussi ici. C’est passionnant, vous allez voir :
Contre la censure de Mediapart, pour Laurent Mucchielli
Par Boris, le 15 août 2021.
Cette décision, en plus d’être absurde, montre surtout à quel point les analyses de Mucchielli sur le journalisme étaient justes.
On pouvait seulement espérer que cela s’applique moins à Mediapart. La décision du journal douche tout espoir. Ou naïveté.
Le 4 août, la rédaction de Mediapart a décidé de censurer un billet de Laurent Mucchielli en le « dépubliant ». Initialement publié le 30 juillet et mis à jour le 1er août, Laurent Mucchielli et cinq coauteurs interrogeaient les effets secondaires de la vaccination, et notamment la mortalité, « inédite » selon eux, au terme d’une démonstration basée sur les remontées de pharmacovigilance française, européenne, et américaine.
La censure du billet n’est sans doute pas très grave pour l’avenir du texte, car ses auteurs ont d’autres ressources pour le publier (le texte a déjà été republié ici, là et ici). Par cette dépublication, Mediapart confirme cependant les critiques formulées au début du billet censuré contre un certain journalisme, que dénonce personnellement Laurent Mucchielli depuis des mois :
« La plupart des journalistes français travaillant dans les médias mainstream ont trahi certains principes déontologiques de base de leur profession, n’exerçant plus leur rôle de contre-pouvoir pour devenir au contraire de simples relais de la communication gouvernementale. En cause notamment, la fin du journalisme d’investigation, remplacé par un fact-checking de bureau qui n’est plus qu’un simulacre de journalisme ».
Mediapart, suppôt du pouvoir ? Le journal, bien sûr s’en défend : il a été « pionnier dans la mise au jour de l’impéritie gouvernementale et présidentielle face à la pandémie, avec nos révélations inaugurales sur le mensonge d’État à propos de la pénurie de masques ». Excusez du peu, voilà du journalisme de guerre !
On verra cependant que c’est plus compliqué, car si Mediapart fait bien preuve d’un anti-macronisme de bon aloi de ce côté-ci de l’échiquier politique, le journal n’a jamais défendu une autre gestion de crise, et ne s’est jamais opposé aux différentes mesures de contrôle et d’enfermement de la population, bien au contraire.
Mais revenons au début.
Pourquoi la rédaction de Mediapart a‑t‑elle censuré l’enquête de Laurent Mucchielli et ses confrères ?
La panique
La première raison, sans doute, c’est la panique.
Le billet de Laurent Mucchielli semble avoir été relayé de nombreuses fois sur les réseaux sociaux, et – comble de l’horreur ! – l’extrême droite, à travers la figure de Gilbert Collard, l’aurait également relayé. Sans doute également le petit monde journalistique parisien s’est mis en branle et a fait pression sur les journalistes de Mediapart, en les interrogeant sur leur nécessaire réaction à venir. En effet, le service de « fact-checking » de l’AFP a publié le jour même de la dépublication un article évoquant l’Affaire Mucchielli, mais sans le contredire sur le fond, puisque l’un des deux experts interrogés affirme que les chiffres de décès sont « des signaux, pas des cas avérés ». Soit exactement ce qu’écrivent Mucchielli & Co.
Mais bon, Mediapart s’est senti piégé, et sous la pression du marigot parisien, par mimétisme, ses journalistes se sont crus obligés d’intervenir.
La seconde raison, ultime disqualification valant anathème pour l’éternité, c’est la qualification de « fausse nouvelle ». Terme attribué sans autre forme de procès, comme c’est la coutume. Voici en quelques points résumé l’argumentaire de Mediapart, publié dans ce billet de blog :
- Laurent Mucchielli et ses co-auteurs sont un peu « fantaisistes » dans leurs calculs, car ils « additionnent tous les effets indésirables déclarés après une vaccination ».
- Or, ce n’est pas bien, parce que « le lien entre ces effets et le vaccin n’est pas toujours formellement établi ».
- Comme l’explique avec patience et pédagogie Mediapart, « il ne suffit pas de déclarer un effet survenu peu de temps après la vaccination pour qu’il soit considéré comme indésirable et imputable au vaccin : le lien de cause à effet doit être étayé ».
- Pfff, et voilà comment on aboutit à une fausse information, alors que c’était pourtant simple de faire confiance à l’ANSM, qui fait toujours son travail d’enquête, qui a justement permis de ne distribuer AstraZeneca qu’aux personnes âgées après plusieurs décès chez les moins vieux, puis de tout refourguer aux pays
pauvresen développement dans le cadre du dispositif Covax. C’est une bonne idée, puisque s’y trouvent principalement des populations jeunes, la cible préférée du vaccin d’Astra Zeneca. Mais revenons à nos moutons. - D’ailleurs, la cellule investigation de Mediapart a fait un travail d’enquête acharné : « concernant les cas de décès déclarés par des proches de personnes ayant reçu une injection de Pfizer-BioNTech en France, l’agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a répondu en mai à Mediapart que les données ne permettaient pas « de conclure qu’ils sont liés à la vaccination ». L’ANSM l’a dit à Mediapart, Mediapart a confiance, il n’y a donc pas de danger avec les vaccins.
Deux poids deux mesures
Détail amusant : comme justification à leur raisonnement, les journalistes de Mediapart renvoient à une « mise au point de pharmacologues ».
Faisons à notre tour du « fact-checking » : en guise de mise au point, le lien renvoie vers… un article de Yahoo ! actualités non signé ! En termes de sources et de rigueur, on peut faire mieux pour un journal « dont même ses critiques reconnaissent le sérieux informatif » ! Et en termes de pharmacologues, au nombre de deux, on se la pose là : il s’agit en l’occurrence de Matthieu Molimard, chef de Service de Pharmacologie Médicale au CHU de Bordeaux, qui affirmait en mars qu’« une fois bien vacciné, tous vaccins confondus », il n’y avait plus de risque de transmettre le Covid. On sait ce qu’il en est… Pas avare d’affirmations péremptoires, il affirmait encore sur son compte Twitter : « Il n’y a AUCUN exemple de vaccin qui a induit des effets indésirables à long terme qui ne s’étaient pas manifestés dans les 2 mois après la vaccination ». Le professeur Molimard avait sans doute oublié le Dengvaxia de Sanofi, mais il a une excuse : cela concernait principalement des enfants philippins (600 au moins en sont morts), et les Philippines… c’est loin.
L’autre « pharmacologue » de l’article est Michael Rochoy, en réalité médecin généraliste à Outreau. S’il a bien été un jour interne en pharmacologie, Michael Rochoy est surtout membre des groupuscules extrémistes « Du côté de la science » et « Stop Postillon », collectif dont il est co-fondateur (ce que l’article de Yahoo ! ne signale pas). Ces deux groupuscules n’ont cessé d’avoir une parole extrêmement anxiogène, notamment à l’attention des syndicats d’enseignants SNUipp-FSU et SNES-FSU, de s’inquiéter du trop-plein de libertés laissées aux Français, et de prôner des mesures toujours plus renforcées dans les écoles, en prônant par exemple de séparer chaque enfant avec des vitres en plexiglas, ou en militant très tôt pour le port du masque en école primaire. Sur les vaccins, « Du côté de la science » s’est distingué en tentant de montrer que la responsabilité du vaccin Astra Zeneca dans la survenue des thromboses était sans doute liée à une erreur d’aiguillage, et n’avait rien à voir avec la composition du vaccin… Bref, deux « pharmacologues » fiables et impartiaux, pour une mise au point digne des plus grands « fact-checkers ».
Autre deux poids deux mesures, il semble que toutes les fausses informations ne se valent pas. Gageons qu’il y en a au moins deux concernant cette crise qui ne seront jamais censurées :
- Si j’écris sur mon blog que les masques sont très efficaces en population générale pour stopper l’épidémie, il est fort probable que je ne serai jamais inquiété. C’est pourtant une fausse information, puisque l’une des conditions d’efficacité du masque est qu’il soit bien porté, et bien manipulé. « S’il est mal utilisé, un masque ne parviendra pas à réduire efficacement le risque de transmission », écrivait l’OMS en janvier 2020, et d’ajouter que le danger principal était « d’augmenter le risque de transmission associé à un usage et à une élimination inappropriés ». Mais le Sars-Cov‑2 est une maladie tellement bizarre que les masques semblent efficaces pour tout le monde, même les enfants, et que les risques de contamination secondaires ont disparu. La dissonance cognitive est telle que les journalistes n’arrivent pas à tirer les conclusions des clusters liés à l’utilisation de masques de type FFP2 mais à l’ergonomie moindre (les masques KN95), ou aux résultats de fit-testing pour les masques FFP2.
- Si j’écris sur mon blog que les vaccins sont efficaces pour stopper les contaminations, fausse information dommageable en termes de santé publique, mais diffusée largement et avec insistance par le gouvernement, il est probable que je ne serais pas plus inquiété. Blanquer peut l’affirmer et justifier ainsi « d’évincer » des élèves à la rentrée (ce qui se fait déjà dans les centres de loisirs durant cet été), tout comme la préfecture de l’Isère dans ce récent communiqué, en toute impunité.
N’est pas censuré pour des « fake news » qui veut.
Mediapart donne par contre la parole à nombre de pourvoyeurs de fausses informations (mais estampillées « vu à la télé »), en relayant par exemple des chiffres impossibles sur la mortalité du Covid en 2020[1], ou en accordant du crédit à Antoine Bristielle, qui n’a jamais produit ses données, et dont les études sont sujettes à caution.
Pharmacovigilance ou pharmacodélinquance ?
C’est très bien de faire confiance au système de pharmacovigilance, comme le font les journalistes de Mediapart avec cette sérénité du devoir accompli, mais l’ANSM est-elle bien cette amie qui vous veut du bien ?
Contrairement à nos journalistes, on peut peut-être en douter : l’agence sur laquelle s’appuie Mediapart pour disqualifier le billet de Mucchielli vient juste, dans l’affaire du Mediator, d’être jugée coupable de « blessures et homicides involontaires », et d’être condamnée à 303 000 euros d’amende. Pas de quoi fouetter un laboratoire pharmaceutique. Le tribunal a également donné son avis sur cette agence, dans son jugement rendu le 29 mars 2021 (c’est loin déjà) : l’ANSM « a failli dans son rôle de gendarme du médicament », son « imprudence » et ses « négligences » ont été mortelles, et ont contribué à « renforcer la défiance des citoyens envers les autorités de santé » (Le Monde, 30 mars 2021).
Pas la défiance de Mediapart apparemment.
Mais l’ANSM (elle s’appelait alors l’Afssaps) a‑t‑elle changé depuis l’affaire du Mediator, médicament dénoncé pendant des années par la revue Prescrire, et qui a éclaté grâce à la pneumologue Irène Frachon, devenue malgré elle lanceuse d’alerte ?
Dans un article publié le 29 mars 2021, France Info pose la question. La réponse est claire : c’est non.
Interrogée, Catherine Hill, membre du conseil scientifique de l’Afssaps à l’époque du Mediator (et que l’on a appris à connaitre durant cette crise du Covid), critique justement le système de remontées basé sur le « principe d’imputabilité » et le fait qu’il faille prouver le lien de cause à effet. Exactement le principe dans lequel croit Mediapart :
« Les signalements qui remontent via les soignants et les patients sont certes facilités et plus nombreux, mais, selon l’épidémiologiste [Catherine Hill], leur traitement repose trop sur le “principe de l’imputabilité”, à savoir la recherche d’un lien de cause à effet connu entre le médicament et un symptôme observé. Si ce lien n’est pas déjà établi dans la littérature scientifique, il est écarté au bénéfice du doute. Un doute qui, en l’occurrence, profite toujours au médicament. “Avec le système actuel, on dézingue les remontées. La preuve, on continue à avoir tout un tas d’emmerdements”, fustige-t-elle. » (France Info, 29 mars 2021)
Un tas d’emmerdements ? J’espère qu’elle ne parlait pas des vaccins…
Alors que l’ANSM est également poursuivie depuis 2016 dans le cadre de l’affaire de la Dépakine (près de 3000 enfants malformés) pour « tromperie aggravée » et « blessures involontaires », l’agence de sécurité du médicament a‑t‑elle eu un rôle plus glorieux dans le scandale plus récent du Levothyrox ? Que nenni : après que son directeur a défendu la nouvelle formule du médicament aux côtés de Merck, l’ANSM n’a rien trouvé de mieux que de recourir à la loi sur le secret des affaires pour dissimuler partiellement le document d’autorisation de mise sur le marché du Levothyrox. Dans un article de Libération de juin 2021, le Docteur Philippe Sopena concluait sur cette affaire : « Au final, c’est un exemple caricatural de ces liens confus entre les Big pharma et les autorités sanitaires […], l’Agence n’a pas joué son rôle. La ministre a soutenu l’Agence, et au final ce sont les malades qui trinquent. Quant aux grands médecins qui ont dit que tout cela n’était dû qu’à un effet nocebo, ils feraient bien de reconnaître leurs erreurs ».
On peut d’autant plus douter que l’ANSM ou les autres agences de pharmacovigilance étrangères fassent du zèle, puisqu’en cas de problème avéré, ce sont les États qui paieront la facture, et non les laboratoires pharmaceutiques. Or en France, toujours selon l’article de France Info, l’ANSM fait « office d’airbag entre le sommet de l’Etat et les scandales sanitaires ». « Ce n’est pas une autorité indépendante, elle est sous la tutelle de la direction générale de la santé », rajoute l’ex-député PS Gérard Bapt, qui a présidé la mission d’information parlementaire sur le Mediator, en 2011.
Mediapart est bien placé pour connaître l’indulgence de l’ANSM face à l’industrie pharmaceutique, puisque le journal avait, à la suite du Figaro, dénoncé le scandale de l’essai clinique Biotrial en 2016. Mais c’est si loin, et c’était d’autres journalistes.
2016, c’était aussi l’année où sortait le livre de Dominique et Philippe Courtois, Le livre noir de la médecine : patient aujourd’hui, victime demain. Dans un entretien donné à L’Usine nouvelle, ce dernier dénonçait l’ANSM, cette « alarme qui ne sonne jamais ». Et pour cause : « Citez-moi un seul scandale sanitaire révélé par l’agence du médicament ! Il n’y en a aucun », rappelait-il. À chaque fois, ce sont les victimes qui ont porté plainte, saisi la justice. Hormis le cas du Mediator, où Irène Frachon a donné l’alerte, ni les organismes de contrôle ni les médecins n’ont joué leur rôle de vigie. Ni les journalistes, pourrait-on rajouter.
C’est vrai qu’on ne peut pas mener une enquête d’un an et demi sur la sexualité de Juan Branco, et faire une enquête sur les données de pharmacovigilance. Il faut choisir : il n’y a pas le temps pour tout.
Alors que les médias se focalisent sur les procès intentés aux laboratoires pharmaceutiques, on oublie que les médecins sont parmi les premiers responsables de ces scandales, notamment en détournant de leur usage les médicaments ou en prescrivant massivement des produits dangereux : c’est massivement le cas dans la crise des opioïdes, qui implique non seulement les laboratoires pharmaceutiques, les médecins, mais aussi les cabinets de conseil comme MacKinsey, très influent sur la stratégie vaccinale française car si proche du gouvernement, si proche du Conseil constitutionnel, si proche d’Emmanuel Macron… On oublie également le rôle des médecins dans les scandales du Mediator prescrit comme coupe-faim, l’antiacnéique Diane 35 prescrit comme pilule contraceptive, etc.
En partie pour cette raison, ils ne sont pas les plus pressés pour remonter les effets secondaires des produits qu’ils prescrivent, ou qu’ils inoculent !
En particulier, les médecins généralistes signalent très peu d’évènements indésirables médicamenteux : en 2019, ils signalaient moins de 6% des événements indésirables, les spécialistes en signalant la moitié. Les patients, historiquement quasiment absents des remontées, semblent prendre depuis peu une part plus active au système, avec – attention les yeux – 13% des remontées en 2019 (ANSM, Rapport d’activité 2019, p. 65).
Le médecin Martin Winckler, par ailleurs ancien rédacteur à la revue Prescrire, souligne un problème de fond, en plus du poids des laboratoires pharmaceutiques tout au long de la formation et de la carrière médicale : « les médecins ne sont pas formés à la pharmacovigilance ».
Au lieu de censurer le billet de blog de Laurent Muchielli, les « spécialistes santé » de la rédaction (Rozenn Le Saint, Caroline Coq-Chodorge…) feraient mieux d’interroger les infirmières et infirmiers de terrain, au lieu de s’accrocher aux données impersonnelles de pharmacovigilance et de n’interroger que les directeurs d’établissements médicaux et les médecins, qui ne passent plus de temps avec les patients.
Il y a quelques jours, une amie infirmière m’a rapportée ce cas : un patient de 94 ans fait brusquement un prurit suintant sur le haut du corps, doublé d’une grande fatigue l’empêchant de se lever ; il commence même à faire une escarre aux fesses. Mon amie signale le cas par téléphone au médecin traitant, et explique que rien n’a changé dans le traitement de la personne âgée, hormis l’injection d’une seconde dose de vaccin contre le Covid. Aucun lien pour le médecin qui n’aura pas vu le patient : il diagnostiquera une allergie au soleil comme cause du prurit. Problème : le patient, très peu mobile, n’a pas vu le soleil de la semaine…
Des remontées comme celle-ci, j’en ai plusieurs fois par semaine, quand il ne s’agit pas de cas plus graves. Une personne rencontrée sur un marché m’a raconté le décès d’une amie de 38 ans par hémorragie il y a quelques semaines. Aucun lien avec le vaccin pour cette jeune femme par ailleurs en bonne santé : la 2e dose avait eu lieu huit heures avant. Bien plus que le quart d’heure réglementaire pour observer une « allergie ».
Par idéologie, foi dans la nécessité des vaccins, esprit missionnaire, ou simplement fatigue de l’épidémie, les médecins taisent et dissimulent des liens de cause à effets entre vaccins et effets secondaires bien plus souvent qu’à l’accoutumée. Cela n’est sûrement pas systématique, mais sans doute trop fréquent.
En réalité, l’ANSM et ses interprétations des données de pharmacovigilance ne sont pas fiables. Il est donc tout à fait nécessaire que des personnes comme Laurent Mucchielli, qui s’appuie sur une équipe de scientifiques compétents, analyse ce genre de données. Les contester sur le fond est toujours possible, mais ce n’est pas la voie qui a été choisie.
Il n’est pas interdit de penser que si Irène Frachon alertait aujourd’hui sur les vaccins, elle serait censurée de la même manière par Mediapart. Triste et dangereuse époque.
Un anti-macronisme qui voile une absence de critique sur le fond des mesures pour contrer l’épidémie
Mediapart assure avoir été « pionnier dans la mise au jour de l’impéritie gouvernementale et présidentielle face à la pandémie, avec nos révélations inaugurales sur le mensonge d’État à propos de la pénurie de masques », et dit défendre une « politique de santé résolument démocratique, reposant sur la confiance dans la population avec un débat ouvert, une large transparence, une pédagogie des enjeux ».
En réalité, Mediapart n’a jamais dénoncé les principes sous-jacents de la gestion de crise, pas plus que les interprétations officielles et dominantes. Loin de critiquer les confinements, Mediapart a souvent simplement critiqué leur mise en œuvre autoritaire, permettant effectivement de faire preuve d’un anti-macronisme primaire. L’anti-macronisme est justifié pour d’innombrables raisons, mais en l’occurrence, la critique de la gestion sanitaire, qui est une gestion par des mesures de police largement partagée dans le reste du monde, ne peut se contenter de se focaliser sur la figure de Macron ou du gouvernement. Mediapart ne s’oppose pas non plus au passe sanitaire, et semble accepter cette gestion numérique de la population pourvue qu’elle soit menée avec « pédagogie », comme au Danemark. Y a‑t‑il de quoi être consterné par notre époque ? Oui, bien sûr, surtout si on est un « débouté du QR code » semblent penser certains journalistes, pour qui le vrai scandale c’est que ça ne marche pas à tous les coups, révélation des dysfonctionnements de l’administration française. Ah…si les trains pouvaient arriver à l’heure ! Et moi qui croyais que c’était d’être débouté de la vie normale qui était consternant, débouté de la piscine avec ses enfants, débouté des transports en commun pour aller voir des amis… Et bien moi, je suis consterné par ce journalisme.
Un climat d’intimidation et de stigmatisation des voix dissidentes
Ce n’est pas la première fois que des billets sont censurés sur Le Club. Dans les cas que j’ai observés, la censure démontre souvent une incompréhension et une incompétence de la part des modérateurs, qui se fient souvent aux sites de « fact-checking » auto-proclamés, et pratiquent leur métier en dilettantes. C’est arrivé récemment à Enzo Lolo, et plus anciennement à Gabas, dont j’avais rapporté la mésaventure.
Mais à forte dose, et surtout quand elle s’applique à des universitaires et des professionnels de santé[2] qui ont le courage de publier en leur nom propre (Enzo Lolo et Gabas sont a priori des pseudonymes), cette censure participe d’un climat d’intimidation et de stigmatisation des voix dissidentes. Renforcé ici quand c’est le fait de la rédaction du journal, et non celui de modérateurs incompétents[3].
Dans un article de Reporterre publié le 24 avril, La discussion du Covid-19 est placée sous couvre-feu, Célia Izoard dénonçait le « système d’exclusion discursif » particulièrement prégnant depuis le début de la crise, permettant « de valider certains discours et d’en exclure d’autres », de faire le partage « entre la parole recevable et la parole irrecevable ».
Elle rappelait les propos de Stefan Baral, épidémiologiste à la Johns Hopkins University, qui dans un article du New Statesman, décrit le « “climat de peur très élevé qui règne dans la communauté scientifique” touchant les idées allant à l’encontre des positions adoptées par les gouvernements occidentaux (…) et l’Organisation mondiale de la santé. » Et de citer l’exemple de cette épidémiologiste qui, pour avoir contesté le bienfondé du confinement, fut accusée sans fondement d’être « financée par ou affiliée à des groupes d’extrême droite ou de faire de la pseudo-science ». Reprenant l’exemple de John Iannidis, qui a également contesté l’utilité des confinements (crime de lèse-majesté), Célia Izoard analyse :
« Évidemment, quand un ponte de la discipline est ainsi attaqué, cela terrorise, par ruissellement, la grande masse des jeunes chercheurs non titulaires qui n’oseront pas compromettre leur carrière en suggérant des pistes de recherche non orthodoxes. “Ce climat délétère crée un cercle vicieux, écrit Maxime Langevin, polytechnicien et doctorant en mathématiques. Certaines questions scientifiques ne peuvent être posées sans susciter un tollé, dissuadant les scientifiques d’étudier ces questions et de s’exprimer dessus, justifiant encore plus le climat — l’opinion publique imaginant que si ces questions n’ont jamais été posées, c’est très certainement que la réponse donnée par le point de vue dominant doit être évidente”. »[4]
C’est exactement ce qui arrive à Laurent Mucchielli depuis le début de cette crise.
Sociologue profondément de gauche, il s’est engagé très tôt contre la gestion policière de la crise qui l’a dès le début profondément choqué, contrairement à d’autres à la colonne vertébrale éthique et morale plus molle. On peut critiquer certaines de ses positions, mais combien se sont battus avec la même énergie, et se sont mis autant en danger sur le plan de la carrière, pour faire valoir une vision défendant une gestion de crise par le sanitaire, en protégeant les libertés et sans accepter ce management par la peur ?
En septembre 2020, Laurent Mucchielli tentait de publier une tribune dans le JDD, sous le titre « Il est urgent de changer de stratégie sanitaire face à la Covid-19 ». Signée par près de 300 scientifiques, la tribune, déjà, était censurée, sans raison.
Peu avant, Le Parisien publiait cependant une autre tribune co-signée avec 34 chercheurs, universitaires et médecins : « Covid-19 : nous ne voulons plus être gouvernés par la peur ». Comme en réponse à cette demande inqualifiable, L’Express, inventaire de l’expression « rassuristesTM » (et depuis revendue à de nombreux médias), le qualifiera de cet adjectif dans un dossier à charge en octobre 2020, avec un reproche principal piquant de la part de journalistes : douter du gouvernement. « Quand on interroge les « rassuristes », on découvre une défiance généralisée face aux décisions, mais aussi aux chiffres, du gouvernement. Mucchielli, Toussaint et Toubiana ne s’en cachent pas : leur but est de dénoncer la politique des autorités sanitaires, en démontant les mesures visant à contenir l’épidémie ». Oui, Mucchielli a bien participer à cette volonté de douter, de remettre en cause, de réfléchir à la pertinence des mesures telles que le confinement. Cela aurait aussi pu être le travail des journalistes.
Ce climat de censure auxquels participent les médias au même titre que les plateformes numériques privées (Facebook, Google, etc.) participe à ce consensus autour de l’épidémie et de sa gestion. Mais en interdisant toute voix dissidente, ce consensus n’est-il pas pipé ? C’est justement ce que pense Maxime Langevin, qu’a relayé Laurent Mucchielli : « l’apparition d’un consensus scientifique fiable » est empêchée par la pratique de l’auto-censure et de l’anathème sur tout objet de discussion jugé non discutable : les masques, le confinement, les vaccins, le passe sanitaire…
Un boulevard pour l’extrême droite
Enfin, il ne faut pas s’étonner si ce climat oppressant laisse le champ libre à l’extrême-droite, à qui les médias et partis se réclamant « de gauche » ont laissé un boulevard.
Les Patriotes de Florian Philippot ont ainsi pu s’imposer en tête de nombreux cortèges contre la vaccination obligatoire et le passe faussement dit sanitaire, puisqu’ils manifestent quasiment seuls depuis des mois contre des mesures absurdes, comme le port du masque en extérieur. Le 21 décembre 2020, lorsque le gouvernement avait lancé son premier ballon d’essai sur le passe numérique à travers le projet de loi « instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires », seuls les partis de droite et d’extrême droite s’étaient offusqués.
Les médias tels Sud Radio, Valeurs actuelles, n’ayant pas grand-chose à perdre car déjà en marge, en ont profité pour remplir le vide de la critique de la gestion de crise, alors même que Charlie Hebdo, le Canard enchainé, France Inter et ses (pathétiques) humoristes d’État, Libération, Le Monde, Mediapart, etc., applaudissaient le confinement, réclamaient la fermeture des écoles, et critiquaient le gouvernement lorsque les mesures de privation de liberté n’étaient pas prises assez tôt. Au contraire, si l’on ne prend que les principaux médias journalistiques, il aura fallu écouter ou regarder Sud Radio, lire Valeurs actuelles ou Le Figaro pour avoir des opinions divergentes interrogeant et s’inquiétant des mesures liberticides et absurdes telles que le confinement, le couvre-feu, ou le passe sanitaire[5]… Le monde à l’envers ?
Il aura fallu des mois pour que les partis dits de gauche (le Parti socialiste n’est pas inclus sous cette dénomination) s’indignent des mesures de police, un an pour que François Ruffin crie « Je n’obéirai plus » à l’Assemblée. Il aura fallu plusieurs longs mois pour que des universitaires prennent le risque de dénoncer publiquement le risque démocratique que fait peser aujourd’hui la gestion autoritaire et technocratique de l’épidémie, qualifiée de « syndémie »[6].
Heureusement, Mediapart peut s’appuyer sur le Club et l’extraordinaire vivier de contributeurs anonymes ou non qui publient sur leurs blogs des textes parfois d’excellente qualité. C’est dans le Club que des hommes et des femmes « de gauche » ont ainsi pu s’exprimer dès le début de la crise, tel le juriste Paul Cassia qui a produit très tôt des billets remarquables sur les errances du Conseil constitutionnel ou du Conseil d’État, et Laurent Mucchielli, qui s’est emparé rapidement des questions posées par la gestion gouvernementale de cette crise, ce qui lui est maintenant reproché. Sans oublier des militants ou militantes déterminées, à l’instar d’Elisa et son blog de Zazaz.
L’attrait de Mediapart tient principalement à ces voix complémentaires et parfois dissonantes qui permettent de connaitre des aspects abordés par aucun autre média.
La censure d’un billet de Laurent Mucchielli par la Rédaction de Mediapart est donc bien hypocrite : ses billets apportent un pluralisme bienvenu qui contribue à l’attrait du média, puisque la confusion existe pour beaucoup entre Le Club et la rédaction. Confusion sans doute très favorable à Mediapart. Mucchielli est un des seuls, avec Enzo Lolo et quelques autres qu’il me reste à découvrir, à apporter une expertise discordante et fouillée. Il faut leur répondre sur le fond, ce qui pourrait être stimulant, et non balayer leurs arguments d’un revers de main ou par des « mises au point » bancales ou fallacieuses.
La question maintenant reste entière, la rédaction de Mediapart reconnaîtra-t-elle son erreur et republiera-t-elle le billet de Mucchielli, ou cédera-t-elle au « biais des coûts irrécupérables » ?
Mais par-dessus tout, les journalistes de Mediapart auront-ils le courage de refaire du journalisme en allant sur le terrain pour interroger à la source les « données » ? Pour questionner ce que cette crise dit de la gestion techno-totalitaire anticipée par Günther Anders, Aldous Huxley, ou Bertrand Russell, vers laquelle se dirigent nos sociétés ?
Boris.
Notes
[1] J’ai envoyé mon billet à Rozenn le Saint, qui n’y a jamais répondu. À sa décharge, je ne sais pas si elle est joignable à travers la messagerie interne de Mediapart.
On sait que la manipulation ne se fait pas principalement via les fausses informations : il est beaucoup plus simple de mentir par omission. Ainsi, Mediapart n’a jamais évoqué certains travaux, tels ceux de Dominique Labbé et Dominique Andolfatto, dont Laurent Mucchielli s’est fait l’écho sur son blog, ou a négligé pendant longtemps les questionnements liés aux tests PCR et leur valeur Ct, le suivi épidémique à travers les eaux des égouts par les sapeurs-pompiers de Marseille (France Soir était le premier média à les interroger et à relayer leurs travaux). J’ai interpelé en février 2021 la rédaction de Mediapart sur le rapport à venir de la délégation sénatoriale à la prospective (voir mon billet « Le moment Tchernobyl de la démocratie et des libertés ») : je n’ai jamais reçu de réponse, et Mediapart ne s’est jamais fait l’écho de ce rapport pourtant révélateur.
[2] Les auteurs sont Laurent MUCCHIELLI, sociologue, directeur de recherche au CNRS, Hélène BANOUN, pharmacien biologiste, PhD, ancienne chargée de recherches à l’INSERM, Emmanuelle DARLES, maîtresse de conférences en informatique à Aix-Marseille Université, Éric MENAT, docteur en médecine, médecin généraliste, Vincent PAVAN, maître de conférences en mathématique à Aix-Marseille Université, Amine ULMILE, pharmacien des hôpitaux, praticien hospitalier, unité de pharmacovigilance du Centre hospitalier de Cholet.
[3] Pour ma part, je crois que le travail de modérateur ou modératrice demande une solide culture juridique, ainsi qu’une excellente capacité à chercher des informations ou à les vérifier, ainsi qu’une bonne connaissance historique. Bref, à mille lieux des CV des modérateurs d’aujourd’hui. L’exigence devrait être la même que pour les relecteurs employés jadis dans les rédactions : un excellent niveau de français, et une intelligence du texte.
[4] Cela s’est vu par exemple avec l’étude Co-ki, qui interrogeait les effets secondaires du masque sur les enfants. Menée auprès de plus de 25000 personnes, les résultats de l’étude ont été retardés pendant des mois, jusqu’à une 4e version. Fait exceptionnel, l’éditeur de Research Square s’était fendu d’une note, dont voici un extrait : « The limitations of the study include sampling bias, reporting bias, and confounding bias as well as lack of a control group. The use of masks, together with other precautionary measures, significantly reduces the spread of COVID-19 and is considered safe for children over the age of two years old ». Malgré les résultats de l’étude, impossible de contredire la doxa…
[5] et bien sûr France Soir, non classé sur l’échiquier politique. Ne regardant pas la télé, je ne saurais parler des autres médias.
[6] La « syndémie » est un terme utilisé pour décrire un cadre conceptuel visant à comprendre les maladies ou problèmes de santé et la façon dont ils sont exacerbés par le milieu social, économique, environnemental et politique dans lequel vit une population (Andermann). En réalité, de nombreuses maladies sont des syndémies : l’asthme, l’obésité, la tuberculose, le VIH, même la grippe dans certains cas… la liste est longue. Ce n’est donc absolument pas une exclusivité du Covid.
Étienne : pensez, s’il vous plaît, à faire connaître ici, dans les commentaires de ce billet, tout ce qui, à votre connaissance, pourrait compléter ces informations sur la DANGEROSITÉ des « vaccins » (avec des guillemets) que l’État veut nous injecter de force à tout prix.
Fil Facebook correspondant à ce billet :
Aucun puisque Facebook ferme désormais tous les comptes de ceux qui s’opposent au gouvernement des multinationales…
Tweet correspondant à ce billet :
La dangerosité des nouveaux vaccins anti-covid est un fait historique (article collectif important autour de Laurent Mucchielli)https://t.co/4zX2CY6uVI@LMucchielli est un spécialiste de la VIOLENCE D’ÉTAT, particulièrement légitime et utile en ces temps de bascule totalitaire.
— Étienne Chouard (@Etienne_Chouard) September 9, 2021
Fil Telegram (très récent et plutôt orienté « bascule totalitaire » ces temps-ci) correspondant à ce site :
https://t.me/chouard
Le #5 de la Gazette des Amis du RIC (août 2021) est paru 🙂
Chaque mois, les principales actualités et actions des personnes œuvrant pour l’instauration du RIC et d’une démocratie digne de ce nom.
Sommaire
Les invitations à l’action
• Pétition : Obtenir le RIC pour pouvoir voter sur le pass sanitaire !
• Atelier d’écriture d’un « PCPP »
• Rejoignez et faites connaître le Telegram du RIC
• Répondez à la consultation sur les principes du RIC
Vidéos
• En démocratie… Comment serait gérée la crise sanitaire ?
• Premières auditions démocratiques du MCP
• Appel aux militants de la France Insoumise
• Témoignage et audition de Raul Magni-Berton
Infos utiles
• Mise à jour du classement des propositions de RIC
• Synthèse des stratégies d’instauration du RIC
• Outils d’organisation utiles pour les acteurs du RIC
• Le RIC en chiffres, pour mesurer nos avancées
Agenda
• Événements locaux
• Événements numéRIC
Les productions artistRIC
• Salut RIC – Rue de la Forge
• LES GILETS JAUNES – Paco Jola-bi et Fred Gillig
• Par le Peuple, pour le Peuple ! RIC ! – PIANOMAD
Tweet correspondant à ce billet :
…
Publication Facebook correspondant à ce billet :
…
Rendez-vous avec Clara Egger mercredi prochain 25 août 2021 à 21h
Super sujet : et si on était vraiment en DÉMOCRATIE, qu’est-ce qui changerait dans les mairies ?
Live Facebook :
« Si les Français avaient l’initiative et le dernier mot sur les décisions prises, qu’est-ce qui serait différent dans nos communes et dans les politiques locales ?
Clara Egger détaillera dans ce live la situation démocratique de la France, et ce qui serait différent si nous avions une vraie souveraineté populaire. »
PS : Clara était malade et a dû repousser le live de samedi 21 août à mercredi 25 août à 21h
Discussion sur les enjeux démocratiques avec Jacques Cheminade (juillet 2021)
Vous trouverez dans cet échange quelques idées originales. C’est toujours intéressant de réfléchir avec Jacques, je trouve. Cet homme est réfléchi, cultivé, déterminé, il pense le bien commun depuis des décennies, c’est un des premiers parmi nous (depuis plus de 30 ans) à s’être battu contre ce qu’il appelle « le cancer financier ».
Sur la fin de l’échange, il m’est apparu que nous n’allons pas être d’accord, enfin pas d’emblée en tout cas, sur la politique monétaire capable d’émanciper le peuple des usuriers. Ce serait bien que nous prenions le temps, un jour prochain, de confronter nos idées à ce sujet, toujours avec une bienveillance constructive.
Fraternellement.
Étienne.
Rediffusion du rendez-vous qui a eu lieu le 16 juillet à 21h sur Discord avec Jacques Cheminade sur les enjeux démocratiques :
▶️ Pour passer à l’action : https://www.chouard.org/agir
▶️ Pour s’abonner : https://www.chouard.org/abonnement
Le site de Jacques Cheminade : https://jacquescheminade.fr
Merci à Samy et à son groupe Discord pour l’organisation : https://t.co/028rKuac63
Appel à signer la pétition : instituer le RIC pour pouvoir voter sur le pass sanitaire
Le Mouvement Constituant Populaire initie un appel à signer cette pétition rassembleuse pour le RIC qui a déjà plus de 300 000 signatures, afin de faire avancer la cause et pouvoir un jour avoir le droit de décider de voter sur les sujets importants, comme le pass sanitaire.
Le RIC est le meilleur moyen de pouvoir décider nous-mêmes sur les sujets importants comme le passe sanitaire. Cette décision aura un impact très important sur la liberté des citoyens au quotidien… alors elle devrait être prise – démocratiquement – par référendum… plutôt qu’être prise par une minorité de dirigeants comme aujourd’hui…
Si nous avions le RIC, cette question serait tranchée par les citoyens, légitimement…
« À force de sacrifier l’essentiel pour l’urgence, on finit par oublier l’urgence de l’essentiel. » (Edgar Morin)
En savoir plus sur le Mouvement Constituant Populaire : le mouvement qui se dédit à l’instauration d’un Processus Constituant Populaire Permanent tel le RIC Constituant… et à donner aux citoyens les clés de leur destin.
Par sécurité, merci de confirmer votre adresse mail.
Un courriel sera en route dans votre boîte mail contenant un lien de confirmation.
Source : Le MCP appel à signer la pétition : Obtenir le RIC pour pouvoir voter sur le pass sanitaire
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10159415559747317
Tweet correspondant à ce billet :
Appel à signer la pétition :
instituer le RIC pour pouvoir voter sur le pass sanitairehttps://t.co/vaVS8kuJPE— Étienne Chouard (@Etienne_Chouard) August 14, 2021
[Abus de pouvoir, fake-news officielles] Les chiffres de la DREES — qui justifient les persécutions des opposants politiques en France — sont grossièrement FAUX : « Efficacité de la vaccination : Il manque plus de la moitié des décès ! » par Pierre Chaillot
Description :
Le 13 juillet 2021, la DREES, la direction réalisant les statistiques pour le ministère de la santé a sorti une étude récapitulant les données connus des résultats de tests Covid-19 pour les vaccinés et les non-vaccinés en France.
Cette étude a été complétée le 23 juillet 2021 par une autre étude ajoutant cette fois-ci les données d’hospitalisations et de décès liées à la Covid-19.
Cette dernière étude est utilisée en ce moment par le gouvernement et les médias pour justifier la politique vaccinale, puisqu’elle affirme notamment que :
- Les non-vaccinés représentent près de 85 % des entrées hospitalières, que ce soit en hospitalisation conventionnelle ou en soins critiques.
- Les patients complètement vaccinés comptent pour environ 7 % des admissions, une proportion cinq fois plus faible que celle observée en population générale (35 % en moyenne durant la période d’étude).
– À tout âge, la part de patients vaccinés entrant à l’hôpital est nettement inférieure à celle qu’ils représentent dans l’ensemble de la population.Seulement, comme l’a relevé @NiusMarco sur Twitter et détaillé Patrice Gibertie dans un article, les données utilisées pas la DREES posent un énorme problème : il manque la moitié des décès Covid-19 français.
Dans cette vidéo, nous allons détailler les données de l’étude pour comprendre d’où viennent les données, comment la DREES a pu retirer la moitié des décès de son analyse et ce que cela signifie pour les conclusions de l’étude.
Sources :
• Étude DREES sur les tests :
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/note_drees_suivi_de_la_crise_sanitaire_.pdf
• Étude DREES sur les hospitalisations / décès :
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2021–07–23_-_sivic-sidep-vacsi_premiers_resultats_-_drees‑2.pdf
• Géodes pour les données SIVIC :
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&view=map2
• Fichier public des personnes décédées :
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/fichier–des–personnes–decedees/
• Étude anglaise sur la mortalité Covid vaccinés / non vaccinés :
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1001354/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_17.pdf
• Données israéliennes sur la mortalité Covid :
https://data.gov.il/dataset/covid–19/resource/8a51c65b–f95a–4fb8–bd97–65f47109f41f?filters
De mon point de vue, Pierre Chaillot (Décoder l’éco) est un service public à lui tout seul 🙂
• Voyez sa page sur AgoraVox (avec presque tous ses articles de fond) :
https://www.agoravox.fr/auteur/azyx1986
• son compte Tweeter : https://twitter.com/decoder_l
• et sa page sur Odysee : https://odysee.com/@decoderleco:c
[Abus de pouvoir] Et nous devrions faire confiance à la « science » de l’industrie pharmaceutique ? par William Engdahl (Le Saker francophone)
Chers amis,
Les articles étrangers que ces jeunes gens nous traduisent et nous signalent, comme ici les analyses de William Engdhal, sont presque toujours passionnants et importants.
https://violationtracker.goodjobsfirst.org/industry/pharmaceuticals
Et nous devrions faire confiance à la « science » de l’industrie pharmaceutique ?
Par William Engdahl − Le 29 juillet 2021 – Source New Eastern Ooutlook
Source : Le Saker francophone, https://lesakerfrancophone.fr/et–nous–devrions–faire–confiance–a–la–science–de–lindustrie–pharmaceutique
 L’indéboulonnable chef du NIAID, Tony Fauci, a demandé à plusieurs reprises au public de « faire confiance à la science », alors qu’il passe lui-même d’une opinion scientifique à une autre. Ce qui n’est jamais mentionné dans les grands médias occidentaux et presque partout dans le monde, c’est le bilan scientifique des principaux géants pharmaceutiques mondiaux fabricants de vaccins. En bref, il est abyssal et alarmant à l’extrême. Ce seul fait devrait empêcher les gouvernements d’imposer à leurs populations des injections expérimentales radicales et non testées, sans avoir procédé à des tests approfondis à long terme pour garantir leur sécurité.
L’indéboulonnable chef du NIAID, Tony Fauci, a demandé à plusieurs reprises au public de « faire confiance à la science », alors qu’il passe lui-même d’une opinion scientifique à une autre. Ce qui n’est jamais mentionné dans les grands médias occidentaux et presque partout dans le monde, c’est le bilan scientifique des principaux géants pharmaceutiques mondiaux fabricants de vaccins. En bref, il est abyssal et alarmant à l’extrême. Ce seul fait devrait empêcher les gouvernements d’imposer à leurs populations des injections expérimentales radicales et non testées, sans avoir procédé à des tests approfondis à long terme pour garantir leur sécurité.
En avril dernier, alors que le programme de vaccination américain battait son plein, le conseiller en chef de Biden pour la Covid-19, M. Fauci, 80 ans, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) depuis 1984, annonçait que les Centres américains de contrôle des maladies (CDC) et la Food and Drug Administration (FDA) avaient décidé d’ordonner une « pause » dans l’administration du vaccin Johnson & Johnson (Janssen) afin d’examiner les rapports faisant état de caillots sanguins. Il s’est avéré que six cas de caillots sanguins ont été signalés sur quelque sept millions de personnes ayant reçu le vaccin J&J. Dans ses remarques à la presse, Fauci a déclaré : « L’une des choses qui est, je pense, si bonne dans notre système ici, c’est que nous sommes régis par la science, et non par toute autre considération. » Il y a de bonnes raisons de mettre en doute sa remarque.
Cette déclaration était censée rassurer les gens sur le fait que les autorités faisaient preuve d’une extrême prudence avec les médicaments expérimentaux contre la Covid-19 qui, après tout, n’ont jamais été testés en masse sur des humains auparavant et n’ont obtenu qu’une « autorisation d’utilisation d’urgence », une approbation provisoire de la FDA. La FDA a rapidement levé la pause lorsque J&J a accepté d’imprimer sur ses paquets que son vaccin pouvait provoquer des caillots sanguins.
Pourtant, dans le même temps, les fabricants de vaccins rivaux, Pfizer et Moderna, qui utilisent tous deux un traitement génétique hyper-expérimental connu sous le nom d’ARNm, n’ont pas été freinés par « la science » malgré le fait que des centaines de milliers de réactions graves alarmantes liées aux vaccins, y compris des données officielles faisant état de plusieurs milliers de décès dus aux deux, ont été enregistrées par la base de données VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) du CDC.
Selon le CDC, ces événements « indésirables », post-vaccinaux, comprennent l’anaphylaxie, la thrombose avec syndrome de thrombocytopénie, le syndrome de Guillain-Barré, la myocardite, la péricardite et la mort. Pour la semaine du 16 juillet, le VAERS des CDC a fait état d’un nombre alarmant de 9 125 décès signalés depuis la fin décembre suite à la vaccination pour la Covid-19. Jamais dans l’histoire un nombre aussi élevé de décès n’a été associé à un vaccin, et pourtant les médias gardent un silence assourdissant à ce sujet.
Leur bilan scientifique lamentable
La formulation de Fauci est précise et délibérément manipulatrice. Elle suggère qu’il existe une chose fixe que nous pouvons appeler « la science », comme un dogme religieux du Vatican, alors que la véritable méthode scientifique est celle du questionnement continu, du renversement des hypothèses passées par de nouvelles hypothèses prouvées, de l’ajustement permanent. Pourtant, lorsqu’il s’agit de « science », la poignée de grosse compagnies fabricants de vaccins, parfois connus sous le nom de Big Pharma, un cartel qui n’est pas sans rappeler Big Oil, ont un palmarès de fraude, de falsification délibérée de leurs propres tests, ainsi que de corruption généralisée de médecins et de responsables médicaux pour promouvoir leurs différents médicaments malgré les résultats de la « science » qui contredisent leurs affirmations de sécurité. Un regard sur les principaux géants pharmaceutiques mondiaux est instructif.
J&J
Nous commençons par la société Johnson & Johnson du New Jersey. Le 21 juillet 2021, J&J et trois autres petits fabricants de médicaments ont accepté de payer 26 milliards de dollars de dommages et intérêts à un groupe d’États américains pour leur rôle dans l’épidémie d’opioïdes en Amérique. Sur ce montant, J&J paiera 5 milliards de dollars. Le CDC estime que l’utilisation d’opioïdes hautement addictifs comme analgésiques a causé au moins 500 000 décès entre 1999 et 2019. Johnson & Johnson est accusé d’avoir poussé à l’utilisation excessive d’antidouleurs mortels et d’avoir minimisé les risques de dépendance. Ils étaient pourtant bien placés pour le connaitre.
Le même J&J est dans une énorme bataille juridique pour avoir sciemment utilisé un cancérogène dans sa célèbre poudre pour bébé. Une enquête de Reuters datant de 2018 a révélé que J&J savait depuis des décennies que l’amiante, un cancérigène connu, se cachait dans sa poudre pour bébé et d’autres produits cosmétiques à base de talc. L’entreprise envisagerait de scinder légalement sa division de poudre pour bébé en une petite société distincte qui se déclarerait ensuite en faillite pour éviter de gros versements. Le vaccin contre la Covid-19 de J&J, contrairement à celui de Pfizer et Moderna, n’utilise pas de modification génétique de l’ARNm.
Les deux fabricants mondiaux de vaccins contre la Covid-19, qui détiennent de loin le plus grand marché à ce jour, sont ceux dont Fauci fait personnellement la promotion. Il s’agit de Pfizer, en alliance avec la minuscule société allemande BioNTech sous le nom de Comirnaty, et de la société américaine de biotechnologie Moderna.
Pfizer
Pfizer, l’un des plus grands fabricants de vaccins au monde en termes de ventes, a été fondé en 1849 aux États-Unis. Cette société possède également l’un des casiers judiciaires les plus chargés en matière de fraude, de corruption, de falsification et de dommages avérés. Selon une étude canadienne datant de 2010, « Pfizer a été un « délinquant chronique », s’engageant de manière persistante dans des pratiques commerciales illégales et corrompues, soudoyant des médecins et supprimant des résultats d’essais défavorables. » C’est grave. Il convient de noter que Pfizer n’a pas encore rendu publics les détails de ses études sur le vaccin contre la Covid-19 pour un examen externe.
La liste des crimes commis par Pfizer s’est allongée depuis 2010. L’entreprise fait actuellement l’objet de poursuites judiciaires liées à des accusations selon lesquelles son médicament contre les brûlures d’estomac, le Zantac, est contaminé par une substance cancérigène. En 2009, Pfizer a reçu la plus grosse amende de l’histoire des États-Unis dans le domaine des médicaments, dans le cadre d’un accord de plaidoyer portant sur 2,3 milliards de dollars, pour avoir fait la promotion mensongère des médicaments Bextra et Celebrex et versé des pots-de-vin à des médecins complaisants. Pfizer a plaidé coupable d’avoir commercialisé quatre médicaments, dont le Bextra, « avec l’intention de frauder ou d’induire en erreur ». L’entreprise a été contrainte de retirer son antidouleur contre l’arthrite, le Bextra, aux États-Unis et dans l’Union européenne, car il provoquait des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et de graves maladies de la peau.
Dans le but évident d’augmenter ses revenus, Pfizer a illégalement versé des pots-de-vin à des médecins pour une utilisation « non indiquée sur l’étiquette » de plusieurs de ses médicaments, ce qui a entraîné des blessures ou la mort de patients. Parmi ceux-ci figuraient le Bextra (valdécoxib), le Geodon (ziprasidone HCl), un antipsychotique atypique, le Zyvox (linézolide), un antibiotique, le Lyrica (prégabaline), un médicament contre les crises d’épilepsie, son célèbre Viagra (sildénafil), un médicament contre les troubles de l’érection, et le Lipitor (atorvastatine), un médicament contre le cholestérol.
Dans un autre procès, les filiales de Pfizer ont été contraintes de payer 142 millions de dollars et de divulguer des documents de l’entreprise qui montraient qu’elle commercialisait illégalement la gabapentine pour des utilisations non indiquées sur l’étiquette. « Les données révélées dans une série de procès américains indiquent que le médicament était promu par la société pharmaceutique comme traitement de la douleur, des migraines et des troubles bipolaires – alors qu’il n’était pas efficace pour traiter ces affections et qu’il était en fait toxique dans certains cas, selon la Therapeutics Initiative, un groupe indépendant de recherche sur les médicaments de l’Université de Colombie-Britannique. Les essais ont forcé l’entreprise à publier toutes ses études sur le médicament, y compris celles qu’elle gardait cachées. »
En 2004, Warner-Lambert, filiale de Pfizer, a été contrainte de payer 430 millions de dollars pour régler les accusations criminelles et la responsabilité civile découlant de ses pratiques commerciales frauduleuses concernant le Neurontin, sa marque pour le médicament gabapentin. Développé à l’origine pour le traitement de l’épilepsie, Neurontin a fait l’objet d’une promotion illégale pour le traitement de la douleur neurologique, et en particulier pour la migraine et le trouble bipolaire, alors qu’il n’était pas efficace pour traiter ces affections et qu’il était même toxique dans certains cas. Le Neurontin pour des utilisations non approuvées a représenté environ 90 % des 2,7 milliards de dollars de ventes en 2003.
Un rapport du New York Times a révélé en 2010 que Pfizer « …a versé environ 20 millions de dollars à 4 500 médecins et autres professionnels de la santé aux États-Unis pour des consultations et pour parler en son nom au cours des six derniers mois de 2009 ». Elle a versé 15,3 millions de dollars supplémentaires à 250 centres médicaux universitaires et autres groupes de recherche pour des essais cliniques. Dans la pratique juridique américaine, il est rare que les dirigeants d’entreprise qui commettent des actes criminels soient poursuivis. Il en résulte que les amendes judiciaires sont traitées comme des « coûts commerciaux » dans ce milieu cynique. En huit ans de malversations répétées jusqu’en 2009, Pfizer a accumulé un peu moins de 3 milliards de dollars d’amendes et de sanctions civiles, soit environ un tiers de ses revenus nets annuels.
En 2020, alors que son vaccin contre la Covid-19 était en cours de développement, Pfizer a payé 13 150 000 dollars en lobbying auprès du Congrès et de fonctionnaires à Washington, entre autres. Il faut également noter que la Fondation Bill et Melinda Gates possède des actions à la fois de Pfizer et de leur partenaire dans le principal vaccin à ARNm, l’allemand BioNTech.
Moderna
Le troisième producteur de vaccins contre la Covid-19 ayant reçu une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) de la FDA est Moderna, de Cambridge, Massachusetts. Contrairement à J&J ou Pfizer, il n’a pas encore été poursuivi pour pratiques illégales. Peut être parce qu’avant son EUA pour son vaccin expérimental à ARNm il n’avait, en dix ans d’existence depuis 2010, pas réussi à obtenir l’approbation de la FDA pour commercialiser un seul médicament, malgré des tentatives répétées et infructueuses. Cependant, Moderna a un panneau au néon rouge qui indique « conflit d’intérêts » qui devrait donner à réfléchir.
Moderna et le NIAID de Fauci ont collaboré au développement de vaccins en utilisant la plateforme ARNm de Moderna et le NIAID de Fauci sur les coronavirus, dont le MERS, depuis au moins novembre 2015. Le 13 janvier 2020, avant même que le premier cas d’un supposé « nouveau coronavirus » de Wuhan, en Chine, ne soit détecté aux États-Unis, le NIAID de Fauci et Moderna signaient un accord de coopération actualisé qui les décrivait comme copropriétaires d’un coronavirus basé sur l’ARNm et qu’ils avaient finalisé une séquence pour l’ARNm-1273, le vaccin qui est maintenant administré à des millions de personnes pour soi-disant éviter le nouveau coronavirus. Cela signifie que le NIAID de Fauci, et peut-être Fauci personnellement (c’est autorisé aux États-Unis), allait tirer d’énormes avantages financiers de l’approbation d’urgence du vaccin Moderna, mais Fauci n’a jamais admis publiquement ce conflit lorsqu’il était conseiller de Trump, ni lorsqu’il était conseiller de Biden.
Dix jours plus tard, le 23 janvier 2020, Moderna annonçait qu’elle avait obtenu un financement du CEPI, un fonds pour les vaccins créé par la fondation de Bill Gates et le WEF de Davos, entre autres, pour développer un vaccin à ARNm contre le virus de Wuhan.
Moderna a été créé par un investisseur en capital-risque, Noubar Afeyan, ainsi que par Timothy A. Springer, professeur à Harvard, et d’autres personnes. En 2011, Afeyan a recruté Stéphane Bancel, homme d’affaires français et ancien cadre d’Eli Lilly, comme PDG. Bien qu’il n’ait aucun diplôme en médecine ou en sciences, ni aucune expérience dans la gestion d’une opération de développement de médicaments, Bancel se présente comme cotitulaire d’une centaine de brevets de Moderna liés aux différents vaccins. À partir de 2013, la petite Moderna a reçu des subventions du Pentagone pour développer sa technologie ARNm. En 2020, juste avant de recevoir l’autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA, 89 % des revenus de Moderna provenaient de subventions du gouvernement américain. Cette entreprise est loin d’être expérimentée, mais elle tient le destin de millions de personnes entre ses mains. Comme le dit Fauci, « faites confiance à la science ».
En février 2016, un éditorial de la revue Nature reprochait à Moderna de ne pas publier d’articles évalués par des pairs sur sa technologie, contrairement à la plupart des autres sociétés de biotechnologie émergentes ou établies. L’entreprise reste ultra-secrète. La même année, en 2016, Moderna a obtenu 20 millions de dollars de la Fondation Gates pour le développement de vaccins utilisant l’ARNm.
Jusqu’à ce qu’elle reçoive l’approbation de l’EUA pour son produit « covid » à base d’ARNm en décembre 2020, Moderna n’avait cumulé que des pertes, depuis sa fondation. Puis, curieusement, à la suite d’une réunion personnelle en mars 2020 avec le président de l’époque, Trump, où Bancel a dit au président que Moderna pourrait avoir un vaccin prêt en quelques mois, l’opportunité pour Moderna est à portée de main.
Le 15 mai, Trump annonçait la création de l’opération « Warp Seed » pour mettre en place un vaccin contre la Covid-19 d’ici décembre. Le chef du groupe présidentiel était un vétéran de 30 ans de R&D de la grande firme pharmaceutique britannique GSK, Moncef Slaoui. En 2017, Slaoui avait démissionné de GSK et rejoint le conseil d’administration de nul autre que Moderna. Sous le Warp Speed de Slaoui, quelque 22 milliards de dollars de l’argent des contribuables américains ont été donnés à différents fabricants de vaccins. Moderna en fut l’un des principaux bénéficiaires, un conflit d’intérêt flagrant, mais personne ne semblait s’en soucier. Slaoui a acheminé quelque 2 milliards de dollars de fonds publics vers son ancienne société, Moderna, pour développer le vaccin à ARNm contre la Covid-19. Ce n’est que sous la critique publique que Slaoui a vendu ses actions dans Moderna, faisant des millions de bénéfices grâce au rôle de Moderna en tant que candidat principal pour le vaccin contre la Covid-19. Peu de temps après sa démission à la fin de la présidence Trump, Slaoui a été licencié par son ancienne entreprise GSK suite à des accusations de harcèlement sexuel envers une employée d’une filiale de l’entreprise.
En février 2020, le secrétaire d’État à la santé et aux services sociaux de Trump, Alex Azar, a invoqué la loi sur la préparation et l’état de préparation aux situations d’urgence (PREP) pour exempter Moderna, Pfizer, J&J et tout futur fabricant anti-covid de toute responsabilité découlant des dommages ou des décès causés par leurs vaccins contre le coronavirus de Wuhan. La protection juridique dure jusqu’en 2024. Si les vaccins sont si bons et sûrs, pourquoi une telle mesure est-elle nécessaire ? M. Azar était auparavant à la tête du géant américain de la pharmacie Eli Lilly. Il y a de sérieuses questions qui doivent être soulevées ouvertement concernant les fabricants de vaccins qui poussent pour que des formulations expérimentales génétiquement modifiées très controversées soient expérimentés sur la population.
William Engdahl
Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone
Note du Saker Francophone. C’est typique de l’ultralibéralisme. Les grosses entreprises peuvent tout se permettre sans subir de conséquences à la hauteur de la gravité de leurs actes. Un individu tue ou blesse gravement quelqu’un, même involontairement, et il passe par la case prison. Une Société Anonyme le fait et s’en tire avec une amende qui la touche à peine. Pourquoi ne pas envoyer le directeur en prison ou même la dissoudre pour de tels agissements ? Mais non c’est la politique du laisser-faire, sans limites. Si bien que les méthodes pour augmenter leurs profits vont continuer à défier de plus en plus les règles, jusqu’à destruction du tissu social si l’État n’intervient pas pour y mettre le holà. Et vu l’état dans lequel est l’État on peut en douter.
Sputnik France publie aujourd’hui un article rappelant que « Interrogé lors de son procès pour fraude fiscale au sujet des versements du laboratoire sur un compte ouvert en Suisse en 1992, M.Cahuzac [un ministre de Francois Hollande], reconnaît alors qu’en 1993 « deux versements des laboratoires Pfizer » ont été faits au profit du financement politique. »
[abus de pouvoir] [injection expérimentale obligatoire chez nos enfants] Témoignage d’une médecin pédiatre texane, Angelina Farella, devant le Sénat
Bonjour à tous,
Notre immersion totale dans les pires abus de pouvoir bat son plein.
Je soumets cette vidéo (j’en ai 30 autres, plus bouleversantes les unes que les autres, je ne sais pas par où commencer) à notre cerveau collectif : est-ce que ce que dit cette dame vous semble vrai ? Est-ce qu’on a des sources irréfutables pour chaque accusation ? Ou bien est-ce une extravagance ?
Merci pour votre aide.
Pourquoi converger sur le RIC constituant avec le Mouvement Constituant Populaire (MCP) ?
Pourquoi le RIC constituant doit devenir le « cheval de bataille » d’une convergence populaire vers la DÉMOCRATIE ? Chacun d’entre nous peut participer à cette finalité en rejoignant le Mouvement Constituant Populaire : https://mouvement-constituant-populaire.fr
Le socle commun du Mouvement Constituant Populaire
Le Mouvement Constituant Populaire veut contribuer à la convergence des mouvements populaires contre l’oligarchie qui nous gouverne, en plaçant au centre de toutes les luttes la seule revendication qui puisse faire l’unité : l’avènement d’une démocratie réelle. Car nous ne sommes pas en démocratie, malgré les mensonges répétés des voleurs de pouvoir. Le mot démocratie, trop longtemps dévoyé, doit reprendre son sens : un système politique maîtrisé par le peuple, grâce à un processus constituant populaire permanent.
Il ne s’agit en aucun cas que tout le monde décide de tout et tout le temps. Il s’agit que le peuple fixe lui-même les règles de sa représentation, puisse les changer quand elles ne conviennent plus et garde toujours le dernier mot. C’est la définition de peuple souverain.
Pour faire l’union des démocrates réels, le Mouvement Constituant Populaire concentre son action sur la massification de l’éducation populaire, à travers des actions coordonnées à l’échelle nationale.
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10159386085162317
Tweet correspondant à ce billet :
Pourquoi converger sur le RIC constituant avec le Mouvement Constituant Populaire (MCP) ?https://t.co/xDPn0WuuWG
— Étienne Chouard (@Etienne_Chouard) July 30, 2021
La Gazette des Amis du RIC de juillet
Chaque mois, les principales actualités et actions des personnes œuvrant pour l’instauration du RIC et d’une démocratie digne de ce nom.
Sommaire
Les invitations à l’action
• Communiquons l’intérêt du RIC aux associations solidaires, sociales ou environnementales
• Mutualisons les compétences informatiques des collectifs pour la démocratie
Les actualités
• Vidéo retour d’expérience sur les votations citoyennes MCP de juin
• Débat sur le casier judiciaire vierge et le vote blanc
• Débat sur le RIC constituant entre un ancien député et Raul Magni-Berton
• Réponse d’un citoyen suisse aux 13 arguments les plus fréquents contre le RIC
• La Concorde Citoyenne avec Fabrice Grimal : un nouveau candidat portant le RIC
• Débat sur l’UE : la France a‑t‑elle la souveraineté sur sa Constitution ?
• Fonctionnement de RIC : témoignage de Natasha Bernal
• France-Soir : Prendre le pouvoir pour le peuple, mode d’emploi avec Etienne Chouard
• France Soir : « Il faut que les Français aient un nouveau droit politique »
• Les résultats intermédiaires de la consultation sur les principes du RIC
Agenda
Les productions artistiques
Recrutements
Tweet correspondant à ce billet :
https://twitter.com/Etienne_Chouard/status/1420822337172262914
Publication Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10159385089637317
UE : vidéos de la fête de la Démocratie à Paris pour l’anniversaire du Référendum de 2005 le 29 mai 2021
Mon intervention à la fête de la démocratie
Sélection :
- Pourquoi ne sommes nous pas en en démocratie ?
- La trahison de représentants politiques suite à la victoire populaire du « NON » au Traité Constitutionnel européen en 2005
- Notre impuissance politique est écrite dans la Constitution de la Ve République
- Comment instaurer une démocratie réelle dans notre pays ?
- La condition nécessaire à la lutte pour la démocratie : faire converger les citoyens et citoyennes autour de cette cause commune
- Rejoindre le MCP
En savoir plus sur le Mouvement Constituant Populaire
Voir aussi les autres interventions :
Avec Emmanuelle GAVE, Guillaume BIGOT, Philippe PASCOT, Pierre-Yves ROUGEYRON, Jean-Claude HOURCADE, Joël PÉRICHAUD, Jacques CHEMINADE, Charles GAVE, Fabrice GRIMAL, Roland HUREAUX, Gilles CASANOVA, Dominique BOURSE-PROVENCE, Jacques NIKONOFF, Pierre LÉVY, Philippe MURER, Éric GUÉGUEN, Laurent HERBLAY, David SAFORCADA, Dominique JAMET, Charles-Henri GALLOIS, Deivy MUGERIN, …
À propos de « UE : le référendum »
📝 Signez et faites signer la pétition referendum-ue.org
Les soutiens de la pétition referendum-ue.org lancent un grand appel pour un nouveau référendum sur notre appartenance à l’Union européenne.
Retrouvez leurs discours donnés lors de la Fête de la démocratie qui a eu lieu le 29 mai dernier à Paris
sur leur chaine Youtube
À voir également avec Clara Egger et Charles-Henri Gallois
Débat sur l’EU : la France a‑t‑elle la souveraineté sur sa Constitution ?
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10159385056932317
Tweet correspondant à ce billet :
UE : vidéos de la fête de la Démocratie à Paris pour l’anniversaire du Référendum de 2005 le 29 mai 2021https://t.co/WqHIbGqAFD
— Étienne Chouard (@Etienne_Chouard) July 29, 2021
Comment participer à un atelier constituant facilement dès demain ?
Il n’est pas facile pour tout le monde de trouver l’occasion et la disponibilité de participer à un atelier constituant.
Pour cette raison, je vous invite à découvrir les ateliers numériques de MUMBLE CONSTITUANT : « Les ateliers de Mumble Constituant sont des réunions en ligne (tous les mardis à 20h30 sur Discord) où nous nous exerçons à l’écriture d’une Constitution complète. »
Ces ateliers ont l’avantage d’être accessibles facilement à tous, à l’aide de son smartphone, de sa tablette, ou de son ordinateur.
Rejoindre les ateliers les mardis à 20h30
Découvrir la Constitution issue des ateliers
Comment participer à un atelier ?
Les ateliers sont répartis en 3 phases : la réflexion, la rédaction et la votation
La parole est distribuée par un facilitateur désigné en début d’atelier.
À ce jour, près de 300 citoyens ont participé à cette aventure de rédaction en intelligence collective. Ce n’est pas une suite d’ateliers constituants, mais un processus constituant complet. Le travail a débuté en 2016, il est donc nécessaire de préparer un peu sa participation aux ateliers…
Conseils pour participer aux ateliers :
- Créer un compte pour accéder au logiciel d’audioconférence Discord.
Si c’est votre première connexion, venir en avance pour les réglages audio.
- Prendre connaissance des différentes productions issues des ateliers :
Constitution,
schémas,
lexique
et Travaux en cours
- Prendre connaissance des méthodes de délibération utilisées
Vous pouvez également regarder de plus près la Constitution en vigueur.
Pour rappel : Pourquoi réécrire nous-mêmes la constitution ?
Comment réécrire la constitution ?
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10159350114417317
Tweet correspondant à ce billet :
Comment participer à un atelier constituant facilement dès demain ?https://t.co/OEmeSyjFYB
Je vous invite à découvrir les ateliers sur le MUMBLE CONSTITUANT, réunions en ligne tous les mardis à 20h30 sur Discord, où nous nous exerçons à l’écriture d’une Constitution complète.
— Étienne Chouard (@Etienne_Chouard) July 12, 2021
Telegram correspondant à ce billet :
https://t.me/chouard/9
Rendez-vous le 16 juillet à 21 h, pour un échange avec Jacques Cheminade sur les enjeux démocratiques
Pour suivre et participer, rendez-vous sur : https://discord.gg/zFn82Hmh9D
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10159348998662317
Tweet correspondant à ce billet :
Rendez-vous le 16 juillet à 21 h, avec Jacques Cheminade. https://t.co/Dbk2aac2BG
— Étienne Chouard (@Etienne_Chouard) July 11, 2021
Telegram correspondant à ce billet :
https://t.me/chouard/7