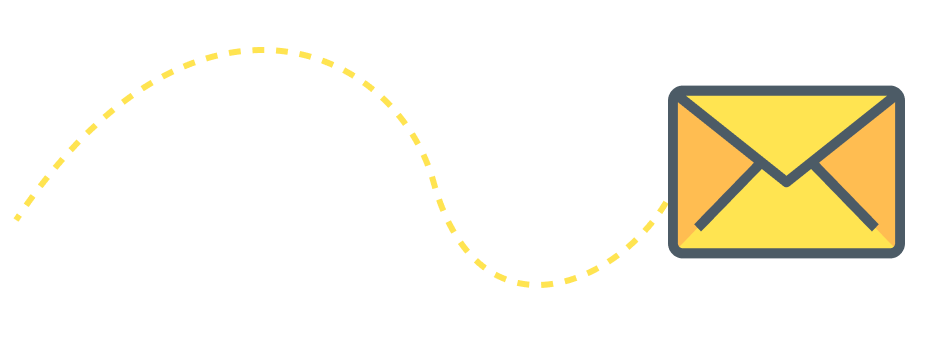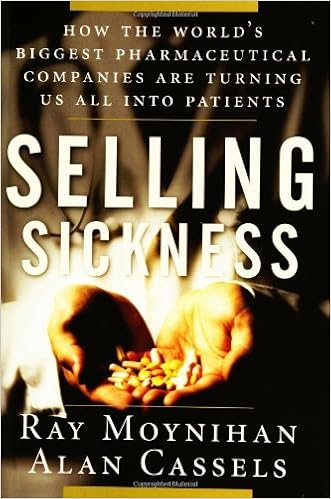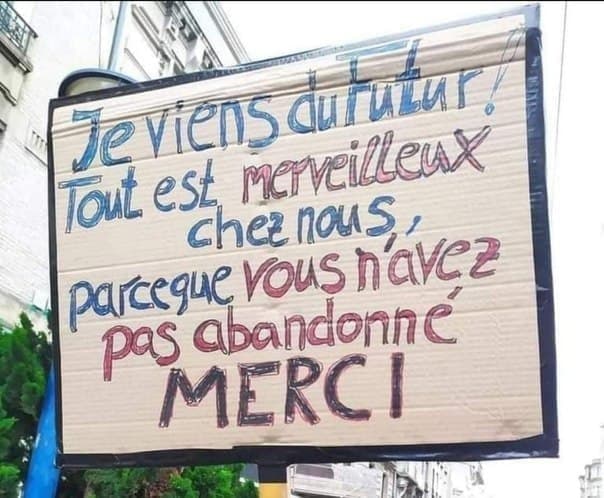Articles du blog
Les derniers articles du blog
Atelier constituant Lexical (ACL) sur MÉDIAS ET JOURNALISME, avec Amélie Ismaïli, lundi 27 octobre 2025, 19 h avec Démocraties Directes et l’AMDF
Chers amis, [report de date d’une semaine pour cause de grande panne mondiale…] Je vous donne rendez-vous ce soir lundi prochain, 27 octobre 2025, à 19 h, pour un atelier constituant lexical dédié aux mots JOURNALISME, JOURNALISTES et MÉDIAS. Je vais y réfléchir avec Amélie Ismaïli qui est, pour moi, précisément, une des journalistes dignes de ce nom dans mon pays, une sentinelle du peuple, une citoyenne vigilante et courageuse enquêtant sur les intrigues des puissants du moment. Ça devrait…
Atelier constituant en direct avec Etienne Chouard #5 : procès du tirage au sort 2ème partie, sur Nexus, 22 oct 2025 à 17 h
Avec Marc et Léo, et avec vous, mercredi 22 oct 2025 à 17h, on va continuer le procès citoyen du tirage au sort 🙂 Vous retrouverez de nombreux liens pour suivre notre travail et pour creuser le sujet sur la première page de ce procès. Je vais cette fois, en plus de la Liste simple liste des objections, ajouter (ci-dessous) quelques références supplémentaires très importantes cette semaine, avec deux attaques historiques (l’une de Raoul Marc Jennar et l’autre de François Asselineau), très…
Nous sommes Constituants – Zenkia (Clip Officiel)
Je pense que vous imaginez facilement comme cette œuvre est émouvante pour moi. Merci Zenkiai, du fond du coeur. Étienne. comptesurmoi.org https://youtu.be/gnxUr7neT7k?si=RzMeM0FY_vGwAWg0
Tous les articles du blog
Format grille – Format articles complets
Le #9 de la Gazette des Amis du RIC est paru 🙂
Le sommaire
Invitations à l’action
• Participer aux votations du MCP
• Soutenir la Proposition de RIC à l’Assemblée Nationale
• RAPPEL : partager l’appel 2022 pour le RIC constituant
• Diffuser un livre pour instaurer le RIC constituant en 2022
• Envoyons nos meilleurs voeux de démocratie aux maires
• Participer à la récolte des 500 parrainages pour le RIC
Vidéos
• Éric Zemmour : référendum présidentiel versus RIC
• Les universités populaires #01- Démocratie, élection et RIC
• Fabrice Grimal de LCC2022 dédie une vidéo au RIC
• LIVE sur la stratégie électorale pour le RIC en 2022
• Proposition de fonctionnement de RIC du père Chouard – Audition d’Objectif RIC
• Auditions démocratiques des candidats à la présidentielle 2022
Infos utiles + Agenda
• Comparateur des RIC des candidats 2022
• Analyse du RIC de Fabrice Grimal (LCC2022)
• Analyse du RIC de Florian Philippot (Les Patriotes)
Présentation du sommaire en vidéo
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10159688334812317
Tweet correspondant à ce billet :
https://twitter.com/Etienne_Chouard/status/1480303594666708995
Telegram correspondant à ce billet :
https://t.me/chouard/442
La théorie du complot de l’année dernière vient d’être adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale. En douce, de nuit et pendant les fêtes, comme toutes les lois scélérates. Et les anticomplotistes veillent, en dénonçant les « complotistes » ce qui protège les comploteurs.
La théorie du complot de l’année dernière vient d’être adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale.
En douce, de nuit et pendant les fêtes, comme toutes les lois scélérates.
Et les anticomplotistes veillent, en dénonçant les « complotistes » et protégeant les comploteurs.— Étienne Chouard (@Etienne_Chouard) January 7, 2022
Véran Le Fourbe (déc. 2021) : « Le pass vaccinal est une forme déguisée de l’obligation vaccinale,
mais c’est plus efficace qu’une obligation vaccinale : empêcher des gens d’aller dans des bars, des restaurants, dans des lieux qui reçoivent du public, s’ils ne sont pas « vaccinés », c’est plus efficace que de leur mettre une amende de 100 € quand on les attrape dans la rue. »
Ce que nous impose ce faux « représentant » est un abus de pouvoir. Écoutez cet AVEU.
Je vous invite tous à lire, imprimer ET AFFICHER PARTOUT les art. 312 et suivants du code pénal, qui incriminent L’EXTORSION de consentement :https://t.co/A95xljDjl7#NousNavonsPasDeConstitution pic.twitter.com/y8Mk4zcVVm
— Étienne Chouard (@Etienne_Chouard) December 22, 2021
Je vous invite tous à lire, imprimer ET AFFICHER PARTOUT les art. 312 et suivants du code pénal, qui incriminent L’EXTORSION de consentement :
#NousNavonsPasDeConstitution
La technique de domination du GOUVERNEMENT est la même que celle de la MAFIA : le mafieux terrorise ses victimes, puis il se présente lui-même comme le protecteur, en échange de leur docilité.
L’obligation vaccinale, c’est de l’EXTORSION (art 312 et suivants du code pénal)
Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux.
https://twitter.com/Etienne_Chouard/status/1473589896891842561?s=20
[Fausse pharmacovigilance, corruption des autorités, abus de pouvoir] L’impuissance de la régulation des médicaments, par Peter Gøtzsche
Chers amis,
Chaque jour, je poursuis (entre autres) la lecture du livre bouleversant de Peter Gøtzsche dont je vous ai parlé à la mi-septembre 2021 : « REMÈDES MORTELS ET CRIME ORGANISÉ : comment l’industrie pharmaceutique a corrompu les services de santé » (2015, 2019).
Il me semble que tout le monde devrait avoir lu ce livre, le crayon à la main. C’est un service public à lui tout seul, qui dénonce précisément, avec des centaines de preuves, la profonde corruption des services publics de la santé par l’industrie chimique médicamenteuse.
Toutes les lois scélérates (liberticides et arbitraires) imposées pendant les deux ans passés avec la COVID-19 s’appuient, se fondent, ne reposent que sur, l’autorité scientifique (et morale) d’INSTITUTIONS qui sont, en fait, toutes profondément corrompues et dévoyées par l’industrie (qui arrose d’argent et d’honneurs les décideurs et conseillers, et qui menace les opposants) : l’OMS, la FDA, le CDC, le GAVI, les revues scientifiques, les sociétés savantes, les experts appointés, la Haute Autorité de Santé, l’ANSM et les ARS en France, le « Conseil scientifique » et le « Comité consultatif national d’éthique » (présidés par la même fripouille)…
Dans le livre de Peter Gøtzsche, c’est le chapitre 10 qui traite de la corruption des autorités chargées du contrôle des médicaments. Je reproduis ici intégralement ce chapitre essentiel, mais en vous invitant avec insistance à acheter (et à offrir) ce livre, d’une part pour le lire en entier car chaque paragraphe compte, et d’autre part pour aider l’auteur dans son combat héroïque contre la corruption systémique. Il ne suffit pas, je pense, de lire ce texte à l’écran : il faut avoir le livre à la maison, et le laisser traîner sur une table au salon, aux toilettes, dans une chambre, partout où il peut s’offrir aux regards de ceux qui ne connaissent pas la gravité de la situation. Ce livre est un outil d’activiste. Donc il faut l’acheter, pour s’en servir. Tout est bon dans ce livre, important, révoltant, du début à la fin.
Ce chapitre 10 est accompagné de 120 notes de références pour soutenir ses dires. Je suis en train d’étudier une à une ces références, et d’y ajouter les liens cliquables pour vous aider à les consulter vous-mêmes aisément. Aujourd’hui, vous trouverez seulement les 27 premières notes ainsi traitées, mais je continue mon travail et j’actualiserai ce billet au fur et à mesure jusqu’à avoir rendu cliquables les 120 références. Je reproduirai aussi (dans la partie « commentaires » du billet) le texte intégral des références les plus importantes signalées par Peter.
Tout ça est bouleversant.
Bonne lecture.
Étienne.
Edit (4/1//2022) : j’en suis à la note 44…
Chapitre 10 : L’impuissance de la régulation des médicaments
(Extrait de « REMÈDES MORTELS ET CRIME ORGANISÉ : comment l’industrie pharmaceutique a corrompu les services de santé » (2015, 2019), de Peter Gøtzsche.)
Si les Américains connaissaient quelques-unes des affaires traitées à la FDA, ils ne prendraient jamais autre chose qu’une aspirine Bayer.
Len Lutwalk, scientifique de la FDA1
Nous n’avons pas de médicaments sécuritaires. L’industrie pharmaceutique se contrôle plus ou moins toute seule ; nos politiciens ont affaibli les exigences réglementaires au cours des ans puisqu’ils sont plus préoccupés par le fric que par la sécurité des patients ; il y a des conflits d’intérêts dans les agences du médicament ; le système est fondé sur la confiance bien qu’on sache que l’industrie ment ; et quand des problèmes surviennent, les agences du médicament recourront à des pseudo-solutions qu’elles savent inaptes à résoudre le problème.
J’ai le plus grand respect pour le travail des scientifiques consciencieux dans les agences du médicament. Ils ont empêché l’autorisation de plusieurs médicaments inutiles ou nuisibles et ont retiré bien des médicaments du marché. Toutefois, ils travaillent dans un système fondamentalement défectueux dans lequel, le bénéfice du doute est toujours accordé à la protection des intérêts des compagnies et non pas à la protection de ceux des patients.
Cela devient manifeste quand on compare les médicaments aux voitures. Ma voiture de 15 ans doit être inspectée deux fois par an. Si je me présentais la prochaine fois sans ma voiture mais avec 10 mètres de documents et que je disais aux inspecteurs qu’ils n’ont pas à examiner ma voiture mais l’énorme pile de documents dans lesquels sont colligés les résultats des tests que j’ai soigneusement administrés à ma voiture, ils penseraient que je suis devenu fou.
N’est-il pas alors incroyablement excessif que nous ayons accepté un système dans lequel c’est exactement ce que fait l’industrie pharmaceutique ? La documentation clinique pour tout juste trois médicaments peut occuper jusqu’à 70 mètres de cartables (voir le chapitre 1). Dans mes 10 mètres de documents, j’aurais pu avoir caché quelque part que mes freins étaient défectueux sans que les inspecteurs l’aient jamais relevé. De la même manière, des procès ont révélé que les compagnies pharmaceutiques peuvent cacher des effets graves dans les montagnes de documentation, effets que les agences du médicament ne relèveront jamais. La différence est que si mes freins font défaut, je pourrai me tuer et peut-être tuer quelques autres personnes alors que lorsqu’une compagnie cache les effets mortels de son médicament alors qu’ il pourrait tuer des dizaines de milliers de gens. Il faudrait que nous soyons beaucoup plus prudents avec les médicaments que nous le sommes avec les véhicules, mais nous ne le sommes pas.
Pourquoi avoir créé un système dans lequel l’industrie est son propre juge alors qu’il est tellement manifeste que c’est insensé ? L’évaluation des médicaments devrait être une entreprise publique alors qu’elle ne l’est pas, et l’argent de l’industrie est partout : même nos agences du médicament sont payées par l’industrie et se font donc concurrence pour être la plus attrayante.
Un autre problème fondamental est qu’il s’agit d’un jugement de valeur – non d’une question scientifique – de décider qu’un médicament est trop dangereux malgré ses avantages. Que faut-il faire d’un médicament qui tue relativement peu de gens alors qu’il améliore la situation d’une foule de malades ? Il n’existe pas de règle d’or pour éclairer de tels jugements et les régulateurs ne font pas mieux que les citoyens ordinaires pour établir où l’on doit tracer la ligne de démarcation. Malheureusement, les régulateurs ne consultent pas la population ; ils consultent des gens impliqués dans des conflits d’intérêts ; des gens des compagnies qui possèdent le médicament et des spécialistes dont un grand nombre ont des conflits d’intérêts financiers en relation avec les médicaments qu’ils évaluent. Les régulateurs eux-mêmes peuvent aussi avoir des conflits d’intérêts financiers et même quand ils n’en ont pas, les avantages découlant d’une décision favorable pourraient se trouver juste à côté, sous la forme d’un poste lucratif dans une compagnie.
LES CONFLITS D’INTÉRÊTS DANS LES AGENCES DU MÉDICAMENT*
* NDT. Une agence du médicament est un organisme gouvernemental responsable de réglementer tous les produits utilisées pour traiter les maladies. La réglementation comprend la vérification de l’efficacité, de l’innocuité des produits et la définition des conditions d’utilisation correcte de ces produits et des règles régissant leur distribution et leur utilisation par la population.
Les conflits d’intérêts financiers sont très nombreux en régulation des médicaments1,2 et les régulateurs peuvent faire un va-et-vient entre l’industrie et les agences du médicament, c’est le phénomène de la « porte tournante ». Le commissaire de la FDA, Lester Crawford, a quitté l’agence après le scandale du Vioxx (voir le chapitre 13)3. Crawford avait autorisé le Vioxx, un médicament de Wyeth et après avoir démissionné, il devint conseiller cadre de la firme de relations publiques de Wyeth, Policy Directions Inc.4. Crawford fut plus tard mis à l’amende pour 90 000 dollars après avoir faussement déclaré qu’il avait vendu ses actions de compagnies relevant de la régulation de la FDA alors qu’il était resté propriétaire de ces actions5. Ces actions comprenaient des titres de Pepsico qui vend des boissons sucrées et de la restauration rapide rendant les gens obèses pendant qu’au même moment, Crawford présidait le groupe de travail de la FDA sur l’obésité6.
On s’est posé des questions au Danemark aussi quand le régulateur de médicament ayant aidé Nycomed à obtenir une autorisation pour une pilule amaigrissante, Letigen (signifiant « mince à nouveau ») s’en alla directement à un poste de direction de la compagnie qui allait commercialiser le médicament. Letigen était un mauvais médicament. Il contenait de l’éphédrine et on le retira plus tard du marché en raison de ses effets cardiovasculaires délétères.
Les membres des comités consultatifs des agences du médicament contribuent aussi à la corruption de l’intégrité scientifique. Certains travaillent pour les deux parties et ils extorquent les compagnies pharmaceutiques en exigeant des honoraires de consultant, inhabituellement élevés, ce que les compagnies peuvent difficilement refuser quand elles souhaitent faire approuver des médicaments2. Il est manifeste que les gens payés par l’industrie pour être sa voix dans les réunions de comité ne peuvent pas être aussi défenseurs des patients, ce qui signifie que leur rôle « d’expert indépendant » n’existe pas.
Les agences du médicament ne satisfont pas aux lois sur l’impartialité de l’administration publique bien qu’il ne semble pas difficile d’y arriver. Au Danemark, par exemple, un expert n’a pas le droit de donner des conseils sur des sujets où il a un conflit d’intérêts susceptible d’influencer l’avis, quand c’est possible d’obtenir un avis qualifié d’un expert sans conflit. Il y a quelques années, une tempête médiatique a été déclenchée quand l’Agence danoise du médicament a recruté la psychiatre Bente Glenthaj dans son comité d’enregistrement, lequel ne fait pas que donner des avis mais prend aussi des décisions concernant l’approbation de nouveaux médicaments7. Elle avait plusieurs conflits d’intérêts avec les compagnies pharmaceutiques mais ne pouvait pas voir en quoi cela posait un problème. C’est virtuellement ainsi que tout le monde évalue ses conflits d’intérêts financiers : pas de problème.
L’agence du médicament s’est défendue en disant qu’il était impossible d’obtenir l’expertise dont elle avait besoin sans accepter des gens en conflit d’intérêts. Cet argument était impossible à avaler. En 2011, il y avait 1201 psychiatres enregistrés au Danemark, dont 92 (8 %) avaient la permission de travailler pour une société pharmaceutique. L’agence du médicament voulait nous faire croire qu’aucun de 1109 autres psychiatres n’était qualifié. Pourtant le ministère de la Santé lui accorda l’exemption de la loi à la condition qu’elle ne participe pas aux cas où l’on pourrait douter de son impartialité. Un instant ! Si elle ne pouvait pas intervenir dans des cas où elle est experte, en psychiatrie, il ne restait plus de justification pour la garder à l’agence. Il va de soi qu’on ne fit rien. La pseudo-solution était en place.
Le cas danois est exemplaire. Ce que les agences du médicament font partout dans le monde, ce n’est pas d’éviter le recours à des experts en conflit d’intérêts mais de leur demander de déclarer ces conflits. Qu’on me pardonne la comparaison mais je la crois pertinente : quelle confiance aurait-on dans un service de police dont les détectives inviteraient, de routine, des repris de justice à travailler avec eux, une fois que ces criminels auraient déclaré que leur conflit d’intérêts était leur espoir que le cas ne soit jamais résolu (pour le motif que le crime aurait été commis par certains amis) ?
Les scientifiques des agences du médicament ne sont pas exposés qu’à une industrie très puissante, ils le sont également à leurs propres supérieurs et à leurs comités consultatifs qui peuvent avoir des motifs moins avouables d’orienter leurs décisions. Les patrons ferment souvent les yeux parce qu’ils dépendent du revenu lié aux frais d’approbation et de la bonne volonté politique, et parce que les questions concernant les effets nocifs sont porteuses d’ennuis. Il se développe une culture dans laquelle plusieurs décisions sont prises que les citoyens n’auraient pas laissé passer s’ils avaient été représentés aux comités-conseil des médicaments.
C’est ce qu’on appelle la théorie de la capture de l’emprise réglementaire. Les régulateurs en viennent à travailler si étroitement avec l’industrie qu’ils régulent qu’il devient inévitable que des amitiés se développent et qu’ils acquièrent une meilleure compréhension des problèmes de l’industrie et de ses positions que de ceux des patients qui restent des anonymes. L’industrie cesse donc d’être régulée efficacement et les agences s’engagent dans des négociations amicales et prolongées avec l’industrie plutôt que d’agir quand survient un danger pour la santé de la population1,3. C’est ce qui explique pourquoi la culture au sein de la FDA a la réputation d’être fondée sur l’intimidation, la crainte et un préjugé trop favorable à l’industrie1,2,8–12. La population générale est vue comme une masse hystérique et irrationnelle qu’on devrait mettre à l’abri de toute suggestion liant des effets nocifs à des produits réglementés8. Pourtant, il est curieux que les citoyens prennent part à la planification des villes d’une manière démocratique, alors qu’ils ne sont pas censés savoir ce qui se passe dans les agences du médicament.
En 2006, l’Institut de la médecine a écrit un rapport critique suggérant des changements radicaux13, mais la réponse de la FDA n’était pas adéquate et démontrait une incompréhension presque complète de l’ordre de grandeur des changements requis pour instaurer une culture favorisant la sécurité14. Quand des scientifiques de la FDA trouvent des signes d’effets nocifs graves, ils sont souvent désavoués par leurs supérieurs – allant même jusqu’à l’empêchement de présenter leurs découvertes des effets mortels de médicaments à des réunions des comités consultatifs – voire à l’affectation à un autre poste1,8−10,13. Et cela ne s’arrête pas là. Comme on l’a décrit au chapitre 3, la FDA a accepté des données de sécurité qu’elle savait être frauduleuses12, et – à plusieurs occasions – des données montrant clairement que le médicament n’était pas sécuritaire16.
Quand on considère ce qui se passe après l’approbation, rien ne justifie la confiance aveugle dans les agences du médicament non plus. Elles sont beaucoup trop lentes à réagir aux effets létaux des médicaments, quand elles réagissent1,9,12,15,17–19. Une raison est que, fort malheureusement, la régulation des médicaments n’est pas fondée sur le principe de précaution mais sur un principe permissif en vertu duquel, le bénéfice du doute est toujours accordé à l’industrie et non pas aux patients. Par exemple, la FDA approuva le Vioxx parce qu’elle n’avait pas la « certitude complète » que le médicament augmentait le risque cardio-vasculaire9, bien qu’on s’y soit attendu sur la foi du mécanisme d’action du médicament (voir le chapitre 13). Un autre motif est lié à la volonté de ne pas perdre la face. Les avertissements relatifs à un médicament, ou son retrait du marché, suggèrent que l’agence s’est trompée quand elle l’a autorisé20.
Il est vraiment effrayant qu’une enquête ait montré que 79 % des scientifiques de la FDA n’avaient pas confiance que les produits approuvés par la FDA soient sécuritaires9,21. Et que 66 % manquent de confiance dans la surveillance par la FDA de la sécurité des médicaments sur le marché22. La population a des opinions semblables. Dans une enquête d’opinion, 76% des répondants s’inquiétaient de ce que la FDA ne communique pas les problèmes de sécurité d’une manière efficace23.
Ces inquiétudes sont soutenues par les faits. Pas moins de 51 % des médicaments font l’objet de changements d’étiquette en raison de problèmes graves de sécurité découverts après leur mise en marché ; 20 % des médicaments obtiennent des mises en garde en encadré noir sur le contenant ; et plus de 1 sur 20 sont retirés du marché24–36.
En fait, c’est encore pire que cela. Les études post-mise en marché sont peu nombreuses et habituellement de qualité médiocre et le signalement spontané des effets nocifs est grossièrement inadéquat pour détecter même les effets graves. Il ne peut donc y avoir aucun doute que plusieurs de nos médicaments sont dangereux, mais le problème est qu’on ne sait pas lesquels. Le directeur adjoint David Graham qui a travaillé pendant 40 ans au bureau de la sécurité des médicaments de la FDA a illustré l’impuissance réglementaire avec une clarté qui a de quoi effrayer9 :
La façon dont la FDA traite la question de la sécurité est virtuellement de l’ignorer. La FDA est persuadée qu’il n’existe pas de risque qu’on ne peut pas gérer dans l’environnement post-commercialisation. Le cas des antidépresseurs et du risque de suicide en est un bel exemple. Comment la FDA s’y prend-elle pour résoudre cela ? Avec des changements d’étiquette. La FDA sait que les changements d’étiquette ne modifient pas la pratique médicale. Pourtant elle agit comme si elle venait de rendre un grand service à la population en modifiant l’étiquette. Plutôt que de s’assurer à 95 % de certitude qu’un médicament est sécuritaire, ce que la FDA dit c’est : « Nous ne pouvons être certains à 95 % que ce médicament vous tuera donc on conclut qu’il ne le fait pas et on le maintient sur le marché. Si on voulait vraiment que les médicaments soient sécuritaires, on pourrait le faire demain. Il est facile mettre en œuvre des études. Mais cela n’intéresse pas la FDA.
Les gens derrière les pupitres prennent des décisions qui ne fonctionneront pas dans la vie réelle et ils le savent. J’en parlerait plus longuement au chapitre 21.
LA CORRUPTION DANS LES AGENCES DU MÉDICAMENT
Il doit être très tentant pour les compagnies pharmaceutiques de corrompre les gens des agences du médicament, tellement sont énormes les sommes d’argent en cause. L’approbation d’un nouveau médicament peut signifier la différence entre la vie et la mort pour une compagnie et un cas récent illustre bien le problème. Je ne suggère pas qu’il y ait eu des méfaits, je ne fais que donner l’information. En 2012, la danoise Lundbeck et son partenaire japonais Takeda ont proposé le vortioxetine, un inhibiteur sélectif de la réabsorption de la sérotonine (ISRS) pour approbation régulatrice aux Etats-Unis. Cela ne paraît pas trop excitant puisqu’on dispose déjà d’une foule d’antidépresseurs mais cela pourrait se révéler important pour Lundbeck dont le grand succès, l’escitalopram, arrive sous peu en fin de brevet. Selon un porte-parole, la compagnie recevrait un paiement historique de 43 millions de dollars de Takeda, si la FDA autorisait le médicament.
Nous ne savons pas grand-chose au sujet de la corruption dans les agences du médicament, mais une partie de ce que je raconte dans le présent ouvrage est difficile à expliquer à moins que de l’argent soit mis en cause, d’une manière ou de l’autre, qui pourrait présager une récompense future prenant la forme d’un emploi bien payé dans la compagnie ou bien d’informations d’initiés à propos des actions de la compagnie (voir plus loin). En voici un exemple28. En 2006, la FDA introduisit de nouvelles règles concernant l’étiquetage, mais après que la période de 5 ans pour commentaires fut écoulée, l’agence ajouta discrètement une nouvelle section qui rendait virtuellement impossible pour les patients de poursuivre des compagnies pharmaceutiques en responsabilité professionnelle quand les patients auraient subi des torts infligés par leurs médicaments.
La FDA affirme que toute étiquette qu’elle a approuvée, que ce soit sur l’ancien format ou le nouveau a priorité sur les décisions d’un tribunal dans le contexte de litiges liés à la responsabilité civile d’un produit. Cette immunité vaudrait même si la compagnie avait omis d’avertir adéquatement les prescripteurs ou les patients d’un risque connu à moins qu’un patient puisse prouver que la compagnie avait commis une fraude délibérée. C’est ce qui est si scandaleux. Non seulement faut-il qu’il y ait fraude, encore faut-il qu’elle soit intentionnelle. Comment un patient peut-il savoir ce qui se passe dans la tête d’un dirigeant de compagnie ? Je me le suis souvent demandé moi-même. Et comment un patient peut-il prouver qu’il y a eu fraude ?
Les données peuvent se trouver dans les archives de la compagnie, mais cela ne prouve pas qu’il était frauduleux de ne pas les analyser et d’en parler. On comprendra que plusieurs politiciens se sont opposés à cette disposition et au fait qu’il n’y ait eu aucune occasion d’en débattre avant que les règlements n’entrent en vigueur. Pendant des années, l’industrie avait essayé d’obtenir une législation qui les immuniserait contre les procès mais le Congrès avait toujours rejeté cette idée et, tout à coup, surgissant de nulle part, la voilà produite par la même agence censée avoir la protection de la population américaine comme premier devoir. Comment peut-on expliquer cela – fait en toute discrétion, en vérité secrètement -, après que la période des commentaires fut terminé, si ce n’est pas par la corruption ?
En 2009, neuf scientifiques de la FDA ont écrit au président Obama relativement à la corruption généralisée aux plus hauts niveaux de la FDA, comprenant plusieurs commissaires4,29. Les scientifiques étaient frustrés et indignés et ils donnèrent plusieurs exemples de la corruption qu’ils décrivirent comme étant systémique et en infraction avec la loi. Ils affirmèrent qu’il régnait à la FDA une atmosphère dans laquelle les employés honnêtes redoutaient les employés malhonnêtes et que des hauts dirigeants, ayant supprimé ou modifié des constats techniques ou scientifiques ainsi que des conclusions, avaient abusé de leur pouvoir et de leur autorité pour s’employer à persécuter illégalement des lanceurs d’alerte.
En 2012, on a révélé que la direction de la FDA avait installé un logiciel espion sur les ordinateurs de cinq scientifiques qui avaient alerté en vain la direction administrative de la FDA au sujet de problèmes de sécurité et qui en avaient, en conséquence prévenu des politiciens30. On s’en est aperçu quand des milliers de documents confidentiels provenant des ordinateurs de ces scientifiques ont été affichés sur un site public, apparemment à la suite d’une erreur commise par un contracteur privé en manipulation de dossiers qui travaillait pour la FDA. L’affichage des documents fut découvert par hasard, par l’un des scientifiques que la FDA avait congédiés et qui avait fait des recherches sur Google pour vérifier s’il existait de la publicité négative capable de compromettre ses chances de trouver un autre emploi.
Il y eut d’autres révélations en 2012. Un ancien scientifique de la FDA, Ronald Kavanagh, a parlé des crimes et des méthodes de gangsters à l’Agence31 :
Pendant que j’étais à la FDA, les réviseurs de médicaments se faisaient dire clairement de ne pas poser de questions aux compagnies pharmaceutiques et que notre travail était d’approuver des médicaments. Si nous posions des questions, cela pourrait retarder sinon empêcher l’approbation de médicaments – ce qui était notre travail en tant que réviseurs de médicaments – l’administration nous réprimanderait, nous réaffecterait, convoquerait des réunions secrètes à notre sujet, et pis encore. Il est manifeste que dans pareil environnement, les gens s’autocensureront. Les études sur l’homme sont habituellement trop courtes et les nombres de participants trop petits pour décrire correctement les risques les plus dangereux. C’est pour ce motif qu’un seul cas doit être pris au sérieux. J’ai fréquemment trouvé des compagnies qui soumettaient certaines données à un endroit et d’autres données à un autre endroit et l’information sur la sécurité ailleurs, de sorte qu’il devenait impossible de les regrouper, puis se présentaient à une rencontre pour obtenir un accord en proposant que l’aspect sécurité était négligeable. Si des réviseurs affirment des choses qui déplaisent aux compagnies, elles se plaindront du réviseur ou appelleront la haute direction pour le faire réaffecter sinon désavouer. Une fois, la compagnie m’a dit qu’elle appellerait la haute direction pour faire éliminer une exigence claire pour l’approbation qu’elle refusait de respecter, ce que je pus voir se produire. Une autre fois, une compagnie a dit clairement « qu’elle avait payé pour obtenir une approbation»… Parfois nous recevions l’ordre explicite de nous en tenir à la lecture d’un résumé de 100 à 150 pages et d’accepter les revendications de la compagnie pharmaceutique sans étudier les données réelles, que j’ai, à de multiples reprises, vu contredire le document de résumé. À d’autres occasions, on m’a ordonné de ne pas réviser certaines sections de la demande d’approbation, presque immanquablement celles où se trouveraient les questions de sécurité.
La réponse de la FDA à la plupart des risques attendus est de les nier et d’attendre jusqu’à l’apparition d’une preuve irréfutable, une fois le médicament mis en marché et de simplement alors ajouter un avertissement dilué sur l’étiquetage. Quand on soulève des problèmes potentiels de sécurité, le refrain que j’ai entendu à répétition de la part de la haute direction était « Où sont les cadavres dans la rue ? ». Ce dont je déduisais qu’on ne ferait quelque chose qu’une fois que les journaux en feront un problème.
Plus tard, j’ai trouvé que la FDA disposait de documents arrivant à la même conclusion que mon analyse mais qu’ils n’avaient pas été communiqués au comité consultatif… Après que la direction de la FDA eut appris que je me m’étais présenté devant le Congrès relativement à certains problèmes, j’ai constaté qu’on était entré par effraction dans mon bureau et qu’on avait abîmé mon ordinateur. J’observai des mouvements étranges du curseur de mon ordinateur alors que je me trouvais à lire à mon bureau, lesquels j’ai soupçonné constituer une preuve d’espionnage. Cependant, les menaces peuvent se révéler bien pires que la prison. Un dirigeant a menacé mes enfants, qui venaient d’avoir 4 et 7 ans et à l’occasion d’une grande réunion, je fus traité de « saboteur ». En m’appuyant sur d’autres événements et certains dires, j’ai craint d’être assassiné pour m’être adressé au Congrès et à des enquêteurs. J’ai trouvé des preuves de délits d’initiés en relations avec des titres d’une compagnie pharmaceutique reflétant la connaissance d’informations que seule la direction de la FDA pouvait détenir. Je crois disposer aussi de preuves de falsification de documents, de fraude, de parjure, de racket étendu, comprenant l’intimidation et le châtiment de témoins. En fait, grâce en partie à la Loi sur les tarifs aux usagers des médicaments prescrits (en vertu de laquelle les compagnies pharmaceutiques paient pour une approbation accélérée) on ne pourrait pas empêcher la thalidomide encore aujourd’hui.
Il y a environ cinquante ans, Henry Welch, chef de la division des antibiotiques de la FDA a encaissé près d’un quart de million de dollars en honoraires privés des compagnies pendant qu’il certifiait l’efficacité et la sécurité de leurs antibiotiques32. Welch publiait aussi un périodique et partageait les articles en voie de publication avec les compagnies, disant qu’il apporterait les corrections qu’elles demanderaient en échange de commandes de tirés-à-part et de l’acheminement vers son périodique de revenus publicitaires33. Il y a eu d’autres cas d’officiers nommés de la FDA qu’on a corrompus pour l’approbation de médicaments, qui ont impliqué la transmission de documents confidentiels de concurrents soumis à la FDA et des sentences de prison tant pour les officiers de la FDA que des salariés de la compagnie34.
Quand j’ai travaillé dans l’industrie, un collègue m’a raconté que sa compagnie antérieure avait payé une pharmacologue clinique ce qui correspondait à une année de salaire pour réviser une demande d’approbation avant qu’on la soumette à l’agence. Une jolie somme pour quelques jours de travail et il est peu probable que la médecin en ait parlé quand plus tard, elle se retrouva de l’autre côté de la table à l’agence du médicament pour participer à l’évaluation de la même proposition.
Duilio Poggiolini, directeur général du département pharmaceutique du ministère italien de la Santé, a été arrêté en 1993 pour une série d’accusations liées à la falsification et à la corruption favorisant l’entrée de médicaments inutiles35. Le scandale impliquait le ministre de la santé qui avait pris les mesures pour que les compagnies pharmaceutiques paient des pots-de-vin afin d’obtenir l’approbation de leurs médicaments et qu’ils soient vendus à des prix « appropriés »36. Le réseau de corruption comprenait des universitaires qui recevaient leurs parts des pots-de-vin en échange de leur avis d’experts en faveur des médicaments, dont certains étaient dangereux et vendus à des prix exorbitants. On a estimé que juste en retirant du marché, cinq de ces médicaments inutiles, l’Italie aurait pu épargner 3 milliards de dollars en 1993. Poggiolini se retrouva en prison alors que le ministre avait une immunité parlementaire. En 2012, Poggiolini se fit imposer une amende de 5 millions d’euros, un petit montant compte tenu du fait que les autorités l’avaient d’abord accusé d’avoir accumulé 180 millions d’euros pendant 30 ans37. Le crime est certainement payant dans les services de santé.
En 2008, le vice-président de l’Agence italienne du médicament, Pasqualino Rossi, un des représentants les plus expérimentés de l’Italie à l’EMA, a été arrêté38. Six lobbyistes de compagnies pharmaceutiques ont aussi été arrêtés et le cas impliquait de la falsification de données d’études cliniques en retour d’argent comptant, le tout ayant été mis à jour par de l’écoute électronique et des caméras cachées. Le procureur de la poursuite a dit que la corruption avait mené à la dissimulation de effets nocifs des médicaments menaçant la vie. C’était un roman savon depuis le début. L’agence du médicament publia un communiqué stipulant qu’aucun de ses employés n’était sous enquête, mais quand la presse italienne nomma les officiers supérieurs qui avaient été arrêtés, l’on a retiré le communiqué et préparé un nouveau. Tout comme quand l’industrie pharmaceutique se fait prendre en faute, on nie tout en dépit des preuves incontestables. Des documents internes de Pfizer montrent que le psychiatre britannique Stuart Montgomery a délibérément évité d’informer l’agence du médicament pour laquelle il travaillait qu’il travaillait en même temps pour Pfizer. Il conseilla Pfizer lui faisant part du raisonnement de l’agence du médicament concernant la demande d’approbation de la sertraline (Zoloft) et de ce que la compagnie devrait faire pour obtenir l’approbation du médicament39.
Les États-Unis sont plus ouverts à étaler leurs scandales que les autres pays mais le peu que l’on connaît confirme les expériences américaines. Quand un scientifique de l’Agence allemande du médicament réclama la désapprobation d’un antibiotique dangereux, qui avait été retiré du marché dans la plupart des autres pays, sa carrière fut arrêtée. Le directeur de l’agence, Karl Uberla, qu’il a plus tard présenté comme corrompu, le muta dans une position dans laquelle il était censé s’occuper de « recherche inexistante »40. L’antibiotique était mis en marché par la firme allemande Hoechst, et Ùberla, qui avait déjà été lobbyiste pour l’industrie américaine du tabac, accepta des faveurs de Hoescht.
La multitude de décisions régulatrices procure plusieurs possibilités de corrompre les régulateurs. Dans certains pays asiatiques, l’approbation de médicaments peut être garantie pour des petites sommes d’argent8.
Au chapitre 17, je décrirai comment l’antidépresseur Prozac a été approuvé en Suède, grâce à la corruption.
L’INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DES POLITICIENS
L’industrie pharmaceutique fait aussi ce qu’elle peut pour corrompre les politiciens. Aux États-Unis, l’industrie contribue généreusement aux campagnes électorales et il y a plus d’un lobbyiste pour chaque membre du Congrès, ce qui en fait le groupe de pression le plus puissant à Washington41,42. L’industrie contribue aussi largement aux campagnes politiques et la plus grande partie de l’argent va aux Républicains41. Entre 1998 et 2006, l’industrie a dépensé 1,2 milliard de dollars en lobbysme et en contributions politiques43, et en 1994, les Républicains tentèrent d’abolir la FDA pour laisser l’industrie se réglementer elle-même33 !
Le lobbysme est aussi robuste à Bruxelles, ce qui, jusqu’en 201044, avait conduit au secret extrême sur la régulation des médicaments en Europe45,46. Le lobbysme a été si efficace que les dirigeants de la FDA perçoivent maintenant l’industrie, et non pas la population américaine, comme leur client1,2,15 et vont jusqu’à négocier avec l’industrie ses objectifs de rendement22. Les politiciens ont constamment poussé la FDA dans cette direction. Dans les années 1990, par exemple, le président Clinton incitait les dirigeants de la FDA à faire confiance à l’industrie en tant que « partenaire et non pas adversaire »15.
En 2002, la nomination du nouveau commissaire de la FDA, Alastair Wood, fut retirée à la dernière minute et selon un sénateur Wood attachait trop d’importance à la sécurité des médicaments2,47. Très bien ! C’est certainement un péché mortel d’être intéressé par la sécurité des médicaments quand on se fait offrir la plus haute position de l’agence américaine du médicament. Wood a été remplacé par Mark McLellan qui s’est fait l’écho de la prétention grotesquement fausse de l’industrie voulant que les prix élevés des médicaments découlaient des coûts très élevés de la mise au point des médicaments (voir le chapitre20)2,48, et il s’est aussi opposé au contrôle des prix2,49. Le titre d’un article du Boston Globe ne laissait aucun doute à propos de ce qui s’est passé : « L’industrie pharmaceutique prive un médecin de la direction de la FDA47 ». L’industrie venait de faire, une fois de plus, la preuve de son omnipotence.
Comme l’illustre cet exemple, l’interférence politique dans les affaires de la FDA contribue à ce qu’on a appelé le déclin du moral au travail dans l’agence. En Europe, des politiciens du Parlement danois et du Parlement européen m’ont expliqué comment ils se trouvent constamment hantés par les représentants de l’industrie pharmaceutique. L’industrie fait pression sur les politiciens par le lobbysme, les dons et parfois, la corruption ouverte – de laquelle on m’avait informé – pour introduire de nouvelles lois qui sacrifieraient la santé publique aux profits. Les contribuables n’écrivent pas les lois fiscales, mais dans une large mesure, les compagnies pharmaceutiques écrivent les règles régissant les médicaments8.
Aux États-Unis, les politiciens ont demandé une accélération des évaluations, ce qui a conduit à des évaluations plus superficielles de la sécurité des médicaments, sans oublier les médicaments déjà sur le marché, vu que ceux qui travaillent à la sécurité des médicaments sont devenus moins bien dotés en ressources humaines. L’importance porte maintenant sur l’approbation rapide des médicaments, ce qui stimule l’économie domestique par l’entremise de l’exportation15,25. Ces influences ont provoqué une détérioration marquée de la régulation des médicaments. Alors qu’il n’y eut que 1,6% des médicaments autorisés en 1993–1996 à se voir ultérieurement retirés du marché pour avoir provoqué des effets graves, les retraits ont augmenté à 5,3 % pour les médicaments approuvés en 1996–200025,26. En outre, les médicaments approuvés juste avant la date officielle de tombée – date imposée à la FDA par les politiciens bien que la période allouée soit trop brève pour faire une évaluation soignée de la plupart des médicaments – sont deux fois plus sujets au retrait du marché que les médicaments qui, en dépit de l’intention, ne sont pas parvenus à respecter l’échéancier et ont été approuvés après la date limite50,51.
Le signalement à la FDA des effets indésirables des médicaments a montré le même déclin en sécurité des médicaments. De 1998 à 2005, les effets indésirables graves qu’on a signalés ont augmenté de 2,6 fois et les effets mortels ont augmenté de 2,7 fois. Les effets graves signalés ont augmenté quatre fois plus rapidement que le nombre total des ordonnances aux patients ambulants52. Il y eut une contribution disproportionnée des médicaments contre la douleur et des médicaments qui modifient le système immunitaire, mais il y eut aussi une augmentation substantielle pour les autres médicaments.
D’autres données confirment les conséquences indésirables du choix de la FDA de mettre l’importance sur la rapidité plutôt que sur la sécurité15. En 1998,4% seulement des nouveaux médicaments lancés sur les marchés du monde avaient d’abord été approuvés par la FDA ; dix ans plus tard, c’était 66 %. À la fin des années 1990, la FDA autorisait plus de 80% des demandes de l’industrie pour de nouveaux produits par comparaison avec 60 % au début de la décennie.
À la fin des années 1990, la FDA qui fut déjà le leader mondial en matière de sécurité a été la dernière à retirer du marché plusieurs nouveaux médicaments, qui avaient été bannis par les autorités de la santé en Europe.
Au Canada, la situation n’est guère plus réjouissante53. La probabilité qu’un nouvel agent actif approuvé entre 1995 et 2010 soit éventuellement associé à un problème sérieux de sécurité était de 24% et pour les médicaments approuvés dans la filière accélérée des révisions médicamenteuses même pour les produits qui ne sont pas des percées thérapeutiques majeures, le taux était de 36 %.
Cette dégringolade de la FDA commença en 1992 avec la Loi sur les frais d’utilisateur des médicaments ordonnancés à la suite de laquelle les compagnies payaient la FDA pour ses services54. Pendant les dix premières années, le Congrès interdisait à la FDA de recourir aux frais imposés aux usagers pour évaluer la sécurité des médicaments après approbation55. La FDA a saboté le moral du Bureau de la sécurité des médicaments en lui retirant des scientifiques, en raccourcissant les délais de révision, en autorisant les médicaments en se fondant sur le seul effet sur des résultats de substitution (voyez un peu plus loin ce qu’il en est de ce problème), en élargissant son interprétation des médicaments potentiellement capables de sauver la vie, lesquels étaient soumis à approbation par voie accélérée14,54. Ces médicaments comprennent maintenant des traitements pour des problèmes chroniques communs, bien qu’il soit difficile de croire qu’ils soient capables de sauver des vies. De plus, certains de ces produits ont dû être retirés du marché pour des motifs de sécurité comme la troglitazone (Rezulin) pour le diabète, le dexfenfluramine (Redux) pour l’obésité et le rofecoxib (Vioxx) contre la douleur. Cela me paraît scandaleux. Je n’ai jamais entendu parler de pilules amaigrissantes ou de pilules contre la douleur qui soient en mesure de sauver des vies mais j’ai entendu parler de plusieurs de ces médicaments qui sont mortels et je les commenterai, plus loin.
Il est compréhensible que le moral des scientifiques de la FDA soit au plus bas, ce qui est très triste. Peu de fonctions sont plus importantes que celle d’un scientifique dans une agence du médicament. La responsabilité est colossale et une faute de jugement peut parfois résulter en milliers de décès frappant des bien-portants. Il faut donc lui offrir une rémunération exceptionnelle le protéger de toute influence inappropriée de ses patrons, des politiciens, de l’industrie pharmaceutique et des organismes de patients. Il faut également lui donner le temps nécessaire pour réviser attentivement les demandes d’approbation et poser les questions embarrassantes. Tout cela est tellement loin de la réalité et pourrait ressembler à un vœu pieux, mais en 2007, quatre directeurs antérieurs de la FDA étaient d’accord pour reconnaître que la FDA devrait être financée par la Trésorerie et non par les paiements de l’industrie54. Mais il n’y a toujours rien de changé. Les gouvernements prétendent ne pas avoir les fonds, mais cela est faux. Le système des frais aux usagers mène à l’approbation de beaucoup trop de médicaments très coûteux qui n’ont rien à offrir, ce qui surcharge la bourse publique par rapport à ce qui surviendrait si les agences du médicament avaient la latitude pour faire un travail plus méticuleux sans avoir à plaire à l’industrie. De plus, les fonds requis pourraient être obtenus par une petite taxe sur les prescriptions ; aussi peu que 0,5 % suffirait amplement.
Les politiciens s’immiscent directement dans les décisions de la FDA ce qui est tout aussi inacceptable que s’ils le faisaient dans un jugement du tribunal. Selon une enquête, 61 % des scientifiques de la FDA étaient au courant de pareille interférence politique21. Un exemple en a été donné dans un rapport de la FDA, en 2009, dans lequel quatre membres du Congrès et un ancien commissaire de la FDA, Andrew von Eschenbach, avaient indûment influencé l’approbation d’une plaque défectueuse pour les blessures du genou. L’approbation a été accordée en dépit du fait que les scientifiques de l’agence avaient, à répétition et à l’unanimité au cours de plusieurs années, jugé que l’appareil n’était pas sécuritaire parce que souvent défectueux ce qui contraignait les patients à subir une deuxième intervention56. Le rapport de la FDA parlait de pressions extrêmes, inhabituelles et persistantes, qui avaient commencé peu après que les membres du Congrès avaient reçu du manufacturier des contributions électorales mais, comme d’habitude, les accusés prétendirent qu’ils n’avaient pas été influencés par l’argent. Un administrateur de la FDA a confirmé qu’Eschenbach n’avait pas qu’exigé une évaluation accélérée mais aussi une recommandation favorable. Moins d’un an après l’approbation, la FDA a déclaré qu’elle réviserait sa décision.
La sécurité des patients est particulièrement médiocre en ce qui a trait aux dispositifs médicaux. Les dispositifs cardiovasculaires sont beaucoup plus risqués qu’une plaque du genou et en conséquence, soumis à une évaluation des plus rigoureuses. Encore là, les exigences sont minimales bien qu’elles devraient être encore plus rigoureuses pour les dispositifs que pour les médicaments, compte tenu du fait que les dispositifs sont implantés et ne peuvent être retirés comme on le peut avec un médicament57. Une révision de 78 demandes d’approbation pour des dispositifs cardiovasculaires ayant reçu une approbation préalable de la FDA a montré que seulement 27% des études avaient été randomisées, 65 % des demandes d’approbation n’étaient fondées que sur une seule étude et que dans 31 %, le groupe de comparaison était rétrospectif, ce qui est une conception extrêmement médiocre de la mise en œuvre d’une étude qui donne presque toujours une bonne image de la nouvelle intervention57. Pour ajouter l’injure à l’insulte, la Cour Suprême a statué que les patients qui sont blessés par un dispositif approuvé par la FDA ne peuvent poursuivre la compagnie !
L’implantation par cathéter de la valvule aortique (TAVI) offrait de l’espoir aux patients trop âgés ou trop malades pour subir les opérations de remplacement de la valvule aortique et depuis son introduction, 40 000 implantations ont été effectuées58. Toutefois, c’est très coûteux et son efficacité a été mise en doute par une étude de suivi autorisée par la FDA qui a démontré que plus de patients traités par TAVI sont décédés que ceux sous le traitement usuel. Cette étude reste non publiée et quand des chercheurs indépendants ont demandé d’y avoir accès, ils ont essuyé un refus de la part de la FDA et du commanditaire de l’étude.
Ce manque de respect total pour les patients – dont certains sont morts pour avoir été traités avec un dispositif de qualité inférieure – est incroyable. Malheureusement, il y a peu d’espoir que les politiciens vont nous aider à organiser un meilleur système. Après que le Comité de la santé de la Chambre des communes du Royaume-Uni eut révisé l’industrie pharmaceutique en détail, en 2004–200517, les membres du Parlement avaient le sentiment que l’Agence du médicament n’avait pas la compétence d’assumer ses obligations comme gardienne de la santé publique, mais le gouvernement refusa une audition publique ainsi qu’une recommandation stipulant qu’un médicament ne devrait pas être lancé tant que toutes les données cliniques n’auraient pas été versées dans un registre public59. L’excuse évoquée pour ne pas exiger l’accès aux données des études – à savoir que cela exigerait une modification de la réglementation de l’UE ‑était une diversion. Nous pouvons décider de ne pas acheter ou rembourser les nouveaux médicaments tant que les données cliniques n’ont pas été rendues disponibles. Ceci nous épargnerait beaucoup d’argent. Ce qui est disponible dans la documentation scientifique dans les années qui suivent l’approbation de nouvelles entités moléculaires est une sélection hautement préjugée de tous les résultats disponibles dans les agences du médicament60.
Au sein de l’Union européenne aussi, le lobbysme de l’industrie mène à des propositions bizarres qui ne sont pas dans l’intérêt des patients. En 2007, la Commission européenne a publié un document tragicomique intitulé Stratégie pour mieux protéger la santé publique61. La Commission a proposé de faire disparaître la clause stipulant que l’autorisation de mise en marché d’un médicament devrait être refusée quand son efficacité thérapeutique est insuffisamment étayée par l’auteur de la proposition ! Comment on améliorerait la protection de la santé publique en autorisant la mise en marché de médicaments inefficaces est difficile à expliquer. Health Action International (HAI), un grand organisme de patients, a protesté contre cette proposition et plusieurs autres tout aussi nuisibles, par exemple introduire les nouveaux médicaments plus rapidement pour susciter plus rapidement des retours sur l’investissement, ce qu’on pourrait faire avec des approbations conditionnelles qui deviendraient habituelles plutôt que des exceptions liées aux circonstances exceptionnelles, quand il y a un besoin thérapeutique urgent62. Le document de l’UE est une horreur et continue à saboter la sécurité des patients. Par exemple, la proposition que les compagnies soient chargées de la collecte et de l’analyse des données, de la publication des avertissements et de l’information décrivant les effets secondaires nuisibles de leurs produits après l’approbation de mise en marché, est une recette pour causer des désastres en santé publique. Les propositions de la Commission prévoyaient l’intervention de l’industrie à toutes les étapes de la prise de décision, la mettant tant dans la position du juge que dans celle de l’accusé. HAI a noté que les systèmes de pharmacovigilance des compagnies ne pouvaient en aucun cas, jamais, devenir des substituts pour les systèmes nationaux de pharmacovigilance qui, eux, sont sans aucune équivoque, au service exclusif de l’intérêt public.
La Commission a aussi proposé que pour les études postérieures à l’approbation, il devrait revenir aux compagnies de « décider si les résultats d’une étude doivent avoir un impact sur l’étiquetage d’un produit, ou pourraient influencer l’équilibre risques/avantages d’un produit pharmaceutique ». Il est incroyable que les politiciens puissent être aussi loin de la réalité et des faits bien établis. Mon ouvrage en entier concerne les patients grandement lésés parce que nous permettons à l’industrie d’être son propre juge. HAI Europe a condamné fortement les propositions de la Commission et a exigé qu’elle réoriente ses efforts et défende l’intérêt public, en accord avec son mandat de protéger les citoyens de l’Europe, découlant de l’article 125 du Traité établissant la Communauté européenne. Il est profondément déprimant qu’un groupe de consommateurs doive redire ce qui est manifeste. On ne répétera jamais trop souvent que, même en l’absence d’initiatives aussi stupides, aux États-Unis et en Europe, les médicaments sont la troisième principale cause de mortalité après les maladies cardiaques et le cancer (voir le chapitre 21).
Le système danois pour gérer les cas allégués d’inconduite scientifique constitue un autre exemple de la manière avec laquelle des politiciens ignorants et mus par l’idéologie peuvent nuire à la santé publique. Nous avions l’un des plus vieux et des meilleurs systèmes du monde entier. Mais, en 2005, le ministre danois des Sciences, Helge Sander, qui ne connaissait rien en science mais qui avait introduit le football professionnel au Danemark, décida que le comité de l’inconduite ne pouvait s’occuper des cas d’inconduite de chercheurs privés et des compagnies que lorsque ces gens acceptaient de faire l’objet d’une enquête alors que les chercheurs employés par les services publics pouvaient être l’objet d’enquête qu’ils soient d’accord ou pas63. Il s’ensuivit une tempête de protestations provenant de tous les horizons, même de la part de Novo Nordisk, dont le porte-parole a déclaré que toute la recherche, qu’elle soit publique ou privée devait être effectuée correctement. La réaction du ministre ? La recherche de l’industrie pharmaceutique danoise ne doit pas être contrôlée par des fonctionnaires. Cette réponse stupide déclencha un tsunami. Le prochain commentaire du ministre ? Pas de commentaire.
Novo Nordisk avait raison, mais l’Association danoise de l’industrie pharmaceutique a profité de l’occasion pour se permettre une réaction extrêmement effrontée. Elle a prétendu que ses membres étaient fatigués de ces médecins qui les accusaient dans les médias, de fausser les résultats de leurs recherches64. (Ces « médecins » étaient plus ou moins une personne : moi !) L’Association déclara qu’il était parfaitement faux que ses membres manipulent leurs résultats et elle ajouta que la publication de sa recherche relève de la responsabilité des médecins. L’Association était prête à laisser ses membres se soumettre aux enquêtes à la condition que le comité accepte de faire enquête pour inconduite scientifique possible de la part de ces médecins qui critiquent les études en nommant les compagnies qui les ont effectuées. J’ai rarement vu plus effronté et plus scandaleux. Les compagnies manipulent de routine les données qu’elles publient de sorte que, chaque fois qu’un médecin critique cela, que ce soit dans les médias ou bien dans une lettre au rédacteur d’un périodique ayant publié la recherche, le médecin devrait être signalé au comité de la malhonnêteté scientifique pour fin d’enquête. C’est comme en Union soviétique où les gens qui critiquent ceux qui détiennent le pouvoir sont astreints à des examens psychiatriques et parfois incarcérés pour la vie, quand on ne les fusille pas sur le champ.
C’est nuisible pour la santé que les politiciens aient permis la publicité directe aux consommateurs aux États-Unis. Quand le statut d’un médicament sous ordonnance change en celui d’un médicament en vente libre, l’information portant sur ses torts et ses contre-indications peut se perdre65. Ce déficit d’information nuit à nos concitoyens qui sont déjà surmédicamentés et aussi dans les pays qui ne permettent pas cet assaut contre la bonne santé dont la majorité d’entre nous jouissons de toute façon.
Il est proprement dégoûtant de voir les publicités télévisées des Etats-Unis, qui sont présentées par une doucereuse voix féminine comme celle qu’utilisent les hôtesses de l’air pour nous dire leur espoir qu’on choisira à nouveau leur société pour voyager quand ce n’est pas dans une profonde voix de basse masculine pour inspirer la confiance. Les publicités se terminent invariablement avec une invitation ressemblant à : « Demandez à votre médecin si le Lyrica vous convient. ». Ou bien encore avec : « Vous pourriez souffrir d’une maladie sans le savoir. »
Je suis bien d’accord, j’ai sûrement un cancer puisqu’on peut trouver du cancer chez tous ceux qui ont plus de 50 ans, quand on se donne le mal de le chercher avec suffisamment de zèle66,67. Pour ma part, je préfère ne pas le savoir puisque je ne me sens pas malade et parce que le traitement de ces pseudo-cancers n’est pas inoffensif.
La publicité par le recours aux célébrités est très employée aux États-Unis, par exemple lors de bulletins d’information et d’émissions de discussion, dont la commandite de l’industrie n’est pas mentionnée de sorte que les témoignages semblent authentiques41. Nous n’avons pas cela au Danemark, mais en 2004, nous avons quand même connu un cas bizarre de publicité par célébrité, importée directement des zones d’influence les plus hautes des États-Unis68. Merck était mécontente que son médicament contre l’ostéoporose, l’alendronate (Fosamax), ne soit pas remboursé au maximum et avait traîné le gouvernement danois devant le tribunal. Merck avait aussi arrangé une rencontre entre le ministre de la Santé et l’ancienne secrétaire d’État, Madeleine Albright, sous le prétexte de discuter du système de santé danois et de celui sur le remboursement. Deux jours avant la rencontre, elle demanda si elle pouvait se faire accompagner du directeur de Merck Danemark, ce qui fut accepté. Pendant la réunion, à laquelle le ministre fut empêché d’assister, Mme Albright a parlé du médicament qu’elle prenait contre l’ostéoporose. Elle ne s’est pas fait beaucoup d’amis avec ce truc publicitaire, car ce n’est pas comme cela qu’on se comporte au Danemark et l’embarras dans lequel cela nous plongea fut discuté dans un journal : « Le géant du médicament utilise des pressions américaines dans le cas danois sur le médicament68. »
Il arrive à l’occasion que l’on observe un petit progrès. Jusqu’à récemment, l’Agence européenne du médicament faisait partie du Directorat général pour l’entreprise et l’industrie de l’UE46, mais on l’a maintenant déménagée au Directorat général pour la santé et les consommateurs. En 2007, une nouvelle législation a augmenté la puissance de réaction de la FDA69. Par contre, il arrive qu’on relève des tendances vers le pire. En 2012, le Sénat des États-Unis a proposé un élargissement des évaluations accélérées en créant une nouvelle catégorie pour « les médicaments constituant des percées »70.
LA RÉGULATION DES MÉDICAMENTS EST FONDÉE SUR LA CONFIANCE
La théorie économique prédit que les firmes investiront dans la corruption relative aux preuves
chaque fois que les avantages seront plus élevés que les coûts.
Quand la détection est coûteuse pour les régulateurs,
il faut s’attendre à ce que la corruption de la preuve soit vastement étendue.
Alan Maynard, manuscrit non publié
Selon les régulateurs du médicament, le système de régulation est fondé sur la confiance, ce qu’ils estiment convenir, puisque les conséquences pour les compagnies seraient trop sérieuses si elles devaient tricher et se faire pincer. Comme Maynard l’explique, cet argument n’est pas juste. En outre, comme on l’a vu, la grande industrie pharmaceutique signifie grands crimes et à quel autre endroit de la société ferait-on confiance à la parole de criminels ? Les rats de laboratoires mentionnés dans les études de toxicologie pourraient n’avoir jamais existé ; il se pourrait qu’ils aient crevé plus d’une fois ; ils peuvent être morts bien qu’on les décrive comme bien portants dans les rapports de toxicologie ; des prélèvements d’organes peuvent manquer ; des données ont pu être fabriquées ; et les animaux ont pu périr avant même de présenter des cancers induits par les médicaments8,16.
Les sociétés pharmaceutiques ne se font pas confiance, mais les agences du médicament sont censées faire confiance à l’ensemble de l’industrie16. Les autorités savent parfaitement bien qu’on ne peut se fier à l’industrie et c’est pour des considérations pratiques quelles disent le contraire. Elles ne peuvent réviser qu’une petite fraction des montagnes de documents qu’elles reçoivent. Un exemple extrême, le rapport d’une étude sur le Tamiflu comprenait 8 545 pages, ce qui est 1000 fois plus que la version publiée71. Il est compréhensible que la plupart des régulateurs ne lisent que les résumés la plupart du temps et, à ma connaissance, il n’y a que la FDA pour refaire de routine, ses propres analyses statistiques sur les documents soumis mais l’EMA entend maintenant le faire elle aussi (voir le chapitre 11).
Plusieurs des milliers de pages sont parfaitement inutiles et je n’ai aucun doute que l’industrie inonde délibérément les régulateurs de données, ce qui lui donne deux avantages. Premièrement, cela réduit le risque que les régulateurs détectent quoi que ce soit qui pourrait empêcher le médicament d’être approuvé ou qui pourrait nuire aux ventes en raison d’un avertissement sur l’étiquette. Ensuite, si des problèmes surgissent, l’industrie peut prétendre qu’elle n’a rien caché et que ce sont les régulateurs qu’il faut blâmer. Bien que cela ne soit pas complètement vrai, cela pourrait fonctionner devant un tribunal.
Les régulateurs sont tellement surchargés qu’ils ne vérifient même pas que tout est bien là, ce qu’ils devraient faire. Nous avons trouvé plusieurs exemples où des appendices importants avaient été écartés ou que des pages centrales d’un rapport étaient manquantes. Des études complètes peuvent aussi être manquantes, par exemple deux de sept études négatives sur les inhibiteurs sélectifs de la réabsorption de la sérotonine (ISRS) chez les enfants72, bien que cela soit interdit par la loi.
Il n’est pas surprenant que des effets nocifs sérieux de nouveaux médicaments puissent passer inaperçus compte tenu du fait qu’on peut très bien les cacher dans les demandes d’approbation et autres soumissions parce qu’il faudrait consacrer un long et fastidieux travail de détective pour pouvoir les mettre en lumière1,73,74. Un exemple de cela est celui des bêta-agonistes d’action prolongée pour le traitement de l’asthme. Dans les années 1990, surgirent des inquiétudes selon lesquelles ces médicaments pourraient augmenter les décès causés par l’asthme plutôt que les réduire et la FDA demanda à GlaxoSmithKline de réaliser une grande étude du salmeterol, l’étude SMART ». La gestion de l’étude par Glaxo fut effectuée d’une manière beaucoup trop astucieuse cependant, la compagnie ayant manipulé les résultats expédiés à la FDA.
En 2003, ces résultats furent présentés à un congrès de pneumologues où Glaxo prétendit que les résultats n’étaient pas concluants, ce qui était mensonger. Le conseil de surveillance des données et de la sécurité de l’étude avait recommandé l’arrêt de l’étude après que 26 000 des 60 000 patients envisagés pour l’étude ont été recrutés, parce que plus de décès avaient été relevés dans le groupe assigné au salmeterol que dans le groupe assigné au placebo, ou l’inverse ; on a recruté 10000 patients de plus73.
La durée prévue de l’étude était de 28 semaines, mais les chercheurs pouvaient – s’ils le voulaient – signaler les effets secondaires graves survenant pendant une période additionnelle de 6 mois. La FDA postula évidemment que les données qu’elle révisa provenaient de la période rigoureusement contrôlée de la période sous double insu. Ce n’est que lorsque la FDA demanda spécifiquement à la compagnie quel ensemble de données elle lui avait fourni, que Glaxo révéla qu’elle avait inclus les données provenant de la période de suivi de six mois. Cela faisait une différence gigantesque. Il n’y avait pas de différence significative sur le plan statistique des décès associés à l’asthme quand on introduisait les données de la période de suivi, alors que le risque était quatre fois plus élevé quand on ne tenait compte que des seules données de l’étude, ce qui était statistiquement significatif. Des chercheurs indépendants ont conclu qu’en l’absence de transparence associée aux rencontres du comité consultatif de la FDA, les tromperies n’auraient jamais été connues du public73. Glaxo répondit aux révélations en disant qu’elle avait « agi d’une manière responsable et transparente74 ».
Ce n’était pas encore tout. Près de trois ans après la fin de l’étude, celle-ci n’avait toujours pas été publiée. Les résultats de SMART confirmaient les résultats d’une grande étude que Glaxo avait déjà menée et publiée en 199375. Glaxo avait comparé le salmeterol avec son médicament de courte durée, le salbutamol, et trois fois plus de patients décédaient des suites de l’asthme quand ils recevaient le médicament de longue durée (P = 0,11 pour la différence). En 2006, une méta-analyse incluant l’étude SMART a confirmé que les bêta-agonistes de longue durée augmentent les décès associés à l’asthme76. À première vue, le risque absolu de mourir semble petit, seulement un par 1 000 patients par année de consommation. Cependant, le salmeterol était l’un des médicaments les plus prescrits dans le monde et cette augmentation du risque se traduit en 4000 à 5000 décès par asthme additionnels chaque année seulement aux États-Unis76.
En juillet 2005, la FDA se demanda si les bêta-agonistes d’action prolongée devraient être retirés du marché, mais l’agence opta plutôt pour de sévères avertissements et la recommandation de ne recourir à ces médicaments qu’après l’échec des autres médicaments76. En 2010, la FDA lança un nouvel avertissement, cette fois à propos d’un risque augmenté d’exacerbations graves des symptômes de l’asthme, menant à l’hospitalisation et au décès et avertit de ne jamais prendre ces médicaments seuls mais conjointement avec un corticostéroïde en inhalation77. Pourtant, l’ajout de l’inhalation de corticostéroïdes ne résout pas le problème, par exemple, le risque d’admission à l’hôpital restant augmenté au double. La FDA exigea aussi des manufacturiers qu’ils effectuent de nouvelles études cliniques pour évaluer la sécurité de ces médicaments quand on les utilise en combinaison avec l’inhalation de corticostéroïdes. Je trouve cela bizarre. Les requêtes d’études additionnelles de la FDA sont habituellement ignorées par les compagnies et la FDA ne les contraint pas. Ces médicaments sont dangereux – probablement aussi quand ils sont combinés avec des stéroïdes – et nous n’en avons pas besoin, alors pourquoi ne pas les retirer du marché ?
Quand Glaxo a fini par publier les résultats de SMART dans Chest, on mentionna l’augmentation des décès par asthme mais ce sont les deux dernières phrases du résumé qui sont intéressantes79 :
Les analyses de sous-groupes suggèrent que le risque puisse être plus grand chez les Afro-Américains par comparaison avec les participants Caucasiens. Il demeure cependant inconnu que ce risque augmenté soit dû à des facteurs comprenant l’effet physiologique du traitement mais n’y étant pas limités, à des facteurs génétiques ou au comportement de certains patients menant à des résultats médiocres.
Des écrans de fumée et l’article sent mauvais : « Les sous-groupes de la population ont été fondés sur les caractéristiques au départ comme (je souligne) l’utilisation de corticostéroïdes en inhalation (CSI) et la phase de l’étude. De plus, les résultats ont été analysés séparément pour les sujets Afro-Américains et les Caucasiens.
Comme ? Glaxo ne nous dit même pas combien de fois, elle a trituré les données avant de trouver le résultat de sous-groupe qu’elle pouvait utiliser pour duper les lecteurs et les porter à croire que le médicament ne faisait tort qu’aux Afro-Américains. La manipulation des données en elle-même était trompeuse. Il n’y avait pas de test d’interaction, ce qui est nécessaire pour qu’on puisse dire qu’il existe une différence entre les résultats de deux sous-groupes. Et, en vérité, le risque relatif de décès par asthme était très semblable pour les Caucasiens et les Afro-Américains. La section Discussion de l’article ne parle que d’un des sous-groupes, ce qui est trompeur : « Les analyses post hoc n’ont montré aucune différence significative entre les traitements dans la population caucasienne. » Glaxo venait de transformer un effet nocif manifeste en un effet nocif inexistant. Les mots me manquent, mais cela en dit long sur les motifs pour lesquels on ne peut pas se fier aux études commanditées par l’industrie. Deux des cinq auteurs étaient des employés de Glaxo et les trois autres étaient à la solde de Glaxo.
Il semble que Glaxo ait fait ce qu’elle pouvait pour protéger son médicament plutôt que les patients79. Dans un éditorial cinglant du New England Journal of Medicine, les rédacteurs ont expliqué que Glaxo avait refusé de fournir un inhalateur pour une étude du salmeterol par le NIH. Les chercheurs ont été contraints de dépenser 90 000 dollars de l’argent des contribuables pour reconditionner le médicament actif et créer un placebo qui soit visuellement identique pour les fins de l’étude. En outre, les rédacteurs ont écrit :
L’objectif affirmé par Glaxo est « d’améliorer la qualité de la vie humaine », mais les compagnies peuvent mettre au point et vendre leurs traitements parce qu’elles peuvent puiser dans une ressource de la communauté : les patients disposés à courir le risque quand ils participent aux études cliniques. De leur côté, les compagnies doivent être disposées à mettre leurs produits à risque en les fournissant à des tiers pour des fins d’étude. Le défaut de le faire est un geste mesquin inacceptable.
Les compagnies pharmaceutiques peuvent non seulement tromper les autorités dans leurs demandes d’approbation ; elles peuvent aussi mentir quand on les questionne directement. Dans des documents préparés pour une audition de la FDA en 2005, Pfizer a nié que son AINS celecoxib provoque des crises cardiaques en s’appuyant sur une analyse de 44000 patients80. Mais les grands nombres évoqués par l’industrie quand elle se trouve sur la défensive sont souvent trompeurs. Pfizer détenait des preuves non publiées du contraire80,81, par exemple une étude de 1999 de la maladie d’Alzheimer. De plus, un cadre de Pfizer reconnut dans une entrevue que son analyse ne comprenait pas d’études extérieures indiquant que son médicament causait des problèmes cardiaques. Une telle étude82, que Pfizer connaissait, avait été menée par le NIH et interrompue une fois qu’on eut trouvé que des fortes doses de celecoxib faisaient plus que tripler l’incidence des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux.
D’autres compagnies ont elles aussi trompé la FDA en cachant des études et des résultats montrant que leurs médicaments entraînent des effets nocifs mortels1,8,16,27,83–85.
Il existe une autre raison pour laquelle nous en savons trop peu au sujet des effets nocifs des médicaments. Les cliniciens sont censés signaler les effets secondaires néfastes graves aux autorités, mais selon un estimé commun seulement 1 % environ de ces événements sont signalés86. Les médecins sont occupés et peuvent avoir tendance à penser qu’un événement n’est pas lié à un médicament et à l’ignorer, d’autant plus que c’est bien commode. Quand ils signalent un événement, ils peuvent apprendre à ne jamais plus le faire, harcelés qu’ils sont par un représentant pharmaceutique qui revient continuellement avec toutes sortes de nouvelles questions sur le patient, sur les autres médicaments qu’il prenait, etc. Il semble que personne ne soit vraiment intéressé par les effets nocifs, hormis la victime. Quand j’ai travaillé dans un département de maladies infectieuses, j’ai appris pourquoi plusieurs événements sérieux survenant dans des études du SIDA commanditées par l’industrie n’étaient pas signalés. Les formulaires étaient longs et compliqués et nous n’avions pas le temps pour des discussions sans fin avec la compagnie pharmaceutique.
L’ÉVALUATION INADÉQUATE DES NOUVEAUX MÉDICAMENTS
Quand j’enseigne à des médecins en formation pour devenir pharmacologues cliniques et que j’explique pourquoi les exigences réglementaires relatives aux nouveaux médicaments ne sont pas adéquates ni capables d’assurer que les médicaments sont efficaces et inoffensifs, et comment l’industrie pharmaceutique manipule sa recherche, je me trouve confronté à des réactions mixtes. Certains sont parfaitement d’accord et d’autres sont tout à fait hostiles, comme si je tentais d’expliquer à un enfant que le Père Noël n’existe pas. Cela m’inquiète, car ce sont là les médecins qui seront en poste dans une agence du médicament ou dans l’industrie pharmaceutique. J’ai parfois le sentiment qu’il est déjà trop tard pour leur faire entendre raison.
Nous pourrions facilement faire bien mieux que nous le faisons présentement pour protéger la santé publique et éviter de gaspiller notre argent et je donnerai quelques exemples.
Deux seules études contrôlées avec placebo montrant un effet ne suffisent pas
Les agences du médicament estiment que l’efficacité est démontrée quand deux études contrôlées avec placebo ont montré un effet. Comme j’ai expliqué au chapitre 4, cela est facile à réaliser pour la plupart des médicaments destinés à toute maladie parce que les médicaments ont des effets secondaires et que l’on peut s’attendre qu’ils aient des effets sur l’évaluation d’un résultat subjectif. Quand la taille de l’échantillon est assez grande, n’importe quel effet deviendra statistiquement significatif et le médicament sera approuvé, s’il n’est pas trop toxique.
Quand une compagnie ne réussit pas dans ses deux premières tentatives, elle peut faire d’autres études jusqu’à ce que deux essais donnent les résultats recherchés. Avec cela en arrière-plan, il est étonnant que le ministre danois de la Santé, après consultation auprès de l’Agence du médicament, ait répondu à un politicien qu’il n’existe pas d’exigence stipulant qu’un médicament soit meilleur qu’un médicament existant pour obtenir son approbation, mais qu’il doit être au moins aussi bon et jamais pire qu’un médicament existant. Toutefois, quand on n’exige que des études contrôlées au placebo, il n’y a pas moyen de savoir si les nouveaux médicaments sont pires que ceux qui existent.
Les compagnies sont contraintes par la loi de soumettre toutes les études qu’elles ont menées quand elles demandent l’approbation d’un médicament mais le problème avec cette exigence est qu’on ne peut pas se fier aux compagnies pharmaceutiques. Des études peuvent manquer et quand elles ont été effectuées dans des pays sans surveillance publique, il peut se révéler impossible de savoir qu’elles existent.
Les médicaments contre la toux ne sont pas efficaces87,88, mais l’industrie pharmaceutique a quand même réussi à faire approuver d’innombrables médicaments pour la toux et les ventes sont élevées89. Pas moins de 20 % de tous les enfants de moins de quatre ans sont traités avec des médicaments pour l’asthme comme la terbutaline, ce qui montre que la commercialisation crapuleuse à laquelle j’ai participé quand je travaillais chez Astra a été hautement efficace (voir le chapitre 2).
Aux États-Unis, les médicaments pour le rhume et la toux en vente libre avaient été consommés par 39 % des ménages sur une période de trois ans.90 Plusieurs de ces médicaments ont été autorisés avant 1972 quand il n’y avait que peu de contrôle sur les médicaments, mais les centres antipoison avaient signalé plus de 750 000 appels d’inquiétude pendant sept années en relation avec ces produits et la FDA avait identifié 123 décès d’enfants de moins de six ans, dans ses banques de données. Les effets secondaires néfastes comprennent l’arythmie cardiaque, les hallucinations, la somnolence et l’encéphalopathie. Les publicités des manufacturiers présentent ces médicaments comme efficaces et inoffensifs, deux mensonges.
Une pétition a demandé à la FDA de réviser ces médicaments, mais les manufacturiers ont prétendu que les mauvais effets pourraient être prévenus par l’éducation des parents, ce qui est un mensonge abominable. En 2011, la FDA a annoncé que ces produits ne doivent pas être utilisés chez les enfants de moins de deux ans et qu’elle appuyait fortement « les initiatives de plusieurs manufacturiers de médicaments qui avaient volontairement retiré du marché des remèdes pour le rhume et la toux qu’on vendait pour utilisation dans ce groupe d’âge91 ». Pourquoi la FDA ne retirait-elle pas ces produits inutiles et potentiellement dangereux du marché ? Et pourquoi, après quatre années, faut-il que la FDA soit toujours en train de réviser la sécurité et qu’on s’attende à ce qu’elle rende son jugement dans un proche avenir, comme elle l’a affirmé ? Même quand des médicaments inutiles tuent des enfants, les régulateurs du médicament n’agissent pas, alors qu’ils ont retiré du marché plusieurs produits efficaces, même quand ils causaient moins de décès. La régulation des médicaments n’est pas une entreprise logique.
J’ai discuté une fois des remèdes pour la toux avec un régulateur de médicament qui a attiré mon attention sur les études accompagnant une demande d’approbation qui soutenaient avoir montré que les médicaments agissaient. C’est l’un des articles les plus bizarres que j’aie jamais vu (et j’en ai vu des tonnes). Les études avaient été menées en Inde. Un microphone miniature très sensible mis au point par Procter & Gamble, attaché au nez d’un patient, enregistrait le moindre son qui survienne et qui était peut-être ou pouvait devenir de la toux92. Les trois médicaments évalués (guaiphenesine, bromhexine, et dextrométorphan) agissaient. Surprise, surprise. Les enregistrements étaient entièrement non pertinents pour les patients. Deux des médicaments augmentaient aussi le volume des crachats. Quel sens donner à cela ? S’ils augmentent le volume des crachats, ils augmenteront aussi le volume des expectorants mesurés en volume de crachats, or cela ne serait pas un avantage mais un effet nuisible. Les études ont été publiées dans Pulmonary Pharmacology, un périodique obscur dont je n’avais jamais entendu parler. Ce n’est pas la faute des régulateurs d’avoir à accepter pareilles niaiseries ; c’est la faute de politiciens qui n’ont pas exigé des résultats qui soient importants pour les patients.
Les études cliniques dans les pays largement corrompus
De nos jours, les études de médicament sont de plus en plus données en sous-traitance à des pays sans surveillance et très largement corrompus. Comment savoir que les données ont été fabriquées quand on ne dispose d’aucun moyen pour surveiller les études ? En dépit de la forte opposition des scientifiques, des éthiciens et des groupes de consommateurs, la FDA a décidé en 2008 que les études cliniques menées hors des États-Unis n’avaient plus à se conformer à la déclaration d’Helsinki quand elles servent à appuyer une demande d’approbation de produits aux États-Unis93. Qu’on me pardonne mais tout le monde est-il devenu fou à la FDA ? La direction de la FDA a‑t‑elle jamais entendu parler des procès de Nuremberg ? Ou bien des expériences menées sur les prisonniers des États-Unis quand la Déclaration d’Helsinki n’était pas là pour mettre d’entrave ? Ou de l’affaire Tuskegee dans laquelle des chercheurs de l’Alabama ont suivi 399 hommes noirs infectés de la syphilis sans jamais les traiter pendant 40 ans pour étudier l’histoire naturelle de la maladie en les empêchant d’avoir accès aux programmes de traitement disponibles pour les autres et pendant que plusieurs mouraient de la syphilis, que les épouses contractaient la maladie et que les enfants naissaient avec la syphilis congénitale94 ? Ou que les compagnies pharmaceutiques mènent leur recherche dans les pays pauvres pour les médicaments particulièrement dangereux parce que les paysans ne poursuivent pas les grandes corporations pour des lésions et parce que les règlements encadrant le consentement éclairé n’existent pas ou sont mollement appliqués8 ? L’exemple le plus connu de l’utilisation des cobayes du tiers-monde est celui des contraceptifs oraux, qu’on a d’abord testés à Porto Rico, puis en Haïti et au Mexique et, quand vint le moment de les tester aux Etats-Unis, on a choisi des pauvres, dont 90 % étaient soit des Mexicains, soit des Africains d’origine8.
Par contraste avec cette décision indéfendable, la Cour d’appel des États-Unis a jugé quelque temps après que la Déclaration d’Helsinki constituait une norme suffisamment coutumière pour être tenue comme obligatoire dans l’étude de la méningite menée par Pfizer au Nigeria où les parents ne savaient pas que leurs enfants participaient à une étude. La cour a renversé le renvoi, par un tribunal inférieur, d’une poursuite intentée par les familles d’enfants morts ou blessés pendant qu’ils recevaient l’antibiotique expérimental de Pfizer, la trovoflaxine, bien qu’un médicament plus efficace ait été disponible aux Médecins sans Frontières95. Pfizer recruta des enquêteurs pour chercher des preuves de corruption à l’encontre du procureur général dans l’espoir de pouvoir le persuader de laisser tomber la poursuite96. Cela échoua et Pfizer fut contrainte de payer une compensation aux familles dont les enfants étaient morts. Le médicament n’avait jamais été conçu pour l’Afrique. Pfizer entendait le vendre aux Etats-Unis et en Europe, mais son autorisation a été retirée en Europe en raison d’inquiétudes au sujet de sa toxicité pour le foie.
Un effet sur un résultat de substitution ne suffit pas
Une des pratiques les plus nuisibles en régulation des médicaments est de donner l’approbation à un médicament sur la foi de ses effets sur des résultats de substitution. Vu que cette erreur a coûté la vie à des centaines de milliers, ou peut-être même à des millions de patients (voir plus loin) il est difficile de comprendre que les régulateurs n’exigent pas des effets prouvés sur des résultats pertinents.
Voici un exemple. J’étais médecin depuis deux ans quand j’ai diagnostiqué une forme légère de diabète de type 2 chez un vieillard qui avait été admis pour un autre motif, au département d’hépatologie où je travaillais. J’écrivis dans son dossier qu’il était habituel de commencer le traitement avec la tolbutamide mais vu que la seule grande étude jamais réalisée sur la tolbutamide avait dû être interrompue avant terme en raison d’un excès de décès cardiovasculaires et parce que les patients qui consommaient la plus grande partie de leur dose quotidienne étaient aussi ceux qui démontraient le taux le plus élevé de tels décès, je décidai de ne pas commencer un traitement à la tolbutamide.
Mon supérieur hiérarchique m’apostropha de belle manière après avoir lu mes notes. « Comment oses-tu ne pas commencer la tolbutamide en effraction des consignes de pratique que les endocrinologues ont rédigées ? » J’expliquai calmement mais fermement que j’en savais plus sur ce médicament que les endocrinologues parce j’avais lu attentivement le rapport de l’étude ainsi que les articles et les nombreuses lettres qui suivirent ainsi qu’un livre discutant des problèmes. L’étude University Group Diabetes Project (UGDP) avait été réalisée indépendamment de l’industrie pharmaceutique et elle avait fait l’objet de nombreux débats et été réanalysée par plusieurs autres groupes que ceux qui avaient mené l’étude. Je n’avais aucun doute en ce qui concerne qui avait raison.
La tolbutamide réduit le glucose sanguin, mais il s’agit là d’un résultat de substitution. On ne traite pas les patients pour réduire leur glucose sanguin ; on les traite pour prévenir les complications du diabète, les cardiaques plus particulièrement. Je tenais donc pour absurde, et je le pense toujours, que des gens utilisent ce médicament alors que la seule recherche étudiant les complications cardiovasculaires avait été interrompue parce que le médicament tuait les patients. Il était particulièrement convaincant de constater que les patients les plus respectueux du traitement au tolbutamide présentaient des taux de mortalité plus élevés que ceux des moins respectueux97, parce que les patients qui font ce qu’on leur dit de faire sont habituellement en meilleure santé que les autres et ont une meilleure survie même quand le médicament est un placebo. L’étude d’un produit réduisant les lipides, le clofibrate, avait démontré cela98. Il n’y avait pas de différence sur le plan de la mortalité entre le médicament et le placebo mais parmi ceux qui avaient pris plus de 80 % du médicament, seuls 15 % sont décédés par comparaison à 25 % parmi les autres (P = 0,0001). Cela ne prouve pas que le médicament est efficace, bien sûr, et la même différence a été constatée dans le groupe recevant le placebo, 15 % versus 28%(P=5xl016).
Upjohn, le fabricant du tolbutamide, lança une campagne agressive pour discréditer les résultats de l’étude UGDP en faisant appel à des universitaires renommés et grassement payés et les arguments devinrent progressivement ad hominem ». Des poursuites ont été entamées par la compagnie pour empêcher la FDA de mentionner les résultats de l’étude dans les feuillets accompagnant le médicament et la FDA se trouva même forcée de faire une enquête qui conclut que les données de l’étude n’avaient pas été falsifiées97 !
L’utilisation du tolbutamide aurait dû être arrêtée par le retrait du médicament du marché, au moins temporairement, pendant que ceux qui étaient sceptiques au regard des résultats de l’étude réaliseraient une autre étude. Mais la FDA ne l’a jamais exigé d’Upjohn et cela n’a jamais été fait.
Personne ne semble disposé à apprendre quoi que ce soit – ou au moins pas beaucoup – sur l’historique quand il s’agit de la régulation des médicaments. L’histoire se répète sans cesse. Pendant les 40 années qui ont suivi l’étude UGDP, l’industrie a tout simplement arrêté de faire des études qui auraient pu révéler que ses médicaments contre le diabète augmentent les événements cardiaques et nos régulateurs de médicaments la laissent s’en tirer99, ce qui est passablement scandaleux. La rosiglitazone est un exemple récent de médicament pour le diabète autorisé sur la foi de son effet sur le glucose sanguin, mais il s’agit aussi d’un médicament qui augmente les complications cardiovasculaires qu’il est censé prévenir, et qui a été retiré du marché européen en 2010 après avoir fait mourir des milliers de patients (voir le chapitre 16).
Des histoires s’appliquant à d’autres domaines de la thérapeutique existent100. Une étude de la suppression de l’arythmie cardiaque (CAST) a dû être arrêtée avant terme parce que les deux médicaments actifs, l’encaïnide et le flécaïnide, entraînaient le décès des patients. À l’origine, cette étude avait été conçue pour être unilatérale, ce qui signifie que le médicament ne peut être que neutre ou bénéfique, vu que les cardiologues ne pouvaient imaginer que les traitements puissent être nuisibles101. Au sommet de leur utilisation à la fin des années 1980, les médicaments antiarythmiques provoquaient probablement 50 000 morts par an dans les seuls États-Unis, ce qui est du même ordre de grandeur que le nombre total des Américains qui ont péri pendant la guerre du Vietnam102. Ces médicaments étaient largement utilisés parce qu’ils avaient un effet sur un résultat de substitution, l’ECG et bien que la FDA eût de sérieuses inquiétudes pour sa sécurité, elle céda aux pressions des compagnies, ce qui, – d’une manière tout à fait prévisible ‑mena à ce que le médicament soit maintenant largement employé chez les bien-portants qui ont des troubles bénins du rythme qui en affectent plusieurs parmi nous.
Le réduction d’une tumeur est un autre résultat de substitution populaire et trompeur. L’intérêt primordial des patients atteints du cancer est de survivre, mais certains traitements qui réduisent les dimensions de la tumeur cancéreuse augmentent la mortalité, par exemple la radiothérapie chez les femmes qui ont eu un cancer diagnostiqué par dépistage103. On peut dire la même chose de plusieurs, sinon de la plupart des médicaments du cancer. De fortes doses peuvent avoir un meilleur effet sur le cancer, mais peuvent aussi tuer plus de patients. Quand la dose est assez élevée, tous les cancers sont détruits, mais il en va de même pour tous les patients. Cela démontre l’absurdité de ce résultat de substitution.
En 2008, la FDA a autorisé en accéléré le bevacizumab (Avastin) pour le traitement du cancer métastatique du sein, bien qu’il n’ait pas augmenté la survie, seulement la survie sans progression du cancer104. Ceci n’est pas qu’un résultat de substitution mais aussi un résultat porté au biais, puisqu’il est passablement subjectif de décider s’il y a eu progression. La FDA imposa à la compagnie de faire plus d’études, lesquelles ne montrèrent pas un effet sur la survie sans progression alors qu’elles mirent en évidence des effets nocifs graves y compris des décès. Trois ans plus tard, le médicament, qui coûte chaque année le prix de plusieurs voitures neuves, environ 88 000 dollars, a été abrogé pour le cancer du sein105.
L’absence de données adéquates sur la sécurité n’est pas acceptable
C’est une faillite majeure de la régulation du médicament quand des médicaments aux effets nocifs connus sont approuvés sans données adéquates sur leur sécurité. Les inhibiteurs des COX‑2 sont un exemple parfait, puisque leur mécanisme d’action prédisait une augmentation du risque de mortalité cardiovasculaire. Quand j’ai discuté de cela avec un régulateur de médicaments, il me répondit que s’ils exigeaient de telles données, cela retarderait pendant des années l’introduction de médicaments de valeur.
Je n’accepte pas cet argument. Une compagnie pharmaceutique pourrait réaliser facilement une grande étude de son inhibiteur COX‑2 qui pourrait révéler les risques et c’est la faute de l’industrie quand elle estime qu’elle peut s’en tirer en tournant les coins ronds. Si le rofecoxib (Vioxx) avait été étudié avec des populations pertinentes de patients, ses effets nocifs auraient été détectés très rapidement, puisque le nombre qu’il faut traiter pendant un an pour causer un infarctus additionnel n’est que de 70 patients19. Il y a aussi un problème éthique primordial qu’on ne peut écarter avec des revendications mesquines de considérations pratiques ni de perte potentielle de revenus. Malheureusement, les agences du médicament baissent les bras devant les arguments indéfendables de l’industrie.
Le Vioxx a été retiré en 2004 et le valdecoxib (Bextra) en 2005. Avant que le Bextra soit retiré du marché, neuf des dix conseillers de la FDA ayant des liens avec l’industrie ont voté pour qu’on le maintienne sur le marché106 !
En 2008, la FDA s’est demandée si, à l’avenir, elle devrait exiger des études post-marketing dotées de résultats pertinents comme la morbidité cardiovasculaire et la mortalité107. Toutefois, seulement le tiers de telles études ont été réalisées46, et la FDA est connue pour ne pas les exiger parce qu’elle ne dispose pas de l’autorité dans ce dessein22. Depuis 2007, le défaut de réaliser une étude post-marketing ou de faire un changement requis de l’étiquetage, peut entraîner une amende, mais pas plus de 10 millions de dollars54. Comme ce ne sont que des broutilles pour l’industrie, il s’agit là d’un écran de fumée ou d’un faux remède. Même quand les études ont été réalisées, elles pourraient montrer que le médicament a tué des milliers de patients, ce qu’on aurait pu éviter en exigeant les études pertinentes avant que les agences du médicament décident qu’un médicament est approuvé. Les études post-marketing sont donc une très mauvaise idée par comparaison avec le rejet d’une demande d’autorisation de mise en marché. On a besoin des données pertinentes pour tout nouveau médicament d’une classe thérapeutique, vu qu’un nouveau médicament pourrait tuer les gens même si dix médicaments semblables ne le font pas.
Un autre problème est que les études post-marketing qu’on requiert ne sont pas nécessairement des études randomisées mais peuvent n’être que des études d’observation qui sont très médiocres pour détecter les indices d’effets nocifs. Ceux qui sont traités diffèrent en plusieurs manières de ceux du groupe de comparaison qui ne sont pas traités et le doublement du taux des crises cardiaques parmi un groupe de personnes âgées peut s’expliquer simplement par le fait que ces patients sont plus portés à faire une crise cardiaque que d’autres patients. Les patients souffrant d’arthrite rhumatoïde sont plus portés à faire une crise cardiaque que les autres gens du même âge, ce qui rend difficile de voir si les inhibiteurs des COX‑2 causent leur décès.
Le signalement spontané des effets secondaires graves des médicaments en marché aux régulateurs est aussi une méthode faiblarde pour la détection des effets nocifs. En 2010, la FDA a averti Pfizer dans une lettre de 12 pages pour avoir failli de signaler promptement des effets secondaires graves et inattendus de ses médicaments, après qu’elle eut procédé à une inspection de six semaines des quartiers généraux de Pfizer108. Pfizer avait mal classifié ou réduit l’importance de signalements non sérieux, sans justification raisonnable et omis de soumettre des signalements de cécité causée par le Viagra (sildenafil) et des médicaments similaires à l’intérieur de l’intervalle de 15 jours déterminé par l’agence. Pfizer avait été mise en garde en 2009, mais la FDA nota que les délais de la compagnie pour signaler les effets nocifs à l’agence n’avaient qu’augmenté. On a dit à Pfizer qu’à défaut de corriger ces problèmes, des poursuites sans préavis pourraient être engagées et que des délais pourraient survenir dans l’approbation des médicaments de la compagnie en attente d’autorisation.
En 2012, Roche a été réprimandée par l’EMA pour n’avoir pas signalé 80 000 effets secondaires potentiellement néfastes de ses médicaments comprenant 15 161 décès survenus aux États-Unis109. Les régulateurs ont identifié d’autres déficiences liées à l’évaluation et au signalement aux agences nationales de la santé de réactions potentiellement néfastes chez 23 000 autres patients et 600 participants à des études cliniques.
TROP D’AVERTISSEMENTS ET TROP DE MÉDICAMENTS
Tous les médicaments comportent une longue liste d’avertissements, de contre-indications et de précautions, expliquant par exemple les types de patients, les maladies et les autres médicaments consommés par les patients qui pourraient rendre dangereuse la consommation de ce médicament. Il suffit de regarder la publicité d’un périodique médical pour voir à quel point cela peut être impressionnant ; on peut trouver plus de 20 avertissements pour un seul médicament. Voici un exemple.
Les statines
Certains de mes collègues sont obsédés par le cholestérol et croient que toute personne de plus de 50 ans devrait prendre une statine, peu importe leur niveau de cholestérol, puisqu’elle réduira leur risque de décès. Ils disent aussi que les statines n’ont pas d’effets secondaires dignes de mention, ou même qu’elles n’ont pas d’effets secondaires110. Examinons une publicité publiée dans les premières pages du JAMA du 19 septembre 2012. On pouvait lire :
« Essayez le LIVALO pour abaisser le LDL‑C et améliorer les autres paramètres des lipides ».
Ce n’est pas le motif pour lequel on pourrait envisager la possibilité de prendre une statine, n’est-ce pas ? On souhaiterait la prendre pour réduire le risque de mourir et non pour améliorer certaines valeurs de laboratoire. Peut-on être certain qu’une statine particulière réduit le risque de mourir ? Non, on ne le peut pas parce les statines sont approuvées selon leurs effets sur les lipides du sang. Le LIVALO pourrait réduire le risque de mourir de maladie cardiaque, mais il pourrait aussi augmenter le risque de périr d’autres causes, de sorte qu’on ne peut pas savoir ce que sont ses chances avec ou sans LIVALO.
Après la lecture des deux premières lignes de l’annonce, je dirais non merci. Il ne faut pas consommer des médicaments qui « sauvent la vie » sans savoir s’ils augmentent ou réduisent le risque de mourir.
Continuons. À la page 2 de la publicité, on lit :
« Le traitement médicamenteux devrait être une composante d’une intervention sur plusieurs facteurs de risque chez les personnes qui requièrent une modification de leur profil des lipides. Les produits réduisant les lipides devraient être utilisés en plus d’une diète comportant des restrictions des graisses saturées et du cholestérol quand la réponse à la diète et aux autres mesures non pharmacologiques se révèle insuffisante. »
Ah ! Ah ! Ce n’est pas ce que mes collègues bien intentionnés racontent quand ils sont à la veille de recommander qu’on mette des statines dans l’aqueduc. Je ne suis pas à la diète ni astreint à quelqu’autre « mesure non pharmacologique » (Qu’est-ce que cela pourrait bien être ?) et comment peut-on décider qu’il me faut modifier mon profil des lipides ? Peut-on voir à quel point tout cela est subjectif et combien est vaseux le langage régulatoire ?
Un peu plus loin arrive ce que je souhaitais savoir, mais curieusement sous une rubrique intitulée « Restrictions d’utilisation » :
Les doses de LIVALO excédant 4 mg par jour ont été associées à une augmentation du risque de maladie musculaire grave dans les études cliniques requises pour l’autorisation de mise en marché. Il ne faut pas dépasser la dose quotidienne de 4 mg de LIVALO.
L’effet du LIVALO sur la morbidité et la mortalité cardio-vasculaires n’a pas été déterminé.
Je le savais ! On n’a aucune idée si le LIVALO fait ce qu’on souhaite qu’il fasse. Et je cours le risque de lésions musculaires graves. Les gens absorbent et métabolisent les médicaments d’une manière différente et certains souffriront sans doute de lésions musculaires graves même sans jamais dépasser la dose de 4 mg par jour. Ce pourrait être moi. À ce moment-ci, mon interprétation libre du nom du médicament est FOUTEZ-MOI LA PAIX !
La première page de la publicité ne dit rien de l’avantage potentiel du médicament à part le titre sur les lipides qui n’est d’aucune utilité. Le reste de la page parle des effets nocifs sous la rubrique « Informations importantes pour la sécurité ». Mon scepticisme augmente :
« Des cas de maladie musculaire et de rhabdomyolyse avec insuffisance rénale aiguë par myoglobinurie ont été rapportés avec les inhibiteurs de la réductase HMG-CoA, incluant le LIVALO. » De tels effets augmentent avec la dose, avec l’âge (> 65 ans), avec une maladie rénale, avec l’hypothyroïdisme mal traité et en combinaison avec les fibrates ou les doses de niacine excédant 1 g. par jour.
Puis cela devient vraiment difficile. « Le traitement au LIVALO doit être arrêté quand les niveaux de CK augmentent de manière marquée ou qu’une maladie musculaire a été diagnostiquée ou soit soupçonnée » et « Prévenez les patients de signaler immédiatement toute douleur musculaire, sensibilité ou faiblesse, plus particulièrement quand ces souffrances sont accompagnées de malaises, de faiblesse ou de fièvre, et d’arrêter le médicament si ces signes ou symptômes apparaissent. »
Mon Dieu ! CK signifie créatinine kinase, une enzyme musculaire. Les patients traités aux statines ont souvent pareils symptômes111 (bien que la publicité dise à tort qu’ils sont rares), alors comment les patients pourraient-ils savoir quand il faut arrêter le LIVALO ?
On nous parle aussi des lésions au foie. Les enzymes du foie devraient être testés avant de commencer le traitement et quand des signes et des symptômes de lésions du foie apparaissent. Il semble un peu tard pour mesurer les enzymes du foie quand le foie est déjà blessé. « Il y a eu des signalements rares d’insuffisance hépatique fatale et non fatale chez des patients prenant des statines, y compris la pitavastatine. » Ce médicament pourrait me tuer.
Le LIVALO peut aussi augmenter le glucose sanguin ce qui augmentera mon risque de mourir de problèmes cardio-vasculaires, ce contre quoi LIVALO est censé me protéger.
Je m’arrête ici, mais il est important de comprendre que les médicaments ne sont jamais sécuritaires. Les vestes de flottaison sont toujours utiles à bord d’un bateau puisqu’elles peuvent sauver la vie. Elles ne tuent pas. Les médicaments ne sont pas comme cela. La consommation d’une statine peut réduire le risque de mourir d’une maladie cardiaque, mais aussi accroître le risque de périr de quelques autres causes. Pas beaucoup de médicaments mais une statine, la cerivastatine (Baycol), a été retirée du marché après que des patients furent décédés de lésions musculaires et d’insuffisance rénale.
Tout le monde doit tenir compte du pour et du contre lors de la consommation d’un médicament et son médecin n’est pas nécessairement la meilleure personne à interroger, parce la plupart des médecins se sont fait laver le cerveau et plusieurs ont été corrompus par l’industrie pharmaceutique. Quand on ne meurt pas d’une maladie cardiaque, on finit certainement par mourir d’autre chose. Un homme de 65 ans qui ne fume pas et dont la pression systolique est de 140 mm Hg et un cholestérol de 5mmol/L peut s’attendre à vivre trois mois de plus s’il consomme une statine pour le reste de ses jours112. Ce n’est pas beaucoup surtout quand ce bonus arrive au moment où le patient est dément et incontinent dans une pension médicalisée et aurait plutôt souhaité avoir un médicament qui abrège toute cette misère. Il faudrait aussi demander aux patients ce que sont leurs expériences. Un enquête menée auprès de plus de 10 000 personnes a trouvé que les effets musculaires étaient mentionnés par 60 % des anciens consommateurs et par 25 % de ceux qui prenaient le médicament110.
D’autres médicaments agissant sur les lipides sont aussi intéressants. On attendait un avantage de l’augmentation des lipoprotéines à haute densité avec un médicament qui faisait cela mais cela n’avait aucun effet sur la progression de l’athérosclérose coronarienne dans les études comptant environ 1000 patients107. Le nom chimique de ce médicament est le torcetrapib. Peut-on le prononcer et s’en rappeler ? Un motif expliquant que les noms chimiques inventés par les compagnies pharmaceutiques sont si fantaisistes est que les médecins se trouvent contraints d’utiliser le nom commercial et moins à même de prescrire un générique moins coûteux quand le brevet du médicament vient à échéance. Par chance, la compagnie a fait une grande étude comptant 15 000 patients et comme elle a montré que le médicament tuait les gens, le manufacturier a cessé de le mettre au point.
Un autre médicament modifiant les lipides, l’exetimibe, a été autorisé par la FDA en 2002 parce qu’il avait réduit le cholestérol à basse densité du sang de 15 %107. En 2007. les ventes de ce médicament ont atteint $5 milliards aux États-Unis, bien que personne ne sache si ce médicament est avantageux ou nuisible.
Les avertissements sont de fausses solutions
Il est impossible pour les cliniciens de savoir ce qu’ils devraient savoir à propos des médicaments pour les prescrire en toute sécurité et il n’est donc pas surprenant que les médecins puissent faire bien des erreurs médicales. Le problème fondamental est que les régulateurs prennent les médicaments un à un et se fichent de ce que les médecins ne peuvent pas bien connaître tous les avertissements concernant les médicaments qu’ils prescrivent. Ce qui compte pour les régulateurs c’est : ce n’est pas notre faute. On vous a prévenus n’est-ce pas ?
Tout médecin sait que l’anticoagulant warfarin peut interagir dangereusement avec d’autres médicaments et certains aliments, mais les médecins ne peuvent même pas utiliser ce médicament en sécurité. Dans une étude, 65 % des patients recevaient au moins un autre médicament capable d’augmenter le risque de saigner avec le warfarin, et dans une autre étude, environ le tiers des patients recevaient de tels médicaments13.
Le cisapride (Propulsid de Johnson & Johnson) était censé promouvoir la vidange gastrique, mais il n’est plus sur le marché parce qu’il cause des arythmies cardiaques qui tuent les gens. En 1998, la FDA a alerté à propos des contre-indications pour ce médicament avec des additions à l’étiquette en encadré noir et les praticiens ont été avertis au moyen d’une lettre expédiée par le manufacturier. Ces avertissements n’eurent pratiquement pas d’effets114. Au cours de l’année précédant l’action régulatoire, l’utilisation du cisapride était contre-indiquée pour 26 %, 30 % et 60 % des utilisateurs dans trois sites d’étude et pendant l’année suivant l’action régulatoire, l’utilisation était contre-indiquée chez 24 %, 28 % et 58 % des utilisateurs. Johnson & Johnson a vendu le médicament pour plus d’un milliard de dollars chaque année, bien qu’il n’aurait jamais dû être approuvé. Quand la FDA convoqua une réunion publique en 2000, un cadre de la compagnie reconnut qu’on n’avait pas pu montrer que le médicament est efficace85. Une fois encore, l’insuffisance régulatrice allait résulter en tragédies pour des gens bien réels115 :
Vanessa était une fille bien portante. Elle ne buvait pas, ne fumait pas, ni ne prenait des médicaments – avec une exception : au cours de la dernière année, elle avait pris périodiquement du cisapride, un médicament pour traiter les régurgitations acides, mis en marché sous le nom de Prepulsid. Son médecin, qui lui avait diagnostiqué une forme légère de boulimie, l’avait prescrit après quelle se soit plaint de régurgitations et de ballonnements après les repas. Ni leur médecin ni le pharmacien n’ont mentionné les risques. Le 19 mars 2000, son père a vu sa fille de 15 ans choir sur le plancher à domicile. « On l’a amenée rapidement à l’hôpital où elle décéda le jour suivant. La cause du décès : arrêt cardiaque. Cinq mois plus tard, le médicament fut retiré du marché mais il était trop tard pour Vanessa.
À cause de la perte de sa fille, son père se lança en politique et fut élu au Parlement du Canada parce qu’il souhaitait changer la régulation des médicaments. Il était pétri d’incrédulité que les médicaments ordonnancés ne soient pas plus rigoureusement réglementés que les autres menaces pour la sécurité publique : « Le ministre des transports ne négocie pas avec les camionneurs pour retirer les véhicules dangereux de la voie publique », dit-il. En vertu de la loi, les médecins doivent signaler ceux dont la conduite est inacceptable et on les paie pour ce faire. Autoriser d’une manière accélérée l’accès au marché des médicaments est comme ordonner aux aiguilleurs du ciel de faire atterrir les avions plus rapidement. Onze ans après l’enquête sur le décès de sa fille, aucune de ses principales recommandations de réforme n’avait été mise en place.
On a accès à des milliers de médicaments et je me demande pourquoi personne n’a jamais évalué si la disponibilité d’autant de médicaments fait plus de tort que de bien. Je suis certain que c’est bien le cas. Sinon, les médicaments ne seraient pas la troisième principale cause de mortalité.
Les médecins ne peuvent pas connaître tous les dangers mais les patients le peuvent. Ils peuvent lire les encarts des emballages attentivement et cesser de consommer le médicament s’ils pensent qu’ils est trop dangereux pour eux. J’espère aussi que le présent livre contribuera à soulever l’indignation de tant de citoyens qu’ils protesteront et manifesteront tant qu’il le faudra pour contraindre les politiciens à instaurer les réformes qui sont nécessaires.
On en sait bien peu au sujet de la polypharmacie
La plupart des patients sont en traitement avec plusieurs médicaments, particulièrement, les plus âgés. Une étude suédoise de 762 personnes vivant dans des maisons de retraite a trouvé que 67% s’étaient fait prescrire 10 médicaments et plus116. Un tiers était traité avec trois médicaments psychoactifs ou plus ; près de la moitié recevait des antidépresseurs ou des tranquillisants ; enfin des médicaments anticholinergiques (par exemple pour incontinence urinaire) étaient utilisés pour le cinquième. Tous ces médicaments sont capables de détraquer la fonction cognitive, de provoquer de la confusion et des chutes, ce qui entraîne une mortalité élevée chez les aînés. Les symptômes sont souvent mal interprétés par les patients et les gens qui s’en occupent passent pour des signes du vieillissement ou d’une maladie imminente, par exemple la démence ou la maladie de Parkinson. Or, quand les médecins arrêtent les médicaments, plusieurs patients rajeunissent de plusieurs années, laissent tomber le déambulateur qu’on leur avait donné parce qu’ils ne pouvaient plus maintenir leur équilibre et deviennent à nouveau actifs. Une étude américaine a trouvé que près de 18 % des patients de Medicare consommaient des médicaments qui n’étaient pas sécuritaires pour les gens âgés85.
Comme pour les régulateurs, les médecins voient un problème à la fois et commencent habituellement un traitement médicamenteux chaque fois. Ils oublient souvent d’arrêter un médicament quand il n’est plus requis. Ma plus importante contribution à la médecine interne a été d’arrêter les médicaments chez les patients nouvellement admis, pour m’apercevoir que, très souvent, les patients revenaient intoxiqués avec les mêmes médicaments que leur médecin leur avait prescrits, à leur prochaine admission à l’hôpital. C’est certainement un long combat à contre-courant.
Bien qu’on ne sache que peu de choses sur ce qui arrive quand les patients prennent plusieurs médicaments, on en sait assez pour agir. Chaque médicament peut affecter plusieurs fonctions du corps en plus de celle qui est visée et l’ensemble des médicaments peuvent interagir de manières imprévisibles. On sait aussi que les aînés sont souvent surtraités, avec des conséquences nuisibles. Une étude randomisée a montré que la réduction des médicaments abaissait tant la mortalité que l’admission à l’hôpital et une étude subséquente chez 70 patients dont le nombre des médicaments avait été réduit de 7,7 à 4,4 par patient a montré que 88 % avaient connu une amélioration globale de leur santé et la plupart ont eu une amélioration de leurs fonctions cognitives117. Voici une histoire typique, à part le fait que peu d’aînés sont aussi chanceux118 :
À l’âge de 88 ans, mon père fut admis à l’hôpital pour étourdissements, lesquels étaient apparus après qu’on eut augmenté la dose de ses médicaments. À l’hôpital, on lui donna plus de médicaments ce qui le rendit confus, effrayé et incohérent. C’est alors que son médecin le transféra dans une maison de retraite, où il était sale, il pleurnichait et demandait aux gens de lui tenir la main. 11 était identifié comme NPR (ne pas ressusciter) – et encore plus médicamenté.
J’ai persuadé le médecin de la maison de retraite d’interrompre toute médication et j’ai engagé une infirmière privée pour donner à mon père, une diète organique – riche en fruits, légumes, grains, fèves, noix et graines. En trois jours mon père récupéra si miraculeusement, que les infirmières du département ne le reconnaissaient plus. Quand j’appelai pour lui parler, mon père était redevenu lui-même et il me dit qu’il s’embêtait et espérait jouer aux cartes. Mon père fut congédié le jour suivant et mourut plusieurs années plus tard, dans la paix de son domicile.
Voici une autre histoire, celle d’une femme qui avait 88 ans elle aussi. Elle fut admise à l’hôpital après un épisode de diarrhée et d’étourdissements119. Sa famille a été rapidement frappée par la rapide détérioration de sa santé et l’apparition de nouveaux symptômes étranges, comprenant des idées délirantes et l’impossibilité de la réveiller. On s’aperçut qu’elle prenait plusieurs nouveaux médicaments dont un analgésique et un antidépresseur, alors qu’elle n’était pas déprimée mais pleurant avec raison la perte de sa vie antérieure, puisqu’elle se trouvait coincée dans une chambre d’hôpital. Au même moment, un psychiatre diagnostiqua la maladie d’Alzheimer et suggéra qu’elle prenne du donezepil (Aricept). Sa bru refusa cela et lui enleva plusieurs médicaments, ce qui eut un effet spectaculaire. Elle redevint elle-même à nouveau. Cette expérience transforma la bru en militante pour les patients : « Je regardais tous les autres pensionnaires dans les établissements de soins de longue durée, où les membres de la famille ne connaissaient pas les problèmes ou ne souhaitaient pas faire de vagues et je me dis : « Qui prendra la défense de ces gens ? »
La médecine moderne ne fonctionne pas bien pour les personnes âgées. Tout clinicien a vu l’octogénaire médicalisé et obsédé par l’arthrite, la maladie d’Alzheimer et les niveaux de son cholestérol sanguin. Comparons ce patient avec quelqu’un d’autre dont la condition physique est semblable qui reconnaît que ses genoux sont en piteux état et qui a du mal à se souvenir de certaines choses. Lequel des deux patients est le mieux portant120 ?
Peter Gøtzsche
https://twitter.com/PGtzsche1?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
Notes du CHAPITRE 10 :
- Mundy A. Dispensing With the Truth : The Victims, the Drug Companies, and the Dramatic Story Behind the Battle over Fen-Phen (Dispenser la vérité : les victimes, les compagnies pharmaceutiques et l’histoire dramatique derrière la bataille de Fen-Phen). New York : St. Martin’s Press, 2001.
https://www.amazon.fr/Dispensing–Truth–Companies–Dramatic–Fen–Phen/dp/0312253249
<
- Angell M. The Truth about the Drug Companies : how they deceive us and what to do about it. (La vérité sur les compagnies pharmaceutiques : comment elles nous trompent et que faire à ce sujet) New York : Random House, 2004.
https://www.amazon.fr/Truth–About–Drug–Companies–Deceive/dp/0375760946

- Day M. Don’t blame it all on the bogey. BMJ, 2007 ; 334:1250–1251.
https://www.bmj.com/content/334/7606/1250 - Bailey R.S. FDA corruption charges letter verified. The Los Angeles Post, 8 avril 2012.
- Tanne J.H. Investigators to review conflicts of interest at NIH (Les enquêteurs examineront les conflits d’intérêts au NIH). BMJ, 2007 ; 334 : 767.
https://www.bmj.com/content/334/7597/767.2 - Tanne J.H. Former FDA head is fined $90 000 for failing to disclose conflicts of interest (L’ancien commissaire de la FDA est condamné à une amende de 90 000 $ pour avoir omis de divulguer des conflits d’intérêts). BMJ, 2007 ; 334 : 492.
https://ur.booksc.eu/book/48355848/fad7e5 - Andersen N.A., et Drachmann H. [Psychiatrist gets millions]. Politiken,5 décembre 2003.
- Braithwaite J, Corporate Crime in the Pharmaceutical industry (Crime d’entreprise dans l’industrie pharmaceutique). London : Routledge & Kegan Paul, 1984.
• https://www.amazon.fr/Corporate–Crime–Pharmaceutical–Industry–Braithwaite/dp/0710200498

• http://johnbraithwaite.com/wp–content/uploads/2016/06/Corporate–Crime–in–the–Pharmac.pdf - Blowing the whistle on the FDA (Coup de sifflet contre la FDA) : an interview with David Graham. Multinational Monitor, 2004 ; 25 (12).
https://multinationalmonitor.org/mm2004/122004/interview–graham.html - Lenzer J. Crisis deepens at the US Food and Drug Administration (La crise s’aggrave à la Food and Drug Administration des États-Unis). BMJ, 2004 ; 329:1308.
https://www.bmj.com/content/329/7478/1308.1.full - Moynihan R., et Cassels A. Seiling Sickness : how the world’s biggest pharmaceutical companies are turning us ail into patients (Vendre la maladie : comment les plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde nous transforment tous en patients). New York : Nation Books, 2005.
https://www.amazon.fr/Selling–Sickness–Pharmaceutical–Companies–Patients/dp/1560256974

- Ross D.B. The FDA and the case of Ketek (La FDA et le cas Ketek (télithromycine)). N Engl J Med, 2007 ; 356 : 1601–1604.
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMp078032 - Baciu A., Stratton K., et Burke S.P. (éd.). The Future of Drug Safety : promoting and protecting the health of the public (L’avenir de la sécurité des médicaments, Promouvoir et protéger la santé du public). Washington, DC : National Academic Press, 2006.
https://www.nap.edu/catalog/11750/the–future–of–drug–safety–promoting–and–protecting–the–health - Smith S,W. Sidelining safety – the FDA’s inadequate response to the IOM (Mise à l’écart de la sécurité – La réponse inadéquate de la FDA à l’IOM, l’Institute of Medicine). New Engl J Med, 2007 ; 357 : 960–963.
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp078157 - Willman D. How a new policy led to seven deadly drugs (Comment une nouvelle politique [de la FDA] a conduit à sept drogues mortelles). Los Angeles Times, 20 décembre 2000.
https://www.latimes.com/nation/la–122001fda–story.html - Abraham J. Science, Politics, and the Pharmaceutical Industry : Controversy and Bias in Drug Regulation (Science, politique et industrie pharmaceutique : controverse et biais dans la réglementation des médicaments). London : UCL Press, 1995.
https://www.cambridge.org/core/journals/politics-and-the-life-sciences/article/abs/science-politics-and-the-pharmaceutical-industry-controversy-and-bias-in-drug-regulation-john-abraham-new-york-st-martins-press-1995–308-pp-us4995-cloth-isbn-0312128738-st-martins-press-175-fifth-ave-room-1715-new-york-ny-10010-usa/FEFACD96EF3EC26BA6297C4B54FF8002#https://www.amazon.fr/Science–Politics–Pharmaceutical–Industry–Controversy/dp/0312128738 - House of Commons Health Committee. The Influence ofthe Pharmaceutical Industry. Fourth Report of Session 2004-05 (Commission de la santé de la Chambre des communes. L’influence de l’industrie pharmaceutique. Quatrième rapport de la session 2004-05). [En ligne]
https://publications.parliament.uk/pa/cm200405/cmselect/cmhealth/42/42.pdf (consulté le 26 avril 2005). - Graham D.J. COX‑2 inhibitors, other NSAIDs, and cardiovascular risk : the seduction of common sense (Inhibiteurs de la COX‑2, autres AINS et risque cardiovasculaire. La séduction du bon sens). JAMA, 2006 ; 296 : 1653–1656.
https://jamanetwork.com/journals/jama/article–abstract/203465 - Jüni P, Nartey L., Reichenbach S., et autres. Risk of cardiovascular events and rofecoxib : cumulative meta-analysis (Risque d’événements cardiovasculaires et rofecoxib : méta-analyse cumulative). Lancet, 2004 ; 364 : 2021–2029.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(04)17514–4/fulltext - Garattini S. Confidentiality (Confidentialité). Lancet, 2003 ; 362:1078–1079.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(03)14424–8/fulltext - Union of Concerned Scientists. FDA Scientists Pressured to Exclude, Alter Findings ; scientists fear retaliation for voicing safety concerns (Des scientifiques de la FDA contraints d’exclure et de modifier les résultats ; les scientifiques craignent des représailles pour avoir exprimé des préoccupations en matière de sécurité), 20 juillet 2006.
https://scienceblogs.com/grrlscientist/2006/07/20/fda–scientists–pressure–to–exc - Psaty B.M., et Burke S.P. Protecting the Health of the Public — Institute of Medicine Recommendations on Drug Safety (Protéger la santé du public — Recommandations de l’Institut de Médecine sur l’innocuité des médicaments). N Engl J Med, 2006;355:1753–1755.
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMp068228 - Anonyme. Institute of Medicine urges reforms at FDA (L’Institut de médecine appelle à des réformes à la FDA). Lancet, 2006 ; 368:1211.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(06)69493–2/fulltext - Strom B.L. How the US drug safety System should be changed (Comment le système américain de sécurité des médicaments devrait être modifié). JAMA, 2006 ; 295:2072–2075.
https://jamanetwork.com/journals/jama/article–abstract/202771 - Abramson J. Overdo$ed America : the broken promise of American medicine (L’Amérique en overdo$e : la promesse brisée de la médecine américaine), New York : Harper Collins, 2004.
https://www.amazon.com/Overdosed–America–Promise–American–Medicine/dp/0061344761

- United States General Accounting Office. Food and Drug Administration : effect of user fees on drug approval times, withdrawals, and other agency activities (FDA : effet des frais d’utilisation sur les délais d’approbation des médicaments, les retraits et les autres activités de l’agence), septembre 2002.
https://www.gao.gov/products/gao-02–958 - Reuters. Danish drugmaker Lundbeck A/S and Japanese partner Takeda Pharmaceutical Co have submitted a new antidepressant for regulatory approval in the United States (Le fabricant danois de médicaments Lundbeck A/S et son partenaire japonais Takeda Pharmaceutical Co ont soumis un nouvel antidépresseur à l’approbation des autorités américaines), 2 octobre 2012.
https://www.reuters.com/article/us–lundbeck–us–idUSBRE89105720121002 - Avorn J., et Shrank W. Highlights and a hidden hazard – the FDA’s new labeling régulations (Faits saillants et un danger caché – Le nouveau règlement d’étiquetage de la FDA). NEnglJMed, 2006 ; 354 : 2409–2411.
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMp068119 - Letter from FDA scientists to Président Barack Obama (Lettre de scientifiques de la FDA au Président Barack Obama). 2 avril 2009.
[En ligne] http://gaia-health.com/articles201/000201–letter.pdf (consulté le 11 novembre 2012).
https://www.finance.senate.gov/imo/media/doc/prg040209a.pdf - Lichtblau E., et Shane S. Vast FDA effort tracked e‑mails of its scientists (De vastes efforts de la FDA [pour espionner ses opposants] ont suivi les e‑mails de ses scientifiques). New York Times, 2012 juillet 14.
https://www.nytimes.com/2012/07/15/us/fda–surveillance–of–scientists–spread–to–outside–critics.html - Rosenberg M. Former FDA reviewer speaks out about intimidation, retaliation and marginalizing of safety (Un ancien examinateur de la FDA s’exprime sur l’intimidation, les représailles et la marginalisation de la sécurité). Truthout, 2012 juillet 29.
https://truthout.org/articles/former–fda–reviewer–speaks–out–about–intimidation–retaliation–and–marginalizing–of–safety/ - Brynner R., et Stephens T. Dark Remedy : the impact of thalidamide and its revival as a vital medicine (Sombre remède : l’impact de la thalidamide et sa renaissance en tant que médicament vital). New York : Perseus Publishing, 2001.
https://www.amazon.com/Dark–Remedy–Thalidomide–Revival–Medicine/dp/0738205907

- Brody H. Hooked : ethics, the médical profession, and the pharmaceutical industry (Hooked : l’éthique, la profession médicale et l’industrie pharmaceutique). Lanham : Rowman & Littlefield, 2008.
https://www.amazon.com/Hooked–Medical–Profession–Pharmaceutical–Industry/dp/0742552187

- Sibbison J.B. USA : dirty work in the drug industry (USA : Sale boulot dans l’industrie pharmaceutique). Lancet, 1991 ; 337 : 227.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PII0140-6736(91)92177–4/fulltext - Wikipedia. Duilio Poggiolini.
[En ligne] http://en.wikipedia.org/wiki/Duilio_ Poggiolini (consulté le 10 novembre 2012). - Abbott A. Italian health sector in disarray following more scandals (Le secteur de la santé italien dans le désarroi après de nouveaux scandales). Nature, 1993;364:663,
https://www.nature.com/articles/364663a0
https://www.nature.com/articles/364663a0.pdf - Medawar G, et Hardon A. Medicines out of control ? Antidepressants and the conspiracy of good-will Netherlands : Aksant Académie Publishers, 2004.
https://www.amazon.fr/Medicines–Out–Control–Antidepressants–Conspiracy/dp/9052601348

- Day M. Italian police arrest drug officials over alleged falsification of data (La police italienne arrête des responsables de l’agence des médicaments pour falsification présumée de données). BMJ, 2008;336:1208–1209.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC2405838/ - Pfizer memoranda, 24 et 26 avril 1989.
- Grill M. Kranke Geschäfte : wie die Pharmaindustrie uns manipuliert (Les affaires malades : comment l’industrie pharmaceutique nous manipule). Hamburg : Rowohlt Verlag, 2007.
https://www.amazon.fr/Kranke-Gesch%C3%A4fte-Wie-Pharmaindustrie-manipuliert/dp/3498025090

- Relman A.S., et Angell M. America’s other drug problem : how the drug industry distorts medicine and politics (L’autre problème des médicaments aux États-Unis : comment l’industrie pharmaceutique déforme la médecine et la politique>. The New Republic, 16 décembre 2002 : 27–41.
https://facultystaff.richmond.edu/~bmayes/pdf/relmanangell_Rxdrugs.pdf - Ismail M. Drug Lobby Second to None : how the pharmaceutical industry gets its way in Washington(Lobby des médicaments sans égal : Comment l’industrie pharmaceutique réussit à Washington). The Center for Public Integrity, 7 juillet 2005.
https://publicintegrity.org/health/drug–lobby–second–to–none/ - Bass A. Side Effects – a prosecutor, a whistleblower, and a bestselling antidepressant on trial (Effets secondaires – un procureur, un dénonciateur et un antidépresseur à succès en procès.). Chapel Hill : Algonquin Books, 2008.
https://www.amazon.fr/Side–Effects–Whistleblower–Bestselling–Antidepressant/dp/1565125533

- Gøtzsche P.C., et Jørgensen A.W, Opening up data at the European Medicines Agency ([Nécessaire mais interdite] Ouverture des données à l’Agence européenne des médicaments). BMJ, 2011 ; 342 : d2686.
https://www.bmj.com/content/342/bmj.d2686.full - Anonyme. FDA more transparent than EMEA. Prescrire International, 2002 ; 11:98.
- Garattini S‑, et Bertele V. How can we regulate medicines better ? BMJ, 2007 ; 335:803–805.
- Kranish M. Drug industry costs doctor top FDA post. Boston Globe, 27 mai 2002.
- GooznerM. The $800 Million Pill : the truth behind the cost of new drugs. Berkeley : University of California Press, 2005-
- McClellan M.B. Speech before First International Colloquium on Generic Medicine.
[En ligne] www.fda.gov/oc/speeches/2003/genericdrug0925.html (consulté le 18 février 2008). - Carpenter D., Zucker B.J., et Avorn J. Drug-review deadlines and safety problems. NEnglJMed, 2008 ; 358:1354–1361.
- Carpenter D. Drug-review deadlines and safety problems (authors’ reply). NEngl JMed, 2008;359:96–98.
- Moore T.J., Cohen MR., et Furberg CD. Serious adverse drug events reported to the Food and Drug Administration, 1998–2005. Arch ïntern Med, 2007 ; 167 : 1752–1759.
- Lexchin J. New drugs and safety : what happened to new active substances approved in Canada between 1995 and 2010 ? Arch Intern Med, 8 octobre 2012 : 1–2.
- Avorn J. Paying for drug approvals – who’s using whom ? N Engl J Med, 2007 ; 356:1697–1700.
- Psaty B.M., et Korn D. Congress responds to the IOM drug safety report – in full. JAMA, 2007 ; 298 : 2185–2187.
- Harris G., et Halbfinger D.M. FDA reveals it fell to a push by lawmakers. New York Times, 25 septembre 2009.
- Dhruva S.S., Bero L.A., et Redberg R.F. Strength of study evidence examined by the FDA in premarket approval of cardiovascular devices. JAMA, 2009 ; 302 : 2679–2685.
- Van Brabandt H., Neyt M., et Hulstaert F. Transcatheter aortic valve implantation (TAVI) : risky and costly. BMJ, 2012 ; 345 : e4710.
- Collier J, Big pharma and the UK government. Lancet, 2006 ; 367 : 97–98,
- Lee K., Bacchetti P., et Sim I. Publication of clinical trials supporting successful new drug applications : a literature analysis. PLoS Med, 2008 ; 5 : el91.
- European Commission. Strategy to Better Protect Public Health by Strengthening and Rationalising EU Pharmacovigiîance, 5 décembre 2007.
- FLAI Europe. Pharmacovigilance in Europe and Patient Safety ; no to deregulation. Press release, 1er février 2008.
- Larsen H., et Nyborg S. [The drug industry asks for control], Politiken, 5 mars 2006.
- [Committee on Scientific Dishonesty tamed]. Ugeskr Laeger, 2005 ; 167 : 3476–3477.
- Greene J.A., Choudhry N.K., Kesselheim A.S., et autres, Changes in direct-to-consumer pharmaceutical advertising following shifts from prescription-only to over-the-counter status. JAMA, 2012 ; 308 : 973–975.
- Welch H.G. Shouldlhe Tested for Cancer ? Maybe not and here’s why. Berkeley : University of California Press, 2004.
- Welch H.G., SchwartzL.,et WoloshinS. Overdiagnosed : makingpeople sick in the pursuit of health. Boston, MA : Beacon Press, 2011.
- Andersen N.V. [Drug giant uses American pressure in Danish drug case]. Politiken, 31 août 2004.
- Amendment to the Federal Food, Drug and Cosmetic Act. Washington, DC : 4 janvier 2007.
[En ligne] www.fda.gov/oc/initiatives/HR3580.pdf (consulté le 8 juillet 2008). - Moore T. J., et Furberg CD. The safety risks of innovation : the FDA’s Expedited Drug Development Pathway. JAMA, 2012 ; 308 : 869–870.
- Jefïerson T., Jones M.A., Doshi P., et autres. Neuraminidase inhibitors for preventing and treating influenza in healthy adults and children. Cochrane Database Syst Rev, 2012 ; 1 : CD008965.
- Motet B. Contracts keep drug research out of reach. New York Times, 29 novembre 2004.
- Lurie P., et Wolfe S.M. Misleading data analyses in salmeterol (SMART) study. Lancet, 2005 ; 366:1261–1262.
- Rickard K.A. Misleading data analyses in salmeterol (SMART) study – GlaxoS-mithKline’s reply. Lancet, 2005 ; 366:1262.
- Castle W., Fuller R„ Hall J., et autres. Serevent nationwide surveillance study : comparison of salmeterol with salbutamol in asthmatic patients who require regular bronchodilator treatment. BMJ, 1993 ; 306:1034–1037.
- Salpeter S.R., Buckley N.S., Ormiston T.M., et autres. Meta-analysis : effect of long-acting beta-agonists on severe asthma exacerbations and asthma-related deaths. Ann Intern Med, 2006 ; 144 : 904–912.
- FDA Drug Safety Communication : new safety requirements for long-acting inhaled asthma médications called Long-Acting Beta-Agonists (LABAs), 18 février 2010.
[En ligne] www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/PostmarketDrugSafetyInformationforPatientsandProviders/ ucm200776.htm (consulté le 8 octobre 2012). - Nelson H.S., Weiss S.T., Bleecker E.R., et autres. The Salmeterol Multicenter Asthma Research Trial : a comparison of usual pharmacotherapy for asthma or usual pharmacotherapy plus salmeterol. Chest, 2006 ; 129 : 15–26.
- Curfman G.D., Morrissey S., et Drazen J.M. Products at risk. N Engl J Med, 2010 ; 363:1763.
- Harris G. Pfizer says internal studies show no Celebrex risks. New York Times, 5 février 2005.
- Caldwell B.,Aldington S., Weatherall M.,et autres. Risk of cardiovascular events and celecoxib : a systematic review and meta-analysis. J R Soc Med, 2006 ; 99 : 132–140.
- Sherman M., et Marchione M. Pfizer : Celebrex raises heart attack risk. ABC News, 17 décembre 2004.
- Avorn J. Powerful Medicines : the benefits, risks, and costs of prescription drugs. New York : Vintage Books, 2005.
- Avorn J. Dangerous deception – hiding the evidence of adverse drug effects. NEnglJMed, 2006 ; 355 : 2169–2171.
- Petersen M. Our Daily Meds. New York : Sarah Crichton Books, 2008.
- Whitaker R. Anatomy of an Epidemic. New York : Broadway Paperbacks, 2010.
- Smith S.M., Schroeder K., et Fahey T. Over-the-counter (OTC) médications for acute cough in children and adults in ambulatory settings. Cochrane Database Syst Rev, 2012 ; 8 : CD001831.
- Tomerak A.A.T., Vyas H.H.V., Lakhanpaul M., et autres. Inhaled beta2-agonists for non-specific chronic cough in children. Cochrane Database Syst Rev, 2005 ; 3:CD005373.
- Glintborg D. [Cough medicines for acute respiratory infections, what is the evidence ?] Rationel Farmakoterapi, 4 janvier 2003.
- Sharfstein J.M., North M., et Serwint J.R. Over the counter but no longer under the radar – pediatric cough and cold médications. N Engl J Med, 2007 ; 357 : 2321–2324.
- Public Health Advisory : FDA Recommends that Over-the-Counter (OTC) Cough and Cold Products not he used for Infants and Children under 2 Years of Age, 23 février 2011.
- Parvez L., Vaidya M., Sakhardande A., et autres. Evaluation of antitussive agents in man. Pulm Pharmacol, 1996 ; 9 : 299–308.
- Goodyear M.D., Lemmens T., Sprumont D., et autres. Does the FDA have the authority to trump the Declaration of Helsinki ? BMJ, 2009 ; 338 : bl559.
- Wikipedia. Tuskegee syphilis experiment.
[En ligne] http://en.wikipedia.org/ wiki/Tuskegee__syphilis_experiment (consulté le 21 janvier 2010). - Boseley S., et Smith D. As doctors fought to save lives, Pfizer flew in drug trial team. The Guardian, 9 décembre 2010.
- Smith D. Pfizer pays out to Nigerian families of meningitis drug trial victims. The Guardian, 12 août 2011.
- Chalmers T.C., Frank C.S., et Reitman D. Minimizing the three stages of publication bias. JAMA, 1990 ; 263 : 1392–1395.
- The Coronary Drug Project Research Group. Influence of adherence to treatment and response of cholesterol on mortality in the coronary drug project. N Engl JMed, 1980 ; 303 : 1038–1041.
- Nissen S.E. Cardiovascular effects of diabetes drugs : emerging from the dark ages. Ann Intern Med, 2012 ; 157 : 671–672.
- Gøtzsche P.C., Liberati A., Luca P., et autres. Beware of surrogate outcome measures. Int J Technol Ass Health Care, 1996 ; 12 : 238–246.
- Pocock S.J. When to stop a clinical trial. BMJ, 1992 ; 305 : 235–240.
- Moore T. J. Deadly Medicine : why tens of thousands of heart patients died in America ‘s worst drug disaster. New York : Simon & Schuster, 1995.
- Gøtzsche P.C., et Jørgensen K.J. Screening for breast cancer with mammography. Cochrane Datahase Syst Rev, 2013 ; 6 : CD001877.
- DAgostino R.B. Sr. Changing end points in breast-cancer drug approval – the Avastin story. N Engl J Med, 2011 ; 365 : e2.
- Pollack A. FDA revokes approval of Avastatin for use as breast cancer drug. New York Times, 18 novembre 2011.
- Lenzer J. FDA is critkised for hinting it may loosen conflict of interest rules. BMJ, 2011 ; 343 : d5070.
- Psaty B.M., et Lumley T. Surrogate end points and FDA approval : a tale of 2 lipid-altering drugs. JAMA, 2008 ; 299 : 1474–1476.
- HeaveyS. FDA warns Pfizer for not reporting side effects. Reuters. 10juin2010.
- Wise J. European drug agency criticises Roche for failing to report adverse reactions and patient deaths. BMJ, 2012 ; 344 : e4344.
- McCartney M. Statins for all ? BMJ, 2012 ; 345 : e6044.
- Golomb B.A., Evans M.A., Dimsdale J.E., et autres. Effects of statins on energy and fatigue with exertion : results from a randomized controlled trial. Arch Intern Med, 2012 ; 172:1180–1182.
- Stovring H., Harmsen C.G., Wisbff T., et autres. A competing risk approach for the European Heart SCORE model based on cause-specifïc and ail-cause mortality. Eur J Prev Cardiol, 12 avril 2012.
- Hampton T. Flawed prescribing practices revealed. JAMA, 2006 ; 296 : 2191–2192.
- Smalley W., Shatin D., Wysowski D.K., et autres. Contraindicated use of dsa-pride : impact of food and drug administration regulatory action, JAMA, 2000 ; 284:3036–3039.
- Kingston A. A national embarrassment. Maclearis Magazine, 17 octobre 2012.
- Kragh A. [Two of three people in nursing homes are in treatment with at least ten drugs]. Läkartidningen, 2004 ; 101 : 994–999.
- Garfinkel D., et Mangin D. Feasibility study of a systematic approach for discontinuation of multiple médications in older adults : addressing polypharmacy. ArchlnternMed, 2010 \ 170 : 1648–1654.
- Mann H. Beware of polypharmacy in the elderly. BMJ, 8 mars 2009.
[En ligne] www.bmj.com/cgi/eletters/338/mar03_2/b873 (consulté le 12 mars 2009). - Moynihan R. Is your mum on drugs ? BMJ, 2011 ; 343 : d5184.
- Goodwin J.S. Geriatrics and the limits of modem medicine. N Engl J Med, 1999 ; 340 : 1283–1285.
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10159658918097317
Tweet correspondant à ce billet :
[Fausse pharmacovigilance, corruption des autorités, abus de pouvoir] L’impuissance de la régulation des médicaments, par Peter Gøtzschehttps://t.co/XzYjfSierg
— Étienne Chouard (@Etienne_Chouard) December 23, 2021
Telegram correspondant à ce billet :
https://t.me/chouard/375
[ESPOIR RIC] Clara Egger invitée chez Le Média pour Tous
Je vous conseille de passer 55 minutes très efficaces, instructives, avec Clara Egger pour bien comprendre comment instaurer la démocratie par le RIC 🙂 :
Je vous conseille aussi d’explorer le site qui présente ESPOIR RIC, il est très bien fait et très intéressant :
Pensez à vous abonner à la newsletter du blog du Plan C :
https://www.chouard.org/abonnement/
et aussi à vous abonner à la très précieuse Gazette des Amis du RIC :
https://convergence.ric-france.fr/la-gazette-des-amis-du-ric/numero‑7
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10159656632567317
Tweet correspondant à ce billet :
https://twitter.com/Etienne_Chouard/status/1473567558326435842
Post Telegram correspondant à ce billet :
https://t.me/chouard/373
Tuto pratique pour les politiciens : comment enfumer la population sur le RIC ?
Pierre-Alain de la chaîne YouTube suisse Démocratie d’abord offre (ironiquement) aux candidats à la présidentielle des astuces pour répondre à la demande de démocratie en ne s’engageant que sur un faux RIC ou de façon non-contraignante.
Faire un faux RIC :
1) Les citoyens n’ont pas l’initiative (00:43)
2) Pas nécessairement de référendum (02:03)
3) Conditions extrêmement strictes pour que la proposition soit soumise au référendum (02:23)
4) Exclusion de certains thèmes (02:55)
5) Conditions très strictes pour qu’une proposition soit adoptée en référendum (quorum) (03:19)
6) Délais (04:09)
7) Corriger ex-post les décisions populaires (pas de référendum obligatoire) (05:01)
Ne pas s’engager de façon contraignante :
1) Ne pas s’engager sur un texte précis d’instauration du RIC (07:39)
2) Noyer la promesse du RIC dans une multitude de promesses (08:18)
3) Ne pas s’engager sur un calendrier (08:44)
4) En tout cas, ne pas s’engager à fixer avant les législatives la date du référendum pour l’instauration du RIC (09:16)
Combiner les astuces (09:44)
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10159654182577317
Tweet correspondant à ce billet :
[amusant et efficace] Tuto pratique pour les politiciens :
comment enfumer la population sur le RIC ?https://t.co/oX3NnF98cv— Étienne Chouard (@Etienne_Chouard) December 20, 2021
Post Telegram correspondant à ce billet :
Le tuto format texte : Mode d’emploi pour mieux enfumer sur le RIC
Selon les sondages, une très large majorité des Français réclame l’instauration du référendum d’initiative citoyenne (RIC). Le peuple en a marre d’être placé hors-jeu entre deux élections et veut pouvoir décider directement par référendum sur les sujets de son choix. Les candidats à la présidentielle vont donc devoir répondre à cette demande de démocratie. Mais bien sûr ils ne le veulent pas, parce que cela réduirait leur propre pouvoir. Leur défi est donc de formuler une promesse de RIC qui semble répondre à ces aspirations, mais n’engage pas vraiment à grand-chose, et surtout pas à un véritable RIC. Cet article présente quelques astuces qui aideront ces candidats à mieux enfumer sur le RIC en s’engageant sur un RIC bidon ou de façon peu contraignante.
S’engager sur un RIC bidon
N’accordez pas l’initiative aux citoyens
- Parlez de référendums que vous organiserez vous-même en tant que président, mais pas de référendums initiés par des citoyens sur les sujets de leur choix.
– Si vraiment vous êtes poussés dans vos retranchements, impliquez les citoyens. Mais pas que les citoyens. Inspirez-vous du référendum d’initiative dite « partagée », qui est en fait d’initiative parlementaire même si elle doit être soutenue par des citoyens (ne commettez toutefois pas l’erreur grossière de la nommer « référendum d’initiative parlementaire »). Quand les gens vous entendront parler de récoltes de signatures, ils ne feront pas la distinction avec un véritable RIC d’initiative citoyenne. Proposez par exemple une amélioration du référendum d’initiative « partagée » en permettant aussi à des citoyens de prendre l’initiative. Tant que des signatures d’élus resteront nécessaires pour que la procédure aboutisse, les citoyens resteront sous le contrôle des élus. Heureusement, car des citoyens qui se nomment des représentants doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi.
Pas de référendum décisionnel
- La procédure ne doit pas conduire à un référendum. En tous cas pas automatiquement. Là encore, le référendum d’initiative « partagée » est exemplaire : il suffit que la proposition soit examinée par les deux assemblées, même si c’est juste pour la jeter à la poubelle, pour qu’il n’y ait pas de référendum. Non seulement cela permettra toujours d’éviter un référendum, mais cette perspective découragera aussi l’effort de récolte de signatures. C’est une bien meilleure approche que l’initiative citoyenne européenne qui dans son libellé ne contient même pas le mot « référendum » et où l’aboutissement de la procédure ne conduit qu’à ce que la Commission doive décider de l’action à entreprendre. Le référendum d’initiative « partagée » laisse par contre espérer un référendum puisque celui-ci n’est pas juridiquement exclu.
– Si vraiment vous êtes poussés dans vos retranchements, instaurez un référendum uniquement consultatif. Pas de référendum décisionnel ! Les gens se réjouiront de vous entendre parler de référendum et ne se préoccuperont pas des adjectifs.
Fixez des conditions irréalisables pour l’organisation du référendum
Si vous êtes contraints d’accepter qu’un RIC puisse aboutir à un référendum quand un certain nombre de signatures sont réunies dans un délai donné, veillez à ce que ce nombre soit suffisamment élevé et/ou le délai suffisamment court pour que ces conditions ne soient jamais réalisées. Ainsi, le référendum d’initiative « partagée » exige qu’un cinquième des membres du Parlement en prennent l’initiative et qu’elle soit soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.
Excluez certains thèmes
– Evitez en particulier le RIC constituant qui permet de modifier la Constitution. Le peuple ne doit pas avoir la main sur le sommet de la hiérarchie des normes. Certaines choses sont trop importantes pour lui être confiées. Inutile d’attirer l’attention sur ce texte abscons qu’est la Constitution.
– Le peuple est trop bête et trop méchant pour pouvoir traiter de certains sujets. A ceux qui en doutent, décrivez de façon vivide le risque qu’il instaure la peine de mort, voire la torture : plus c’est effrayant, plus ça marche.
Faites réécrire les propositions des citoyens par une commission
Vous n’avez même pas besoin d’insulter les citoyens en prétendant qu’ils ne savent pas écrire : il suffit d’argumenter que des propositions voisines doivent être réunies en une seule proposition. Et cela vous permet de faire modifier les propositions citoyennes avant qu’elles soient soumises au référendum. Tout filtre entre la proposition des citoyens et le référendum présente le mérite d’affaiblir la démocratie. Mais il faut des filtres qui ont un pouvoir de décision : une assemblée délibérative populaire qui fournit simplement de l’information ne remplit pas vraiment cette fonction.
Soumettez les RICs constituants à un contrôle de constitutionnalité
Ceci permet d’empêcher un changement important de la Constitution, puisqu’un tel changement sera considéré comme incompatible avec la Constitution existante, et donc inconstitutionnel. Ajoutez‑y un contrôle de compatibilité avec les accords internationaux, notamment pour éviter que le peuple dénonce de tels accords.
Majorité qualifiée ou quorum
Veillez à mettre tous les atouts de votre côté en cas de référendum. Et ceci même si vous avez la majorité contre vous. Pour cela, exigez que la proposition ne soit acceptée que si une proportion nettement supérieure à 50% des votants l’accepte, par exemple les deux tiers. Si cela rend votre volonté de sabotage trop voyante, prévoyez plutôt un quorum : la proposition n’est acceptée que si le taux de participation dépasse un certain seuil. Vous pourrez toujours argumenter que vous vous préoccupez de la représentativité du vote. En réalité, cela vous permettra une stratégie machiavélique : au lieu de voter contre la proposition soumise au référendum, vous demanderez à vos troupes de s’abstenir pour que ce quorum ne soit pas atteint. Vous gagnerez bien qu’étant minoritaire, car les véritables abstentionnistes seront ajoutés à vos partisans. Et veillez à ce que les médias ne parlent pas trop de ce référendum.
Traînez les pieds pour appliquer la décision populaire
Si le peuple adopte en référendum une décision qui ne vous convient pas, rien ne presse pour la mettre en œuvre. Ne comptez toutefois pas trop sur cette astuce, car les initiants pourraient la contourner en inscrivant des délais dans les dispositions transitoires de leur proposition.
Conservez la possibilité de détricoter la décision populaire en catimini
Veillez à vous conserver la possibilité de renverser en catimini la décision populaire. Comme cela a été fait après le rejet de la Constitution européenne en 2005. Pour cela, il est crucial de pouvoir modifier la Constitution sans référendum. Vous reviendrez donc avec une proposition similaire (veillez toutefois à en changer le nom et quelques détails) que vous vous garderez de soumettre au référendum et adopterez en congrès.
Proposez une constituante
Ces crétins de citoyens ne connaissent pas la différence entre une constituante et un RIC constituant. Profitez-en. Car une constituante est vraiment un moindre mal. Il s’agit d’un moment constituant transitoire, alors que le RIC constituant rend en tout temps le pouvoir constituant au peuple. Surtout, il vous sera plus facile de manipuler en catimini une constituante qu’un peuple. Prévoyez que cette constituante soit élue plutôt que tirée au sort, car après votre victoire à la présidentielle vous aurez bien des chances de disposer d’une majorité à la constituante. Ou, plus subtilement, laissez chaque citoyen choisir entre i) désigner les représentants qu’il préfère ou ii) les laisser tirer au sort. Qui pourra vous reprocher de laisser chaque citoyen décider ? Et cela aura l’avantage que la très large majorité des membres de la constituante seront de facto élus, car chaque citoyen choisira les représentants de son bord et laissera les autres tirer leurs propres représentants au sort. Il va sans dire que la constituante doit être proposée à la place du RIC constituant plutôt qu’en complément.
S’engager de façon peu contraignante
Ne vous engagez pas sur un texte précis
Engagez-vous pour le RIC, mais de façon très floue. Une ligne suffit dans un programme. Votre promesse étant vague, il sera difficile de vous accuser de ne pas l’avoir tenue. Si vous êtes contraint de formuler précisément votre promesse, par exemple afin de devancer vos concurrents pour accéder au second tour, alors il va falloir feinter. Rédigez par exemple une proposition de loi instaurant le RIC, avec un exposé des motifs parfaitement démocratique, que vous veillerez à torpiller dans la proposition de modification constitutionnelle proprement dite. Veillez par exemple à ne pas modifier l’article 89 de la Constitution de sorte à mettre de votre côté les chances que le conseil constitutionnel considère que votre RIC n’inclut pas le RIC constituant.
Noyez la promesse de RIC dans une multitude de promesses
Le RIC ne doit en aucun cas être votre promesse numéro 1. Noyez-là plutôt dans une multitude de promesses. Si vous tenez la majorité de vos promesses, personne ne pourra vous reprocher de ne pas avoir pu les tenir toutes. Et si le RIC fait partie de celles qui ne sont pas tenues ? C’est la vie.
Pas de calendrier
Ne vous engagez pas sur un calendrier pour mettre en œuvre votre promesse de RIC. Ainsi vous pourrez toujours répondre que vous tiendrez cette promesse plus tard. Surtout, ne promettez pas de promulguer avant les législatives le décret fixant la date du référendum. Car si vous ne tenez pas votre promesse, cela se verra avant les législatives : le peuple pourra vous sanctionner immédiatement.
N’hésitez pas à cumuler ces différentes astuces. Portez à la fois la ceinture et les bretelles : on n’est jamais trop prudent. Le référendum d’initiative « partagée » est à cet égard un chef‑d’œuvre : i) il ne porte que sur certains thèmes, ii) la procédure est d’initiative parlementaire, iii) elle doit être soutenue par un nombre exorbitant de citoyens et iv) on peut éviter un référendum même si ces conditions draconiennes sont réalisées. Cela doit vous inspirer, même si vous devrez peut-être ruser davantage pour éviter que votre volonté de sabotage soit trop évidente. Ne surestimez toutefois pas le risque que votre stratagème soit démasqué. La plupart n’y verront que du feu. Et ceux qui s’en apercevront n’ont de toute façon guère d’audience.
Il faut toutefois absolument éviter qu’apparaisse au premier tour un candidat qui se focalise sur le thème de la démocratie. Les grands médias ne pourront en effet plus éviter d’évoquer cette candidature. Ce candidat rappellera constamment dans les débats du 1er tour la nécessité de rendre le pouvoir au peuple. Surtout, il dévoilera les stratagèmes ci-dessus et pourrait vous contraindre à vous engager de façon crédible pour un véritable RIC constituant afin de battre vos adversaires dans la course à l’accession au 2ème tour. Car les sondages montreront la proportion d’électeurs qui voteront pour ce candidat (et là pas de doute : si ce candidat ne s’engage que sur la démocratie, cela signifie que ses partisans exigent la démocratie). Même si cette proportion est relativement faible, elle peut être significative par rapport à l’écart entre le 2ème et le 3ème candidat, et donc être déterminante pour votre accès au second tour. Et peut-être rebelote au 2ème tour. On aurait pu espérer qu’aucun candidat ne se focalise ainsi sur la démocratie. Malheureusement, il y a Clara Egger. Elle a pour unique objectif de rendre le pouvoir au peuple en instaurant le RIC constituant, ainsi que le référendum obligatoire pour toutes modifications de la Constitution. Il faut absolument éviter qu’elle réunisse les 500 parrainages et parvienne ainsi au 1er tour. Heureusement, notre Constitution est bien faite : seuls les élus peuvent accorder leur parrainage, pas les citoyens. On peut espérer que les élus auront le bon sens de ne pas soutenir une candidature aussi radicale. Mais il peut être nécessaire de leur rappeler qu’un tel choix pourrait être mauvais pour leur commune. Il serait en effet approprié de limiter les subventions à une commune gérée par un maire aussi irrationnel.
Vous disposez-là de tous les outils pour répondre aux aspirations démocratiques par un parfait enfumage. Mais n’hésitez surtout pas à être créatif.
Vidéo : Astuces pour les politiciens : comment enfumer sur le RIC ?
DOCTOTHON : remarquable mise en scène, par les citoyens eux-mêmes, du DISSENSUS SCIENTIFIQUE à propos du coup d’État « COVID » (mise en scène interdite par les « médias mainstream » corrompus)
Chers amis,
Je vous signale ici (en retard, pardon), une initiative citoyenne importante pour défendre la démocratie, le « doctothon ».
La démocratie, c’est la mise en scène des conflits politiques, pour bien éclairer l’opinion avant de décider.
La méthode scientifique, elle aussi, repose sur l’organisation de l’exposé public, loyal et rigoureux, des dissensus scientifiques, pour bien éclairer l’opinion, là aussi.
Or aujourd’hui, « les médias », qui accaparent le monopole de cette mise en scène, interdisent carrément cette confrontation publique loyale sur « la crise sanitaire », en censurant la plupart des opinions dissidentes, pour faire croire à un consensus scientifique et politique, alors que celui-ci n’existe pas.
Le « doctothon » résiste au rouleau compresseur de la censure : c’est une remarquable initiative citoyenne pour donner, pendant 24 h, la parole à 300 docteurs, médecins et scientifiques, sur la « crise Covid » (qui est en fait, de mon point de vue, un coup d’État planétaire sous prétexte sanitaire).
J’ai déjà vu passer plein d’informations intéressantes et importantes sur ce long événement : https://www.doctothon.com/
Programme partie 1 :
https://www.doctothon.com/accueil-du-doctothon/horaire-partie‑1
Programme partie 2 :
https://www.doctothon.com/accueil-du-doctothon/horaire-partie‑2
(La première partie ci-dessous commence apparemment à 1h33:20)
https://www.youtube.com/watch?v=dPg2XxDZOX8
Partie 2 :
Il va nous falloir du temps pour mettre en valeur, dans ce long flot de témoignages, les interventions les plus importantes.
Je vous propose de signaler en commentaire le minutage des passages qui vous semblent particulièrement remarquables (ou critiquables).
Je vous propose aussi, dans les commentaires de ce billet, de regrouper ici toutes les informations montrant le profond DISSENSUS scientifique qui règne en fait, partout sur terre, sur les décisions politiques liberticides imposées par les gouvernements abusifs, sous des prétextes pseudo-scientifiques.
Bon courage à tous, tenez bon.
Étienne.
Le #8 de la Gazette des Amis du RIC (novembre 2021) est paru 🙂
Chaque mois, les principales actualités et actions des personnes œuvrant pour l’instauration du RIC et d’une démocratie digne de ce nom.
Le sommaire
Invitations à l’action
• Appel aux candidats à la présidentielle 2022 : « Donnez le pouvoir au peuple avec le RIC Constituant »
• Aidez vos maires : informez-les au sujet des 9 effets bénéfiques du RIC Constituant pour les citoyens et les élus locaux
• Présentez le Collectif des Maires Résistants à vos élus locaux pour 2022
• Temps restant pour obtenir au moins 500 parrainages d’élus nécessaires au RIC en 2022
• Autres propositions d’actions
Vidéos
• Tuto pratique de Pierre-Alain Bruchez pour les politiciens : Comment enfumer sur le RIC ? (2nd degré)
• Fadi Kassem du PRCF – Audition Démocratique des Candidats à la Présidentielle 2022
• Audition de Clara Egger (experte du RIC) – Audition par Hakim d’Objectif RIC
• Étienne Chouard et Pierre-Alain Bruchez : Comment soutenir des candidats en 2022 tout en étant contre l’élection ?
• Le Label RIC et Culture-RIC : Comment instaurer le bon outil démocratique en 2022 ?
• CLIMAT : la DÉMOCRATIE est-elle la solution ? Live avec Clara Egger d’Espoir RIC 2022
Infos utiles
• Comparateur des candidatures avec le RIC au programme à la présidentielle de 2022 (édition 1)
• Analyse du RIC d’Etienne Chouard (2019) – Label RIC
• Analyse du RIC du Parti Communiste Français – Label RIC
• 3 ans, l’heure du Bilan ! (Résultats du questionnaire Gilets Jaunes)
Agenda
Présentation du sommaire en vidéo
Live MCP : être électophobe et soutenir des candidats en 2022, comment c’est possible ?
Chers amis,
Je vous invite à visionner ce live organisé par le MCP pour réfléchir ensemble : « quelle stratégie présidentielle 2022 pour les vrais démocrates ? ».
Youtube
Au sujet de l’émission : « Cette émission initiée par le Mouvement Constituant Populaire « Comment Démocratiser la France ? » vise à mettre en lumière les initiatives et stratégies en faveur de la démocratie. L’intervenant aura l’occasion d’expliquer comment transformer notre société en démocratie réelle. Avec cette émission, le MCP souhaite promouvoir les stratégies qui permettront aux citoyens de passer de la théorie à l’action en matière d’instauration d’une démocratie digne de ce nom.
Cet épisode sera animé par Pierre Alain Bruchez, un docteur en sciences économiques de l’Université de Lausanne, en Suisse. Il est auteur du livre : Le référendum d’initiative citoyenne : L’instaurer en France, le préserver en Suisse. »
[Libertés, Éthique, Citoyens comme seuls défenseurs possibles de la Démocratie] Julie Ponesse, professeur d’éthique : la covid révèle les dangers du conformisme, la banalité du mal, et la nécessité de l’héroïsme
Chers amis,
Je vous signale cet exposé (18 min) que je trouve important.
Je vous copie, en dessous de la vidéo, une retranscription complète, à lire le crayon à la main.
À connaître, et à faire connaître, il me semble.
Étienne.
Julie Ponesse, professeur d’éthique, sur la politique COVID : « La plus grande menace pour l’humanité à laquelle nous ayons jamais été confrontés »
Revenez quelques années en arrière, à l’automne 2019, par exemple. Que faisiez-vous alors ? À quoi ressemblait votre vie ? A quoi teniez-vous alors ? De quoi aviez-vous le plus peur ? Comment imaginiez-vous l’avenir ?
Voilà la personne avec laquelle j’aimerais parler pendant les 15 prochaines minutes, et je commencerai par ma propre histoire ; à la fin, j’aurai une faveur à demander et un petit secret à partager.
À l’automne 2019, j’étais professeur d’éthique et de philosophie antique ; j’enseignais aux étudiants la pensée critique et l’importance de la réflexion personnelle, comment poser de bonnes questions et évaluer les preuves, comment apprendre du passé et pourquoi la démocratie exige la vertu civique.
Faisons un accéléré au 16 septembre 2021, date à laquelle j’ai reçu une lettre de « licenciement avec motif » après avoir contesté, et refusé de respecter, la vaccination obligatoire imposée par mon employeur. J’ai été licenciée pour avoir fait exactement ce pour quoi j’avais été engagée. J’étais un professeur d’éthique qui remettait en question ce que je considérais comme une exigence contraire à l’éthique. Il ne faut pas chercher bien loin pour voir l’ironie de la chose.
Le Canada est régi par des lois qui sont fondées sur l’éthique. On pourrait dire que l’éthique est le fondement de notre démocratie.
« Le droit de déterminer ce qui doit ou ne doit pas être fait avec son propre corps, et d’être libre vis-à-vis des traitements médicaux non consensuels, est un droit profondément ancré dans notre système de common law. » Ces mots ne sont pas de moi ; ce sont ceux du juge Sydney Robins de la Cour d’appel de l’Ontario.
À de très rares exceptions près, le corps de chaque personne est considéré comme inviolable dans le droit canadien, et c’est l’éthique sous-jacente du Code de Nuremberg, la promesse faite à l’humanité que nous n’autoriserions plus jamais des prises de décision médicale non informée et non volontaire, même pour le bien du patient, et même au nom du bien public.
Par définition, la vaccination obligatoire est une stratégie d’immunisation coercitive : en l’absence de coercition – la menace de perdre son emploi, par exemple – les gens accepteraient volontairement de faire ce que l’obligation tente de réaliser !
Aujourd’hui, les employeurs prennent nos carrières en otage et nous privent de notre participation à l’économie et à la vie publique. Leur justification est suivante : « Nous sommes en pleine pandémie, et nous devons donc renoncer à l’autonomie de notre corps au nom du bien public. »
Parlons donc un peu d’autonomie et de bien public.
En cas d’urgence, le Parlement et les législatures provinciales disposent d’un pouvoir limité pour adopter des lois qui violent certains droits de la Charte au nom du bien public. Mais, pour justifier ces violations, la vaccination obligatoire devrait satisfaire à un seuil d’exigence très élevé : il faudrait, par exemple, que le COVID-19, soit un agent pathogène très virulent pour lequel il n’existe aucun traitement adéquat, et l’efficacité et la sécurité des vaccins devraient être démontrées.
L’état actuel des choses au Canada ne répond à aucun de ces critères.
Considérons les faits suivants :
1) le COVID-19 a un taux de fatalité par rapport à l’infection qui ne représente même pas 1 % de celui de la variole (et il pose encore moins de risque pour les enfants) ;
2) il existe un certain nombre de produits pharmaceutiques sûrs et très efficaces pour le traiter (notamment des anticorps monoclonaux, l’Ivermectine, la fluvoxamine, la vitamine D et le zinc) ;
3) Les vaccins ont fait l’objet de plus d’événements indésirables (y compris d’innombrables décès) que tous les autres vaccins sur le marché au cours des 30 dernières années.
À la lumière de ces faits, je me pose de nombreuses questions :
Pourquoi les vaccinés se voient-ils accorder des passeports vaccinaux et l’accès aux espaces publics, alors que le directeur du CDC a déclaré que les vaccins COVID-19 ne peuvent pas empêcher la transmission ?
Pourquoi la vaccination est-elle la SEULE stratégie d’atténuation alors que les preuves émergentes (y compris une étude récente de Harvard) ne mettent en évidence aucune relation perceptible entre le taux de vaccination et les nouveaux cas ?
Pourquoi notre gouvernement continue-t-il de ne pas recommander l’ivermectine comme traitement, alors que les National Institutes of Health des États-Unis le soutiennent et que l’État d’Uttar Pradesh, en Inde, l’a distribué à ses 230 millions d’habitants, réduisant ainsi son taux de mortalité liée au COVID à près de zéro ? Comment l’Inde a‑t‑elle pu dépasser le Canada en matière de soins de santé ?
Pourquoi sommes-nous sur le point de vacciner des enfants de 5 ans alors que le COVID présente pour eux moins de risques que les réactions potentielles aux vaccins ET alors qu’il n’existe AUCUN système de surveillance efficace des vaccins ?
Pourquoi nous concentrons-nous sur les avantages limités de l’immunité induite par le vaccin alors que des études dans le monde réel montrent que l’immunité naturelle est plus protectrice, plus puissante et plus durable ?
Pourquoi flétrissons-nous ceux qui hésitent à se faire vacciner et non ceux qui veulent imposer le vaccin à tout prix ?
« Pourquoi, comme l’a récemment demandé une infirmière, les personnes protégées doivent-elles être protégées des personnes non protégées en contraignant les personnes non protégées à utiliser une protection qui de toute façon n’a pas protégé les personnes protégées ? »
À tous les égards et sous tous les angles, ce château de cartes est sur le point de s’effondrer…
Mais la question qui m’intéresse est de savoir pourquoi il ne s’est pas déjà effondré ? Pourquoi ces questions ne font-elles pas la une de tous les grands journaux du Canada chaque jour ?
Les bonnes personnes n’ont-elles tout simplement pas vu les bonnes données ? S’agit-il simplement d’une erreur administrative… à l’échelle mondiale ?
Qu’est-il donc arrivé à nos dirigeants ? Notre premier ministre a lancé le cri de guerre : « Ne croyez pas que vous monterez dans un avion », a‑t‑il menacé. Les promesses de campagne sont devenues des politiques publiques ségrégationnistes. Notre gouvernement nous encourage quotidiennement à nous diviser et à être haineux.
Comment les choses ont-elles pu changer si radicalement ? Comment nous, Canadiens, avons-nous pu changer aussi radicalement ?
J’observe que nous sommes confrontés à une pandémie, non pas seulement d’un virus, mais d’une pandémie de conformisme et de complaisance, dans une culture du silence, de la censure et de l’intimidation institutionnalisée.
Les médias mainstream aiment à dire que nous menons une « guerre de l’information » : que la désinformation, et même le questionnement et le doute, ont été les fléaux de cette pandémie.
Mais ce n’est pas seulement l’information qui a été instrumentalisée comme arme, dans cette guerre ; c’est aussi le droit d’une personne à penser par elle-même.
J’ai entendu dire : « Eh bien, je n’y connais pas grand-chose en virus, donc je ne devrais pas vraiment avoir d’opinion », mais…
La question n’est pas de savoir si vous en savez plus sur la virologie que nos responsables de la santé publique ; la question est de savoir pourquoi nous ne leur reprochons pas tous de ne pas être prêts à s’engager sur la voie des preuves et à débattre avec celui qui a une opinion différente.
Nous devrions demander non pas un résultat, mais le rétablissement d’un processus.
Sans ce processus, nous n’avons pas de science, nous n’avons pas de démocratie.
Sans ce processus, nous sommes dans une espèce de guerre morale.
Mais, les guerres du passé avaient des frontières claires et nettes : l’Est et l’Ouest, les patriotes et le gouvernement.
La guerre où nous nous trouvons aujourd’hui est une guerre d’infiltration et non d’invasion, d’intimidation et non de libre choix, de forces psychologiques si insidieuses que nous en venons à croire que les idées sont les nôtres et que nous y faisons notre devoir en abandonnant nos droits.
Comme l’a dit récemment un sage collègue, « C’est une guerre qui porte sur le rôle du gouvernement. Il s’agit de notre liberté de penser et de poser des questions, et de savoir si l’autonomie individuelle peut être réduite à un privilège conditionnel ou si elle demeure un droit. C’est une guerre qui vise à déterminer si vous devez rester un citoyen ou devenir un sujet. Il s’agit de savoir à qui vous appartenez… à vous-même ou à l’État. »
Elle porte sur le point où nous établissons la ligne de démarcation.
Il n’est pas question ici de libéraux et de conservateurs, de pro et d’anti-vaxx, d’experts et de profanes. Chacun a le devoir de se soucier de la vérité, chacun devrait se soucier des processus scientifiques et démocratiques, chacun devrait se soucier des autres.
Je dirais qu’il n’y a pas grand-chose à faire pour assurer la survie de notre nation si notre liberté de débattre, de critiquer, d’exiger des preuves quant à ce que notre gouvernement nous demande, ne survit pas avec elle.
En tant que personne née dans les années 70, je n’ai jamais pensé que je devrais mener CE type de guerre ; que le droit à l’autonomie corporelle, à l’échange libre et transparent d’informations serait menacé.
Pensez un instant aux horreurs les plus inimaginables du siècle dernier – la « solution finale », l’apartheid sud-africain, les génocides rwandais et cambodgiens. Ne sommes-nous pas censés nous souvenir des atrocités du passé pour ne pas les répéter ? Eh bien, la mémoire est courte, les chaînes familiales sont brisées, les nouveaux soucis éclipsent les anciens, et les leçons du passé se perdent dans l’histoire ancienne pour être oubliées.
Aujourd’hui, les vaccinés semblent jouir de tous les droits et privilèges d’une société civilisée : liberté de mouvement, accès à l’éducation, approbation des gouvernements, des législateurs, des journalistes, des amis et de la famille. La vaccination est le ticket pour un retour CONDITIONNEL de notre droit à participer à la société canadienne.
Mais comme l’a dit John F Kennedy : « Les droits de chaque homme sont diminués lorsque les droits d’un seul homme sont menacés. »
CONCLUSION
Je n’ai aucun doute sur le fait que COVID-19 est la plus grande menace pour l’humanité à laquelle nous ayons jamais été confrontés ; non pas à cause d’un virus ; celui-ci n’est qu’un chapitre d’une histoire beaucoup plus longue et complexe ; mais à cause de notre réponse à ce virus.
Et cette réponse est en train, je crois, de gagner sa place dans tous les manuels d’éthique médicale qui seront publiés au cours du siècle prochain.
Que pouvons-nous faire ?
Comme l’a dit le chimiste et auteur canadien Orlando Battista, « Une erreur ne devient une faute que lorsque vous refusez de la corriger. »
Dans notre monde, la politesse, « se débrouiller », « passer sous le radar » semblent être devenus les seuls objectifs. Finis les révolutionnaires des années 60, finis les patriotes de l’Amérique primitive. Nous sommes les victimes – et les soldats – d’une pandémie du conformisme.
Mais le conformisme n’est pas une vertu, il n’est pas neutre, et il n’est certainement pas inoffensif.
Lorsque Hannah Arendt a couvert le procès d’Adolf Eichmann pour le New Yorker en 1961, elle s’attendait à trouver un homme complexe, arrogant, diabolique, voire psychotique. Elle a trouvé tout le contraire. Elle a été frappée par son « caractère très ordinaire ». Il était « terriblement normal, terrifiant dans sa normalité », écrit-elle, un homme qui « ne faisait que suivre les ordres », comme il le répétait sans cesse. Ce qu’elle a découvert, c’est ce qu’elle a appelé la « banalité du mal », la tendance irréfléchie des gens ordinaires à obéir aux ordres afin de se conformer sans penser par eux-mêmes.
Les messages dédaigneux et bien rodés de nos responsables de la santé publique ont créé une machine très efficace qui ne publie pas ses preuves et ne s’engage pas dans un débat, mais émet des ordres que nous suivons avec empressement. Avec l’aide des médias, ses erreurs sont cachées, ses politiques ne sont pas remises en question et ses dissidents réduits au silence.
Comment briser ce silence ? Comment retrouver la raison et reconstruire notre démocratie ? Il est peut-être temps de faire un peu de bruit. Des études ont prouvé qu’une fois qu’une idée est adoptée par seulement 10 % de la population, c’est le point de basculement où les idées, opinions et croyances seront rapidement adoptées par les autres. Un 10 % qui parle, un 10 % qui fait du bruit, il n’en faut pas plus.
La démocratie, « le règne du peuple », ne permet pas seulement la liberté d’expression et de recherche, elle l’exige.
Et le petit secret que je vous ai promis au début ? Le voici : vous n’êtes PAS une mauvaise personne parce que vous exigez des preuves, vous n’êtes pas une mauvaise personne parce que vous faites confiance à votre instinct, et vous n’êtes pas une mauvaise personne parce que vous voulez penser par vous-même. En réalité, c’est le contraire qui est vrai.
Si la perte de la justice vous inquiète, si le genre de vie que pourront mener nos enfants vous fait du souci, si vous voulez retrouver votre pays – le pays qui était autrefois l’envie du monde entier – c’est maintenant qu’il faut agir. Il n’y a pas de raison d’attendre, vous ne pouvez pas vous offrir le luxe d’attendre, ou trouver des excuses. C’est maintenant que nous avons besoin de vous.
C’est maintenant qu’il faut appeler nos politiciens et écrire à nos journaux. C’est le moment de protester, c’est le moment de contester et même de désobéir à notre gouvernement.
Comme l’a dit Margaret Mead : « Ne doutez jamais qu’un petit groupe de citoyens réfléchis et engagés puisse changer le monde ; en fait, c’est la seule chose qui y soit jamais parvenue. »
En d’autres termes, vous n’avez pas besoin d’une tribu de héros, d’une masse de héros, d’un pays de héros. Il ne vous en faut qu’un seul. Vous pouvez apporter votre contribution et vous POUVEZ faire la différence. Les pilotes de Southwest Airlines, la police montée canadienne, les infirmières du University Health Network font tous une différence.
Et cette faveur que je devais vous demander ? Nous avons besoin de héros maintenant plus que jamais. Notre démocratie demande des volontaires… Serez-vous un héros, pour notre pays, pour nos enfants ? Ferez-vous partie des 10 % qui font du bruit ?
Dr Julie Ponesse, Discours du 28 octobre 2021 pour « The Democracy Fund »
Le communisme comme démocratie véritable, instituée d’abord au travail par les travailleurs : travaux croisés de Bernard Friot et Frédéric Lordon
Chers amis,
Je suis en train de dévorer le dernier livre d’entretiens (passionnants) entre Bernard Friot et Frédéric Lordon : « EN TRAVAIL. Conversations sur le communisme » (La dispute, 2021) :
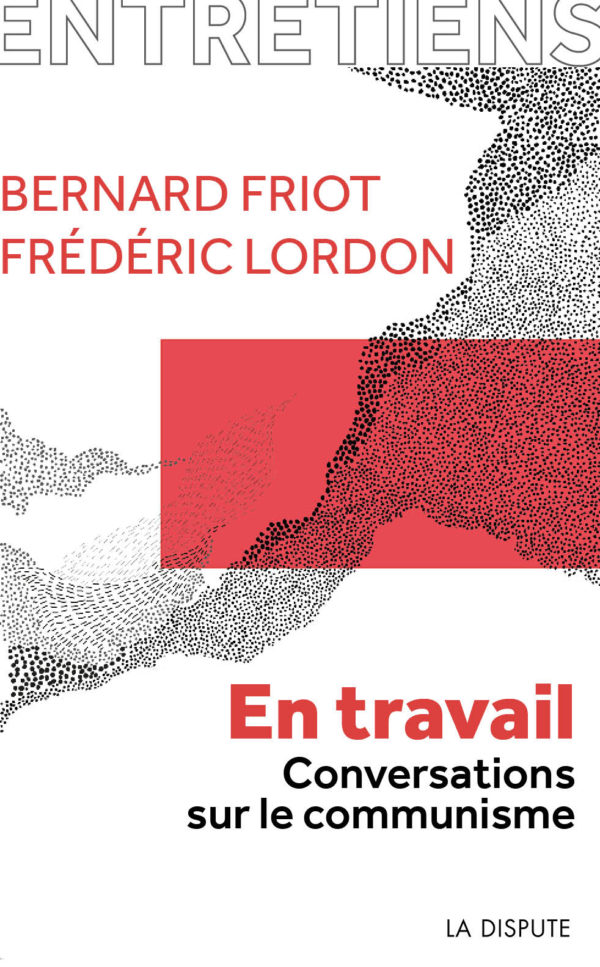
Sur ce livre étonnant, décapant, important, je vous signale quelques vidéos vraiment intéressantes :
Une courte vidéo de présentation par l’éditeur :
La présentation (remarquable) par Julien Théry (Le Média, novembre 2021) :
Un débat tonique, à la Fête de l’Huma en septembre 2021 :
J’aime ces deux hommes, qui accordent comme moi une importance centrale et décisive aux institutions, dans un projet universel d’émancipation de toute forme de domination.
La pensée de Bernard progresse sans arrêt, et cette fois encore, au contact de Frédéric, c’est spectaculaire.
Je voudrais faire deux remarques :
- il me semble que, à les entendre, on pourrait tout aussi bien remplacer le mot « communisme » par le mot « démocratie », ce qui aurait l’avantage de ne pas faire peur à tout le monde pour rien.
- Une fois de plus, je m’attriste que (malgré toutes les discussions que nous avons eues à ce sujet depuis des années) jamais ces deux penseurs n’intègrent l’idée (pourtant indispensable selon moi) d’un processus constituant populaire permanent (et donc de la nécessaire préparation préalable des simples citoyens au travers d’ateliers pratiques, ici et maintenant). Cette fois, ils frôlent l’idée, mais sans s’y arrêter.
Si j’en trouve une trace dans ce livre, je vous le dirai (mais je dois bien avouer que je désespère).
Je profite de cette occasion pour vous signaler quelques autres livres importants (et des vidéos qui les présentent) qui ont précédé celui-ci :
• Frédéric Lordon, VIVRE SANS ? institutions, police, travail, argent… (La Fabrique 2019)
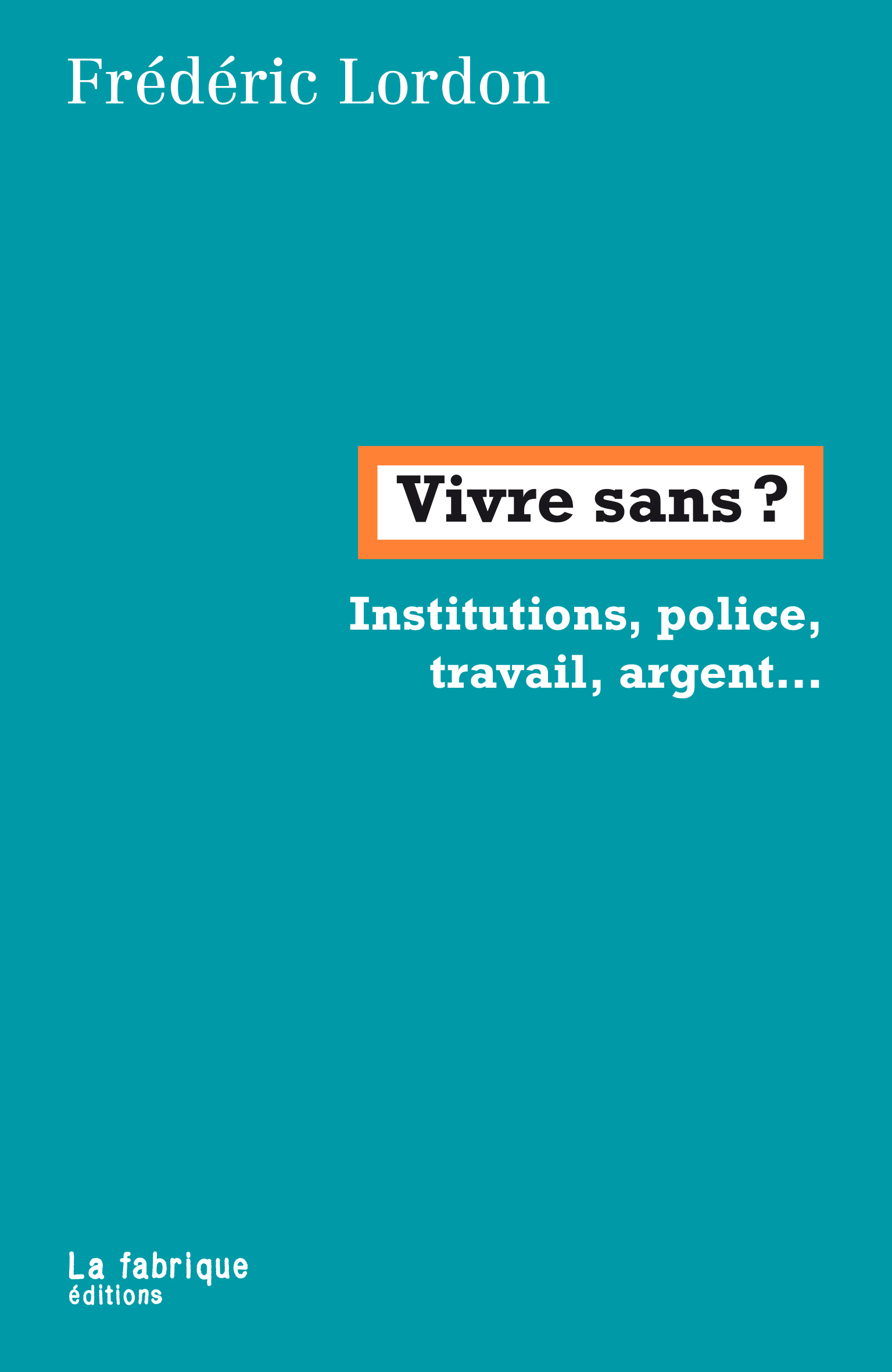
https://lafabrique.fr/vivre–sans/
Présentation à La Fabrique :
Présentation à la librairie Libertalia :
• Frédéric Lordon, Figures du communisme (La Fabrique 2021)
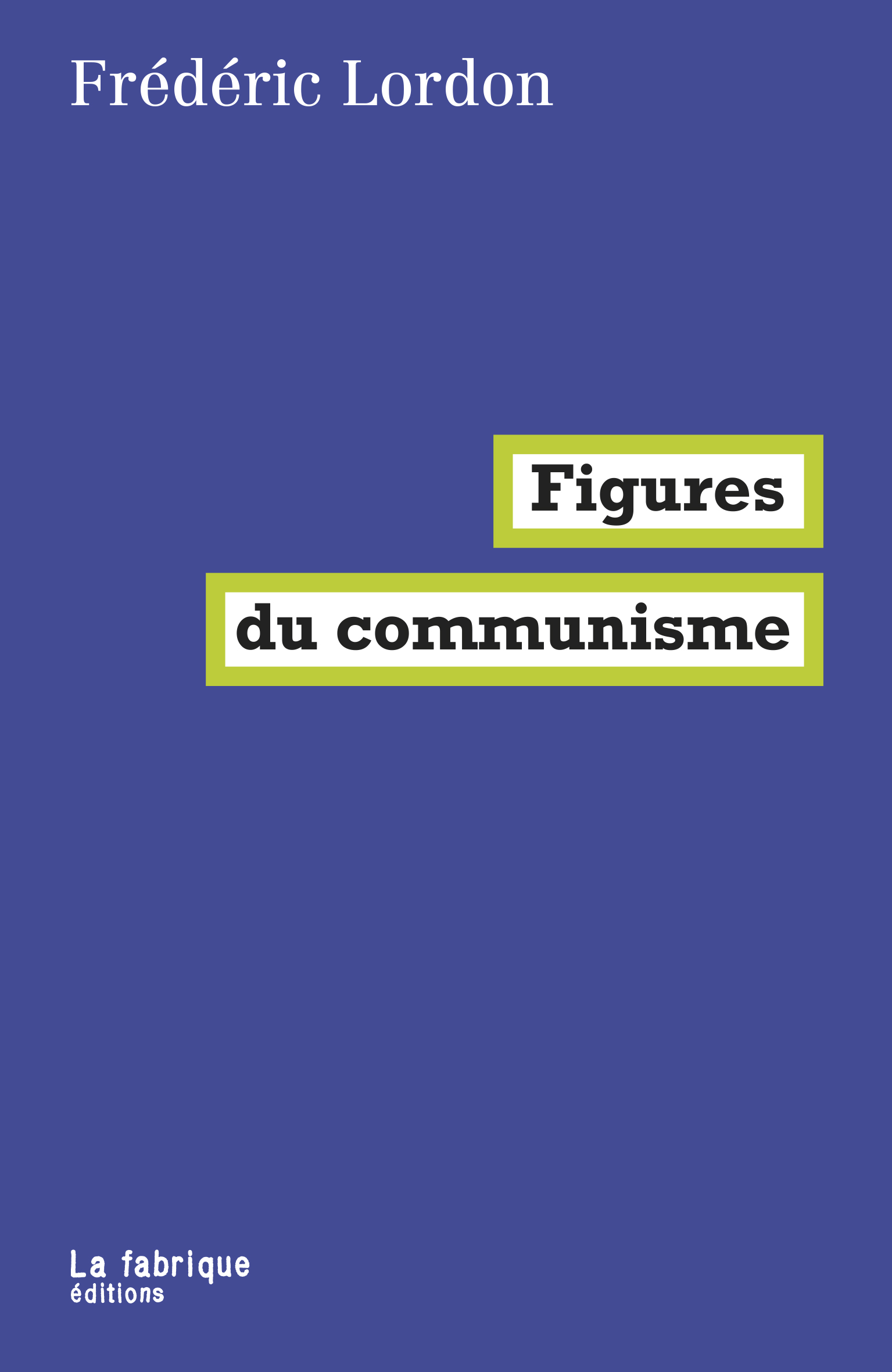
https://lafabrique.fr/figures–du–communisme/
Présentation par Julien Théry (Le Média, mars 2021) :
• Bernard Friot et Judith Bernard, Un désir de communisme (Textuel, 2020)
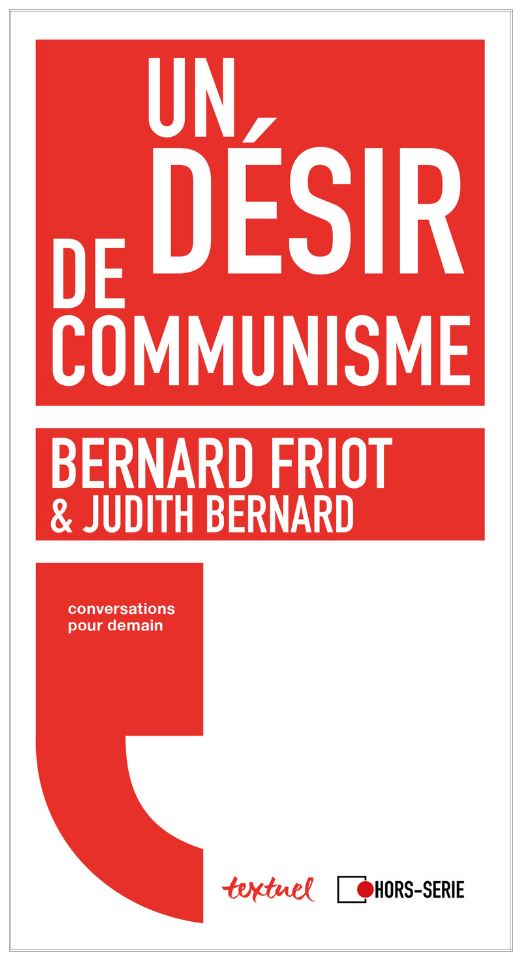
https://www.editionstextuel.com/livre/un_desir_de_communisme
Présentation par Julien Théry (Le Média, septembre 2020) :
Présentation au Lieu-dit (Paris XXe, septembre 2020) :
Présentation par Regards (septembre 2020) :
Étienne
PS : ne manquez pas les émissions de Julien Théry, sur Le Média, elles sont toutes bonnes 🙂
Fil Facebook correspondant à ce billet :
Le communisme comme démocratie véritable, instituée d’abord au travail par les travailleurs : travaux croisés de Bernard Friot et Frédéric Lordonhttps://t.co/gYHGHZAc7y
— Étienne Chouard (@Etienne_Chouard) November 14, 2021
Tweet correspondant à ce billet :
Le communisme comme démocratie véritable, instituée d’abord au travail par les travailleurs : travaux croisés de Bernard Friot et Frédéric Lordonhttps://t.co/gYHGHZAc7y
— Étienne Chouard (@Etienne_Chouard) November 14, 2021
Post Telegram correspondant à ce billet :
https://t.me/chouard/261
Stratégie électorale pour le RICC : faut-il soutenir Clara Egger à la présidentielle 2022 ?
Extrait de la Gazette des Amis du RIC 7 :
Le Youtubeur Suisse Pierre-Alain Bruchez (Docteur en sciences économiques de l’Université de Lausanne) expose en 20 minutes sa stratégie pour instaurer le RIC Constituant en 2022 :
« Clara Egger doit être au premier tour de la présidentielle pour y défendre le thème le plus important de cette élection : rendre le pouvoir au peuple. En disant comment et en dénonçant les enfumages de ceux qui ne défendent pas un véritable RIC constituant […]. »
En savoir plus sur Espoir RIC 2022
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10159573877367317
Tweet correspondant à ce billet :
Stratégie électorale pour le RICC : faut-il soutenir Clara Egger à la présidentielle 2022 ?
Le Youtubeur Suisse Pierre-Alain Bruchez répond :
oui, pour y défendre le thème le plus important de cette élection : rendre le pouvoir au peuple.https://t.co/jeKPWI5QKl— Étienne Chouard (@Etienne_Chouard) November 7, 2021
Post Telegram correspondant à ce billet :
https://t.me/chouard/250
Passionnante Clara Egger : RIC ou Frexit ? l’Union européenne est-elle un obstacle à la démocratie ?
Extrait de la Gazette des Amis du RIC 7 :
« Pas de RIC sans Frexit… ou pas ? Si les Français avaient l’initiative et le dernier mot sur les décisions politiques en France, comment cela se passerait-il avec l’Union Européenne ? Y‑aurait-il des conflits de droit ? Qui déciderait en dernier ressort ? La candidate et enseignante chercheuse spécialiste du RIC Constituant apporte un éclairage sur ces questions. »
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10159564789077317
Tweet correspondant à ce billet :
Passionnante Clara Egger : RIC ou Frexit ?
L’Union européenne est-elle un obstacle à la démocratie ?Si les Français avaient l’initiative et le dernier mot sur les décisions politiques en France, comment cela se passerait-il avec l’Union Européenne ?https://t.co/ryycWemEIR
— Étienne Chouard (@Etienne_Chouard) November 3, 2021
Post Telegram correspondant à ce billet :
Le #7 de la Gazette des Amis du RIC (octobre 2021) est paru 🙂
Présentation du sommaire en vidéo
Chaque mois, les principales actualités et actions des personnes œuvrant pour l’instauration du RIC et d’une démocratie digne de ce nom.
Sommaire de ce mois
Invitations à l’action
• Participons aux Votations Citoyennes Constituante du MCP
• Créons des connexions entre l’écologie et la démocratie
• Autres propositions d’actions
Vidéos
• Live au sujet des votations citoyennes d’octobre du MCP sur la démocratie
• Alexandre LANGLOIS : un nouveau candidat à la présidentielle 2022 pour le RIC
• Clara Egger : Frexit ? l’Union européenne est-elle un obstacle à la démocratie ?
• Frederic Delavier parle du RIC : « la seule solution pour vous sortir de l’esclavage »
• Témoignage et audition d’Elsa Faucillon, Députée du Parti Communiste Français
• Stratégie électorale pour le RICC : Soutenir Clara Egger à la présidentielle 2022
Infos utiles
• Analyse du RIC de l’UPR (François Asselineau) – Label RIC
• Analyse du RIC de Jean Lassalle – Label RIC
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10159563500112317
Tweet correspondant à ce billet :
https://twitter.com/Etienne_Chouard/status/1455609125891674115
Post Telegram correspondant à ce billet :
https://t.me/chouard/237
Vidéo Démocratie d’abord : Pourquoi est-ce si difficile de faire de la France une véritable démocratie ?
Pierre-Alain de la chaîne YouTube suisse Démocratie d’abord répond à la question que nous sommes nombreux à nous poser : pourquoi est-ce si difficile d’instaurer le RIC et une démocratie digne de ce nom en France ? Comment y parvenir malgré tout ?
Sommaire de la vidéo :
- Si le peuple veut la démocratie, il l’obtiendra (00:06)
- Le peuple ne peut pas décider ce sur quoi il peut décider (00:17)
- Le peuple peut jouer les candidats les uns contre les autres pour obtenir la démocratie (03:06)
- Les partis peuvent exploiter les divisions du peuple sur des sujets autres que la démocratie (04:29)
- Espoir RIC cherche à unir le peuple sur la démocratie et empêcher son enfumage (08:20)
- C’est les élus qui décident qui peut être candidat à l’élection présidentielle (12:26)
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10159544374277317
Tweet correspondant à ce billet :
https://twitter.com/Etienne_Chouard/status/1452727463784685570
Post Telegram correspondant à ce billet :
https://t.me/chouard/218
Lisez Silvio Gesell, c’est bouleversant : son livre, « L’ORDRE ÉCONOMIQUE NATUREL : SOL FRANC ET MONNAIE FRANCHE » (1911), vous montrera des pistes institutionnelles formidables pour imaginer —et préparer— un monde meilleur, rendant naturelles la prospérité, la justice et la paix.
Chers amis,
Il y a des années et des années que je vous parle de Silvio Gesell et de son livre enthousiasmant : L’ORDRE ÉCONOMIQUE NATUREL.
Ce livre, qui a inspiré les plus grands auteurs (Keynes et bien d’autres), vous montrera des pistes institutionnelles formidables pour imaginer — et préparer — un monde meilleur, rendant naturelles la prospérité, la justice et la paix.
Ce livre est devenu introuvable depuis longtemps. Je vous ai donc scanné, OCRisé et relu (il reste des coquilles, bien sûr) l’exemplaire que j’ai à la maison.
Le voici. Vous pouvez le feuilleter ou le télécharger :
Le même, à télécharger, au format .docx :
https://www.chouard.org/wp–content/uploads/2021/10/Silvio–Gesell–Lordre–economique–naturel–1911.docx
Bonne lecture.
Étienne.
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10159541810552317
Tweet correspondant à ce billet :
Il y a des années que je vous parle de Gesell et de son œuvre L’ORDRE ÉCONOMIQUE NATUREL.
Ce livre est devenu introuvable. Je vous ai donc scanné, OCRisé et relu l’exemplaire que j’ai à la maison.
Le voici. Vous pouvez le feuilleter ou le télécharger :https://t.co/XJCYSDDFlX
— Étienne Chouard (@Etienne_Chouard) October 24, 2021
Post Telegram correspondant à ce billet :
https://t.me/chouard/213
Participez à la votation citoyenne constituante d’octobre
Ce mois-ci, les amis du Mouvement Constituant Populaire (MCP) organisent des votations locales partout en France sur le sujet constituant.
Le sujet de la votation citoyenne constituante d’octobre
Pour rendre notre pays réellement démocratique et les citoyens réellement souverains, il est nécessaire de donner le pouvoir constituant au peuple, tout le peuple. Le pouvoir constituant – c’est-à-dire le pouvoir de modifier et valider une évolution de la Constitution – est le pouvoir absolu qui conditionne tous les autres et qui, en démocratie, ne peut être délégué.
Techniquement, cela implique de réviser l’article 89 de notre Constitution qui porte précisément sur le pouvoir constituant.
Le MCP propose d’en faire évoluer le texte afin d’y introduire deux principes essentiels :
- le Référendum d’Initiative Citoyenne (RIC) en matière constitutionnelle
- et le référendum obligatoire pour toute révision de la Constitution.
Pourquoi faire de telle votations citoyennes ?
La stratégie du MCP consiste à sensibiliser les citoyens à l’enjeu démocratique grâce à des actions d’éducation populaire de terrain.
Le MCP a constitué un maillage territorial composé de groupes locaux chargés de mener ces actions à l’image de la Votation Citoyenne d’octobre.
La votation est un outil d’éducation populaire qui permet de montrer que les citoyens sont des adultes politiques capables d’organiser des votations et de se saisir sérieusement des enjeux de société.
Le MCP organise ses actions de manière coordonnée afin de franchir le mur médiatique et de faire parler de l’enjeu démocratique dans toutes les discussions entre citoyens.
Participez localement ou numériquement
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10159533883317317
https://twitter.com/Etienne_Chouard/status/1450527700985204739
https://t.me/chouard/199
Rappels importants autour de l’erreur (l’arnaque) fondamentale, dès l’école : « Démocratie = élection, élection = démocratie. Répète ! »
Source des vidéos présentées :
- J’AI PAS VOTÉ – FILM COMPLET : https://www.youtube.com/watch?v=uzcN–0Bq1cw
https://www.youtube.com/watch?v=xiDpyNtasGQ
- Rousseau, citoyen du futur – Jean-Paul Jouary : https://www.youtube.com/watch?v=0SLmYYMD6yE
- Étienne Chouard | TEDxRepubliqueSquare : https://www.youtube.com/watch?v=YaX0DWZ0zhg
- Le Citoyen (Étienne Chouard) : https://www.youtube.com/watch?v=Dahg7XPHu98
- Démocratie(s) — #DATAGUEULE : https://www.youtube.com/watch?v=RAvW7LIML60
- Jacques Testart : https://www.youtube.com/watch?v=wCAVBxcxnAI&t=0s
- Étienne Chouard – Conférence de Lyon + Débat public : https://www.youtube.com/watch?v=EQJi1GwudWQ
- Étienne Chouard : LE NÉCESSAIRE PROCÈS CITOYEN DE L’ÉLECTION : https://www.youtube.com/watch?v=Pm_ebQrLt6s
- Ruptures, ZAPPING N°3 : https://www.youtube.com/watch?v=HByEtkXbATI
- Scylla (2012), lntro : https://www.youtube.com/watch?v=yE–Y9cNnbk
Une comparaison des taux de mortalité toutes causes ajustés selon l’âge en Angleterre, par Norman Fenton et Martin Neil : le taux de mortalité est actuellement plus élevé chez les vaccinés que chez les non vaccinés
Chers amis,
L’expérience d’abus de pouvoir chimiquement pur que nous sommes en train de vivre me contraint (littéralement) à ne plus penser qu’à ça, en toute première urgence. Il me semble que la prise de conscience (par toutes les populations du monde) que la prétendue « crise sanitaire » est en fait une agression jamais vue dans toute l’histoire de l’humanité, cette prise de conscience populaire est la seule façon de conduire le peuple à résister et d’empêcher physiquement les criminels de perpétrer leur forfait. C’est la raison qui explique mon obsession du moment, qui n’est, selon moi, pas du tout hors-sujet par rapport à mes travaux (sur les pouvoirs abusifs et les institutions démocratiques) depuis 2005 : la toute première urgence est d’empêcher que l’irréparable soit commis. Or les effets des « vaccins » sont irréversibles.
Je vous signale ici un travail anglais intéressant. Ces auteurs observent en Angleterre que le taux de mortalité est actuellement plus élevé chez les vaccinés que chez les non vaccinés. Vous verrez que ce travail complète utilement les travaux de Pierre Chaillot (Décoder l’éco) pour produire des statistiques honnêtes et fiables contre l’obligation qui nous est faite de nous injecter de force des produits toxiques (dont 20% de la composition est tenue secrète).
Fraternellement.
Étienne.
Une comparaison des taux de mortalité toutes causes ajustés selon l’âge en Angleterre entre vaccinés et non vaccinés
Norman Fenton et Martin Neil
(traduction automatique par Google)
Les propres données du gouvernement britannique ne corroborent pas les affirmations concernant l’efficacité/l’innocuité du vaccin.
Dans un précédent post, nous avons fait valoir que la mesure à long terme la plus fiable de l’efficacité/de l’innocuité du vaccin Covid-19 est le taux de mortalité toutes causes confondues ajusté en fonction de l’âge. Si, sur une période raisonnablement prolongée, moins de personnes vaccinées meurent, quelle qu’en soit la cause, y compris Covid-19, que les personnes non vaccinées, alors nous pourrions conclure que les avantages du vaccin l’emportent sur les risques. Nous avons également souligné que, pour éviter l’effet de confusion de l’âge, il est essentiel que les données pour chaque catégorie d’âge soient disponibles, plutôt que les données agrégées car, de toute évidence, les données agrégées pourraient exagérer les taux de mortalité vaccinale si plus de personnes âgées, avec des prévisions plus courtes mortalité, sont inclus. Le déploiement du vaccin au Royaume-Uni a été effectué par ordre d’âge décroissant, du plus âgé au plus jeune, sauf très tôt dans le programme de vaccination lorsque les jeunes vulnérables ont été vaccinés avec les personnes très âgées. Au fur et à mesure que le programme progressait, les personnes vaccinées étaient, en moyenne, plus âgées que celles qui n’avaient pas été vaccinées et au fur et à mesure du déploiement, une proportion progressivement plus élevée de la population non vaccinée résiduelle est plus jeune.
Le dernier rapport de l’Office for National Statistics sur les taux de mortalité par statut de vaccination Covid fournit des données sur tous les décès – liés à Covid et non liés à Covid pour la période janvier-juillet 2021 pour les non vaccinés et les différentes catégories de vaccinés (‘dans les 21 jours suivant le premier dose », « 21 jours ou plus après la première dose », « deuxième dose »). Les données de l’ONS pour la mortalité Covid-19, sont présentées dans le tableau 4 du tableur ONS et les données ONS pour la mortalité toutes causes hors Covid-19, sont présentées dans le tableau 5 du même tableur . Les deux tableaux sont reproduits au bas de cet article.
Nous pensons qu’il existe de graves faiblesses et des erreurs possibles dans les données de l’ONS (voir foonote**). Mais surtout, bien qu’il ne fournisse pas les données brutes classées par âge, il fournit des taux de mortalité « standardisés selon l’âge »*** (voir également la vidéo explicative). Cela signifie que l’ONS a calculé le taux de mortalité global d’une manière qui (selon eux) s’ajuste à l’effet confusionnel de l’âge, et cela est « intégré » dans les taux de mortalité qu’ils ont publiés. Cependant, alors qu’ils déclarent ce taux de mortalité ajusté en fonction de l’âge pour chacune des trois catégories distinctes de personnes vaccinées, ils ne le déclarent pas pour l’ensemble combiné de personnes vaccinées. Dans notre analyse, et en l’absence de données stratifiées sur l’âge réel, nous calculons un taux de mortalité toutes causes ajusté en fonction de l’âge en utilisant les tailles de population publiées par l’ONS pour chacune des trois catégories de vaccinés. Ce n’est pas idéal car les taux ajustés en fonction de l’âge de l’ONS sont si opaques et ne sont pas des « chiffres absolus ». Cependant, en l’absence de données détaillées, cela devrait fournir une estimation raisonnable de ce que serait le taux de mortalité toutes causes de l’ONS ajusté en fonction de l’âge pour tous les non vaccinés s’ils avaient pris la peine de le déclarer. Nous appellerons cela le « taux de mortalité vacciné pondéré ». Le tableau de données dérivé des données de l’ONS et utilisé pour calculer ce taux est donné à la fin de cet article.
Il s’avère que, même en utilisant ce taux de mortalité ajusté selon l’âge, le taux de mortalité est actuellement plus élevé chez les vaccinés que chez les non vaccinés.
Les taux de mortalité ajustés selon l’âge pour les vaccinés contre les non vaccinés pour les semaines 1 à 26 de 2021 sont présentés ci-dessous. Dans l’ensemble, le graphique montre qu’au fil du temps, le taux de mortalité pondéré des vaccinés a régulièrement augmenté et qu’à la semaine 16 (23 avril 2021), il a dépassé celui des non vaccinés.
 |
| La semaine 1 se termine le 6 janvier 2021, la semaine 26 se termine le 2 juillet 2021 |
Le graphique suggère une tendance de mortalité saisonnière normale pour les non vaccinés, avec un pic hivernal la semaine 6, le 12 février 2021, et une baisse constante vers l’été. En revanche, le schéma pour les vaccinés est complètement différent. À partir de la semaine 24, les taux de mortalité des vaccinés et des non vaccinés semblent converger au début de l’été.
Comme les données de l’ONS décomposent les données au fil du temps pour les trois catégories de vaccinés (ceux dans les 21 jours suivant la première dose, ceux dans les 21 jours après la première dose et ceux après deux doses), nous pouvons également tracer des graphiques de mortalité pour chacune de ces catégories. . Le taux de mortalité, pour la semaine 26, jusqu’au 2 juillet, pour les non vaccinés est d’environ 25 décès pour 100 000. Mais il existe de grandes différences entre les taux de mortalité pour les différentes catégories de décès vaccinés. Par exemple, pour ceux après 21 jours de première dose, la mortalité comparable est d’environ 89 décès pour 100 000 personnes (un nombre qui a considérablement augmenté depuis janvier), tandis que pour les personnes vaccinées avec deux doses, il y a eu environ 15 décès pour 100 000 dans le même Période de juillet.
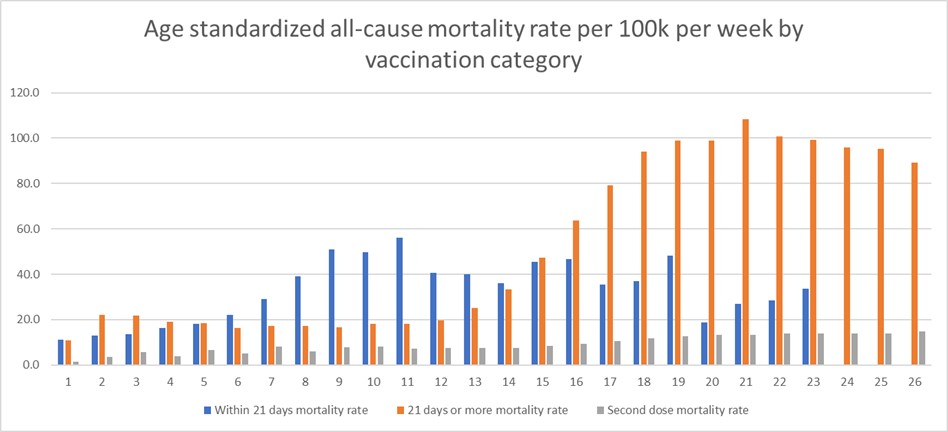
Mortalité « toutes causes » parmi les vaccinés en Angleterre
Les tendances des différentes catégories de vaccination sont également préoccupantes. Contrairement aux non vaccinés, les taux de mortalité des vaccinés ont d’abord augmenté à partir de valeurs initiales très faibles, mais ont ensuite augmenté, tandis que celui des non vaccinés a diminué. Les graphiques ci-dessous montrent ces modèles.
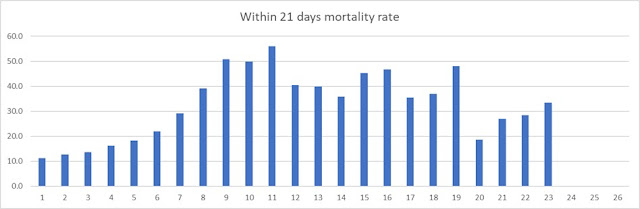
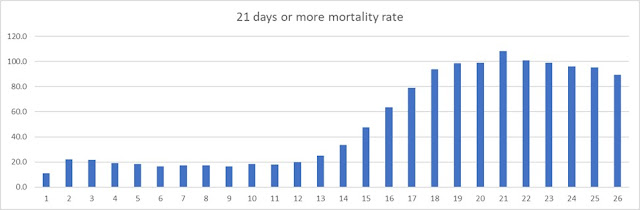
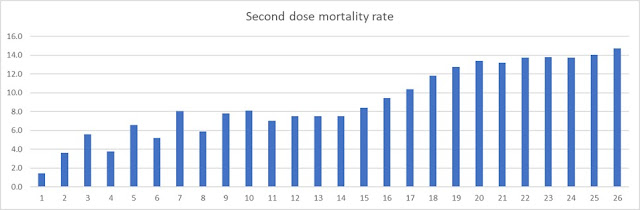
Depuis le 19 mars, le taux de mortalité par vaccination à double dose a augmenté d’une semaine à l’autre de manière plus ou moins constante. Le taux de mortalité chez les personnes plus de 21 jours après la première dose a augmenté considérablement au printemps (à la semaine 14) et est resté élevé par la suite. La mortalité dans les 21 jours suivant la vaccination a initialement augmenté, mais semble s’être stabilisée, quoique avec un peu de bruit. Nous laisserons à nos collègues cliniciens le soin d’expliquer pourquoi il existe des modèles si différents.
En raison des limites et des erreurs possibles dans les données de l’ONS**, de nombreuses mises en garde doivent être appliquées à notre analyse brute (y compris certaines qui sont couvertes dans le post précédent ). Mais nous pouvons conclure que les propres données de l’ONS ne corroborent pas les affirmations concernant l’efficacité/l’innocuité du vaccin.
Il est également important de noter que la population de personnes vaccinées devient suffisamment importante et représentative pour que la criticité de l’ajustement de l’âge diminue considérablement. Nous ferons une analyse de suivi qui en tiendra compte.
* Pour ceux qui ont répondu à cet article en disant qu’ils ne comprenaient pas pourquoi nous nous concentrons sur la mortalité toutes causes :
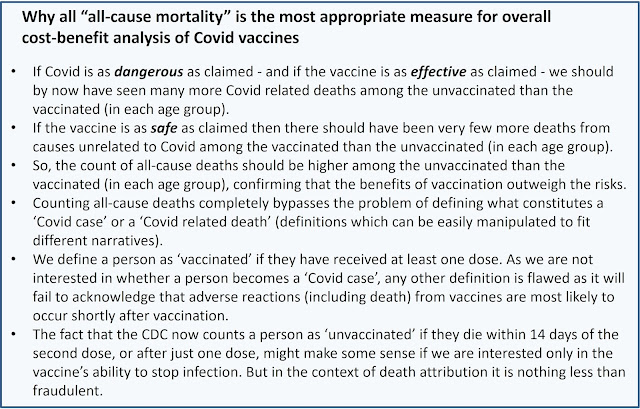
Pourquoi la mortalité « toutes causes » est la mesure plus appropriée pour une analyse globale des bénéfices-risques des vaccins anti-Covid
|
** Limitations et erreurs potentielles dans les données de l’ONS (merci à Clare Craig pour en avoir identifié certaines)
- Ne fournit pas les données brutes classées par âge.
- Le score standardisé selon l’âge utilisé par l’ONS s’appuie sur les données du recensement de 2011 pour déterminer les proportions de population dans chaque catégorie d’âge. Ces proportions ont changé depuis 2011 et, comme nous l’avons noté dans cet article , ces différences peuvent modifier considérablement les résultats.
- Il existe des incohérences dans les chiffres de vaccination entre les données de l’ONS et les données du National Immunization Management Service (NIMS). Par exemple, à la semaine 26, le NIMS compte 28,1 millions de personnes de plus de 18 ans qui ont eu une deuxième dose, mais l’ONS n’en compte que 23,3 millions.
- La population totale de l’ONS est de 16,6 millions de moins que l’ensemble de la population. Seuls 12,6 millions ont moins de 18 ans, les 4 millions restants sont donc omis pour une autre raison.
- Les taux des non vaccinés au 8 janvier sont inférieurs à ceux des doubles vaccinés en été. De plus, le 8 janvier, seuls 12% des plus de 65 ans avaient été vaccinés, de sorte que la population non vaccinée aurait dû avoir un taux de mortalité très similaire aux niveaux de base.
- Les taux de mortalité hebdomadaires ajustés en fonction de l’âge (pour les décès non liés à Covid) en forte augmentation pour les 38 millions de personnes non vaccinées en janvier sont totalement incompatibles avec les changements hebdomadaires des années précédentes. Bien que cette population exclut les moins de 18 ans et les 1,2 million (principalement les plus de 65 ans) qui avaient alors reçu leur première dose, nous ne nous attendrions pas à ce que le taux de mortalité de cette population soit radicalement différent du taux de mortalité de l’Angleterre observé ces dernières années comme rapporté dans un autre rapport de l’ONS .
- En fin de compte, nous devons exclure les décès non naturels tels que les meurtres, les accidents et les suicides, car ils peuvent introduire un biais entre les cohortes, en particulier dans les catégories d’âge jeunes où le nombre total de décès est faible.
Voici les données du tableau 4, les données brutes, pour les décès de Covid-19, telles que fournies par l’ONS :
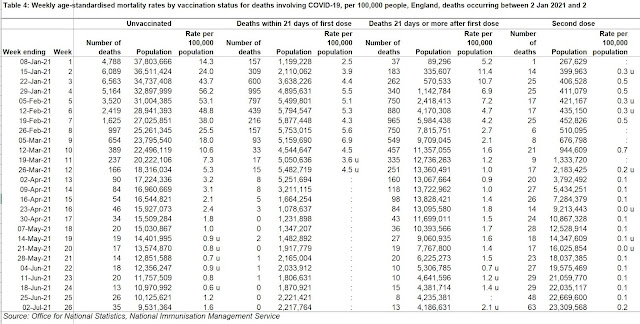
Voici les données du tableau 5, les données brutes, pour les décès toutes causes confondues à l’exception du Covid-19, telles que fournies par l’ONS :

Enfin, voici les données que nous avons utilisées pour calculer les taux de mortalité combinés toutes causes ajustées selon l’âge et le taux de mortalité vacciné pondéré.
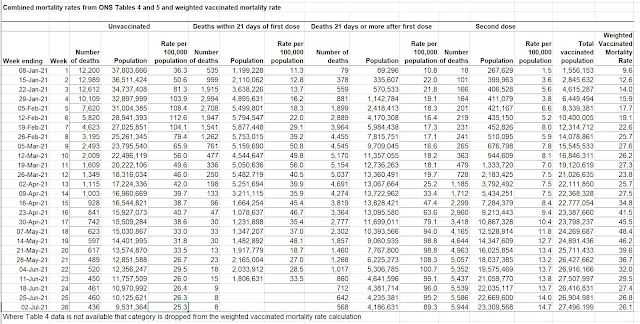
***
La définition de l’ONS des taux de mortalité standardisés selon l’âge (cliquez pour agrandir)
Le #6 de la Gazette des Amis du RIC (septembre 2021) est paru 🙂
Chaque mois, les principales actualités et actions des personnes œuvrant pour l’instauration du RIC et d’une démocratie digne de ce nom.
Sommaire de ce mois
Invitations à l’action
• Aidons à la diffusion du RIC sur Facebook
• Participons aux Votations Citoyennes du MCP
• Faisons signer la pétition : obtenir le RIC ETM pour pouvoir voter sur le pass sanitaire
• Autres propositions d’actions
Vidéos
• Pourquoi est-ce si difficile de faire de la France une véritable démocratie ?
• Fly Rider, Étienne Chouard, Yvan Bachaud et Léo Girod parlent du RIC
• Témoignage et audition de Jean-Philippe Tanguy
Infos utiles
• Analyse du RIC de La France insoumise (LFI)
• Analyse du RIC de Clara Egger et Espoir RIC 2022
+ Agenda, actions numériques, productions artistRIC
Présentation du sommaire en vidéo
Rendez-vous ce soir, 20h30, pour parler avec le MCP de l’auto-organisation par les citoyens des votes qu’ils jugent utiles. Si on y réfléchit, la souveraineté ne se réclame pas : elle s’exerce, de façon autonome et libre, non ?
Chouette soirée 🙂
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10159497757787317
Tweet correspondant à ce billet :
Le MCP vous présente ce soir la prochaine grande votation qui aura lieu le 16 octobre prochain sur la démocratie.
Je présenterai les objectifs de cette action, puis des membres du MCP expliqueront comment organiser facilement une votation dans sa commune.https://t.co/MrVF7XqDVd— Étienne Chouard (@Etienne_Chouard) September 28, 2021
Fil Telegram correspondant à ce billet :
https://t.me/chouard/168